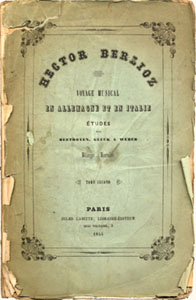
![]()
Le voyage en Italie — Le séjour à Rome
© 2012 Michel Austin

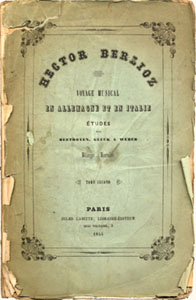 |
Le voyage en Italie — Le séjour à Rome© 2012 Michel Austin |
 |
Les deux articles reproduits ci-dessous ont été écrits par Michel Austin pour le Catalogue de l’exposition sur Hector Berlioz et l’Italie. Voyage musical, sous la direction de Chantal Spillemaecker et Antoine Troncy (Lyon: Éditions Libel, 2012) qui fut présentée au Musée Hector-Berlioz à La Côte-Saint-André de juin à décembre 2012. Les articles avaient pour titre à l’origine Pensionnaire à la villa Médicis (p. 40-52) et De Nice à Naples, le voyage du compositeur (p. 58-79). Nous remercions vivement les Éditions Libel et le Musée Hector-Berlioz de nous avoir donné la permission de reproduire ces articles ici dans une version remaniée. L’article sur le séjour à Rome fait suite à celui sur le voyage en Italie, et les deux articles donnent une vue d’ensemble du voyage de Berlioz; ils complètent ainsi les pages qui traitent en détail des divers moments de ce voyage, dont on trouvera la liste sur la page principale sur Berlioz en Italie.
I. Le voyage en Italie
II. Le séjour à Rome
Abréviations:
CG = Correspondance Générale, 8 tomes (1972-2003)
CM = Critique Musicale, 10 tomes (1996-2020)
Holoman = D. Kern Holoman, Catalogue of the Works of Hector Berlioz (1987)
Mémoires = Mémoires de Hector Berlioz (1870)
Voyage = Voyage musical en Allemagne et en Italie. Etudes sur Beethoven, Gluck et Weber. Mélanges et nouvelles (2 tomes, Paris 1844)
![]()
Cruelle mémoire des jours de liberté qui ne sont plus ! (Berlioz, Mémoires, chapitre 37)
L’Italie et l’Allemagne : deux destinations imposées, dans cet ordre, par le règlement aux lauréats du Prix de Rome. Mais quelle différence dans la place que ces deux pays tiendront dans la carrière musicale et la pensée du compositeur ! Le voyage en Allemagne, que Berlioz envisage dès l’automne de 1831 pendant qu’il est toujours en Italie (CG nos. 247-9), n’aura lieu pour finir que plus de dix ans plus tard, mais une fois que Berlioz aura pris pied en Allemagne il y reviendra constamment tout au long de sa carrière, jusqu’à sa dernière visite à Cologne en 1866. Mais pour l’Italie, c’est à contre-cœur que Berlioz s’y rend au début de l’année 1831, et dès la fin de l’année il songe à écourter son séjour. Il quittera définitivement le pays à la fin de mai 1832 pour ne jamais y revenir.
L’opposition entre l’Allemagne, patrie de la musique, et l’Italie, pays anti-musical, remonte à Berlioz lui-même. À l’automne de 1843, peu après son retour de son premier voyage en Allemagne, il est à la recherche d’un éditeur pour un ouvrage en deux tomes sur ses deux voyages (CG nos. 851, 853, 875), ouvrage qui paraîtra l’année suivante : c’est le Voyage musical en Allemagne et en Italie. Etudes sur Beethoven, Gluck et Weber. Mélanges et nouvelles, 2 tomes, parus chez Jules Labitte à Paris (1844). Le premier livre publié par Berlioz, ce Voyage préfigure déjà des ouvrages à venir : Les Soirées de l’orchestre (1852), À Travers chants (1862) et les Mémoires posthumes (1870), qui tous trois réutiliseront des chapitres parus dans le Voyage de 1844. Le titre mérite qu’on s’y attarde. L’ouvrage ne comporte pas de préface, et le lecteur, comme souvent chez Berlioz, doit interpréter ce qu’il lit et saisir les allusions au passage. Le voyage en Allemagne date de 1842-3 mais occupe la place d’honneur au premier tome, alors que celui en Italie, antérieur de plus de dix ans, est relégué au second. Les lettres sur l’Allemagne sont suivies d’une étude sur la musique en général, puis par une série de chapitres concernant les grands noms de la musique allemande : les symphonies et la musique instrumentale de Beethoven, le Freyschütz de Weber, puis des souvenirs personnels de Berlioz sur l’Opéra dans les années 1820 quand Gluck était à l’honneur. Berlioz entend marquer le point : ‘Il ne faut pas croire que [la] fécondité de Beethoven ait rien de commun avec celle des compositeurs italiens, qui ne comptent leurs opéras que par cinquantaines’ souligne-t-il (Voyage I p. 360). S’il inclut au tome I une lettre admirative à Spontini à propos de son opéra Fernand Cortez (Voyage I p. 403-4), c’est sans doute pour laisser entendre qu’il y a des exceptions à la règle.
Vale, Germania, alma parens ! C’est avec ces mots que Berlioz conclut sa dernière lettre au retour d’Allemagne (Voyage I p. 237). Avec l’Italie, par contre, Berlioz se sent obligé d’emblée de justifier son voyage : ‘Il faut dire aussi pourquoi j’étais là, car on ne s’en douterait guère. En effet, que peut aller chercher un musicien en Italie ?’ (Voyage II p. 5) La cause de son voyage réside uniquement dans la tyrannie d’un règlement que Berlioz ne cessera de juger absurde. Dans son tout dernier feuilleton du Journal des Débats (8 octobre 1863), à propos des Pêcheurs de perles de Bizet, il décoche ce trait : ‘M. Bizet, lauréat de l’Institut, a fait le voyage de Rome ; il en est revenu sans avoir oublié la musique’. Du point de vue musical, le récit du séjour en Italie dans le Voyage prend l’allure d’un réquisitoire. Il se termine avec des considérations sur le manque d’aptitude des Italiens pour la musique sérieuse : ‘Il est impossible de se dissimuler que le peuple italien n’apprécie de la musique que son effet matériel, ne distingue que ses formes extérieures. De tous les peuples de l’Europe, je penche fort à le regarder comme le plus inaccessible à la partie poétique de l’art ainsi qu’à toute conception excentrique un peu élevée. La musique n’est pour les Italiens qu’un plaisir des sens, rien d’autre’ (Voyage II p. 218). Le récit du séjour en Italie est suivi non d’études sur des compositeurs italiens, mais par des nouvelles, avec au passage deux chapitres qui ramènent le lecteur au grand compositeur allemand Gluck (Voyage II p. 265-307).
Malgré sa répugnance à faire le voyage et sa hâte de revenir, Berlioz en fait a beaucoup écrit sur l’Italie, au cours de son séjour et après son retour à Paris. Il y a d’une part la correspondance du compositeur : plus d’une cinquantaine de lettres ont survécu, parmi les plus belles de toute sa correspondance, datant de la période du voyage ; lettres à des membres de sa famille, les plus nombreuses, soit lettres individuelles (à son père, sa mère, ses sœurs Nancy et Adèle, son grand-père), soit souvent collectives ; lettres à ses amis et connaissances, notamment Humbert Ferrand, Thomas Gounet (le plus assidu de ses correspondants pendant son voyage), Ferdinand Hiller et Mme Lesueur. Privé pendant plus d’un an de contact régulier avec ses familiers Berlioz leur écrit, parfois très longuement, et attend leurs réponses avec impatience. Certaines lettres ont un caractère presque littéraire, et on y reconnaît l’amorce des récits qu’il publiera par la suite. La correspondance du compositeur a l’avantage irremplaçable de livrer ses impressions et réactions sur le vif, au fur et à mesure qu’il découvre le pays, et on y relève des détails intéressants qui manquent dans ses récits postérieurs. Elle aide aussi à établir une chronologie relativement précise de ses déplacements, chronologie qui fait largement défaut dans ses récits postérieurs où le souci de composition a souvent pour effet d’estomper la suite exacte des événements.
Au cours de son séjour à Rome Berlioz reçoit déjà une première commande pour un article sur la musique en Italie. Écrit de décembre 1831 à janvier 1832 (CG nos. 249, 256-8) l’article paraît dans la Revue européene du 15 mars : c’est la ‘Lettre d’un enthousiaste sur l’état actuel de la musique en Italie’ (CM I p. 69-83) où pour la première fois il exprime publiquement ses réserves sur l’Italie musicale dont sa correspondance fait état presque dès son arrivée dans le pays. Mais il ne s’en tient pas là. De retour à Paris il entame une longue série d’articles traitant de son voyage et de ses impressions, articles qui paraîtront dans différentes revues entre 1833 et 1836 (CM I p. 91-112, 153-70, 211-19, 239-44 ; II p. 263-70, 477-82, 567-81 ; cf. aussi V p. 509-15; voyez aussi “Un Pensionnaire de Rome”). Il publie un condensé de ces articles dans deux chapitres de l’Italie Pittoresque en juillet 1834 et mai-juin 1835 (CM I p. 313-41 et II p. 155-68) et rend compte longuement de ce volume dans le Journal des Débats du 2 août 1836 (CM II p. 521-9). Tous ces divers travaux fourniront l’essentiel de la matière du Voyage musical de 1844, puis des Mémoires posthumes (chapitres 22-23, 25, 29-43) qui reprennent à quelques détails près ce que Berlioz avait déjà dit dans le Voyage. Si dans ce qui suit on renverra aux Mémoires plutôt qu’à ces articles et publications antérieures, ce n’est qu’un raccourci commode : le lecteur saura que la vision définitive que Berlioz donne de son voyage en Italie remonte pour l’essentiel aux récits publiés dans les années 1833 à 1836, et non à une époque plus tardive. Avec le recul du temps Berlioz, s’il reste toujours très critique envers la musique en Italie, peut maintenant qu’il est ‘replongé dans la tourmente parisienne’ (Mémoires, chapitre 37) apprécier avec plus de sérénité les charmes du pays et même ceux de Rome. Dans son compte-rendu de l’Italie pittoresque il termine ainsi : ‘Ce recueil est le meilleur guide qu’on puisse offrir aux voyageurs qui n’ont pas encore visité l’Italie ; pour ceux au contraire qui la connaissent, ils trouveront à le parcourir un charme très vif encore, celui des souvenirs’ (Journal des Débats, 2 août 1836; CM II p. 529).
Il va de soi que correspondance et Mémoires se complètent et sont inséparables. Dans ce qui suit on fera un large usage de citations tirées de tous ces divers écrits, et surtout des lettres : nul ne saurait mieux raconter Berlioz que Berlioz lui-même.
Il ne peut être question de suivre pas à pas tous les multiples déplacements de Berlioz en Italie, depuis son départ de Marseille en février 1831 jusqu’à son retour en France fin mai de l’année suivante. Mais d’un autre côté on ne peut passer outre à la chronologie : le voyage de Berlioz est un voyage de découverte et d’imprévu. Ayant cherché à être dispensé du voyage Berlioz n’a formé au départ aucun plan de route, et n’en formera pas pendant son séjour. Ses déplacements seront dictés par les circonstances : d’abord le hasard, ‘ce dieu inconnu qui joue un si grand rôle dans ma vie’ (Mémoires, chapitre 53), ensuite l’humeur changeante d’un voyageur peu ordinaire, chargé dès avant son départ de souvenirs historiques, de l’antiquité à Napoléon, et littéraires – Virgile, Shakespeare, Chateaubriand – observateur attentif, à la mémoire profonde, à l’imagination en éveil et toujours en quête de sensations nouvelles.
Mais au départ de Paris, la première préoccupation de Berlioz est d’ordre personnel. S’il répugne au voyage en Italie que lui impose le règlement, ce n’est pas uniquement pour des raisons musicales et professionnelles. En 1830 il venait de se fiancer à Paris avec la brillante jeune pianiste Camille Moke, et avait obtenu le consentement de ses propres parents à son mariage ; la perspective d’une absence de deux ans de Paris n’était donc guère réjouissante, et de plus les sentiments de Camille et de sa mère pouvaient éveiller dans l’esprit de Berlioz bien des inquiétudes. Après un séjour à La Côte-Saint-André en janvier 1831 Berlioz s’embarque de Marseille pour Livourne en février, et poursuit sa route par voie de terre avec un arrêt à Florence, pour arriver enfin à Rome une première fois vers le 10 mars. Mais son esprit est ailleurs : rongé d’inquiétude par l’absence de lettres de Camille, il quitte Rome trois semaines plus tard et retourne à Florence où il attend des nouvelles. Après deux semaines, coup de tonnerre : une lettre de Mme Moke lui apprend que sa fille vient de se fiancer avec le riche facteur de pianos Pleyel. Berlioz décide sur le champ de courir à Paris pour tirer vengeance des trois coupables en les tuant tous les trois, après quoi il se tirerait un coup de pistolet dans la tempe… Mais en cours de route il revient à la raison, et au lieu de poursuivre son projet vengeur en direction de Paris il s’arrête à Nice où il passe près d’un mois. Le récit de cet épisode digne d’un roman est raconté par Berlioz d’un ton allègre (Mémoires, chapitre 34 ; ‘Épisode bouffon’ est le titre du chapitre correspondant dans le Voyage de 1844). Les lettres de l’époque ne laissent cependant aucun doute sur la gravité de la crise personnelle qu’il traverse, avec au passage une tentative de suicide manquée le 18 avril quand après un arrêt à Gênes il se jette à la mer et est repêché (CG no. 217, cf. 219, 222).
C’est donc à Nice que Berlioz amorce son retour à la vie et que son séjour en Italie prend son véritable départ. Nice fait alors partie de l’Italie : en promettant à Horace Vernet, directeur de l’Académie de France à Rome, de ne pas aller au delà de Nice et de rester dans les frontières de l’Italie, Berlioz s’assure qu’il ne perdra pas sa pension. De Nice il peut aussi être en contact plus rapide avec sa famille, contact dont il a particulièrement besoin dans ce moment de crise (CG nos. 217, 222, 223). Au cours de son voyage par mer de Marseille à Livourne Berlioz avait pu, à cause d’une accalmie, contempler longuement Nice, mais seulement de loin (Mémoires, chapitre 32). Il ne savait pas alors que c’est à Nice que, deux mois plus tard, il allait passer ‘les vingt plus beaux jours de [sa] vie’ (Mémoires, chapitre 34). L’arrêt à Nice plutôt qu’ailleurs dépend lui aussi de circonstances imprévisibles : sa première idée était de revenir en France en passant par Turin, mais à Gênes la police méfiante lui refuse un passeport et enjoint de passer par Nice…
D’emblée Nice le séduit, comme le témoignent ses lettres à sa famille : ‘J’ai arrêté une chambre délicieuse chez une vieille dame ; je suis sur une petite montagne fortifiée, mes fenêtres donnent sur la mer. […] Nice est une ville vraiment fraîche et rosée, la mer, les montagnes, tout y est verdoyant’ (CG no. 219, 21 avril). ‘Nice est jusqu’à présent la ville d’Italie où je me plais le plus’ (CG no. 222, 29 avril). C’est à Nice qu’il peut admirer la mer pour la première fois : son voyage de Marseille à Livourne, ‘sa première entrevue avec la mer’ (Mémoires, chapitre 32), lui avait révélé la mer mais sous son aspect effrayant : son navire avait failli sombrer dans une tempête et il avait vu la mort de près. Du séjour de Nice date sa passion pour la mer qui sera un des souvenirs les plus durables de son voyage en Italie : ‘Je suis tout accoutumé au continuel râlement des vagues ; le matin, quand j’ouvre ma fenêtre, c’est superbe de voir les crêtes accourir comme la crinière ondoyante d’une troupe de chevaux blancs. Je m’endors au bruit de l’artillerie des ondes, battant en brèche le rocher sur lequel est bâtie ma maison’ (CG no. 223, 6 mai ; cf. 224, 233). Après son voyage à Naples en octobre il confie à Gounet : ‘Je ne vous parle pas de mes impressions multipliées […] seulement je trouve que rien n’égale la mer’ (CG no. 248, 28 novembre).
À Nice Berlioz découvre aussi pour la première fois les délices de la liberté totale, liberté dont il usera largement à partir de ce moment et qui restera pour lui le souvenir le plus précieux de son séjour italien. Contraint au voyage par le règlement du Prix de Rome, c’est cependant en Italie qu’il va découvrir la liberté : l’idée et le mot reviennent constamment dans ses lettres pendant le séjour, et dans tous les souvenirs sur l’Italie qu’il publiera par la suite. ‘Je ne sais rien au monde de plus précieux que la liberté, non pas de faire tout ce qu’on veut, mais de ne pas faire ce qu’on ne veut pas. Et cette liberté, si rare à Paris, pour nous autres hommes de peine, écrivains et artistes, on en jouit en Italie dans toute sa plénitude’, écrit-il en 1836 dans son compte-rendu de l’Italie Pittoresque. ‘À Rome, à Florence, à Naples, en Sicile, en Calabre, dans les montagnes, on peut aller, venir, travailler ou ne rien faire, chasser ou rêver, sans que personne s’informe des raisons que vous avez pour cela’ (CM II p. 521).
Mais à Nice Berlioz fait autre chose que contempler le paysage, rêver et se promener le long de la mer : presque dès son arrivée il veut recommencer à composer. Ses projets sont d’abord vagues : ‘Je vais entreprendre quelqu’immense ouvrage; il ne faut pas que je m’amuse à rêver […] Il y a une Amérique musicale, dont Beethoven a été le Colomb, je serai Pizarre ou Cortez’ (CG no. 219, 21 avril). Mais peu après ses intentions se précisent : ‘J’écris en ce moment une composition sur le Roi Lear de Shakespeare ; je la terminerai ici avant de retourner à Rome’ (CG no. 222, 29 avril), ce qu’il fait effectivement, et il commence à sa suite une nouvelle ouverture, celle de Rob-Roy (CG nos. 223, 228, 231).
Berlioz gardera toute sa vie le souvenir de son séjour à Nice ; il l’évoquera, par exemple, dans un feuilleton en 1860 (Journal des Débats, 26 juin), à l’occasion du rattachement de Nice à la France : ‘Ah ! ma chère tour de Ponchettes, où j’ai passé tant de douces heures, du haut de laquelle j’ai tant de fois envoyé mon salut matinal à la mer endormie, avant le lever du soleil, tu tressailles de joie sur ta base de rochers, tu te sens heureuse d’être une tour de France !’ Nice est la seule ville d’Italie où il reviendra par la suite, une première fois en septembre 1844 où il y retrouve ses impressions idylliques d’il y a treize ans (Mémoires, chapitre 53), et la deuxième fois en mars 1868 au retour de son dernier voyage en Russie. Mais cette dernière visite tourne au tragique : Berlioz tombe deux fois dans les rochers et subit une congestion cérébrale dont il ne se remettra jamais complètement.
Au départ Berlioz envisageait un séjour à Nice d’une quinzaine de jours (CG no. 217), mais en fait il y restera près d’un mois après avoir plusieurs fois ajourné son départ (CG nos. 225, 229). Le voyage de retour se passe sans incidents, d’abord de Nice à Gênes par la route de la Corniche (CG nos. 230, 234). Après son passage à Gênes le mois précédent où il était tout entier à son projet de vengeance, il se donne cette fois le temps d’aller à l’opéra voir une représentation d’Agnese de Fitzhenry de Paër, mais le dédain qu’il a déjà conçu pour les Italiens et leur façon d’envisager la musique n’en est que renforcé. Il se dit aussi choqué de constater l’indifférence des Gênois pour leurs grands hommes, Paganini et Christophe Colomb (Mémoires, chapitre 35 ; ces détails manquent dans la correspondance).
‘De Gênes à Florence je me suis trouvé tout seul avec mon jeune conducteur qui ne sachant pas un mot de français et étant fort bavard m’a plus fait apprendre d’italien en trois jours que je n’en apprendrai ici dans trois mois ; j’ai vu à Pisa cette fameuse tour penchée ; c’est vraiment curieux’ (CG no. 230, 6 juin, de retour à Rome). Détail linguistique qui a son importance, et qui mérite d’être relevé : dès septembre 1826 Berlioz a commencé à apprendre l’italien (CG no. 63), mais une fois arrivé en Italie il a très rapidement complété sa connaissance de la langue, suffisamment pour pouvoir converser librement avec les habitants et fraterniser avec eux, à la campagne comme à la ville. Dès avril on le voit citer dans ses lettres des bribes de conversation en italien (CG no. 216), ce qu’il fera constamment par la suite dans sa correspondance d’Italie ainsi que dans ses récits et souvenirs du voyage. Ici aussi, on peut opposer le voyage en Italie et ceux en Allemagne : Berlioz n’essaiera jamais d’apprendre l’allemand, et les citations en allemand dans ses écrits brillent par leur rareté.
‘J’ai revu Florence avec émotion. C’est une ville que j’aime d’amour. Tout m’en plaît, son nom, son ciel, son fleuve, ses poutres, son palais, son air, la grâce et l’élégance des habitants, les environs, tout, je l’aime, je l’aime…’ écrit Berlioz à Hiller lors de son dernier passage dans cette ville en 1832 (CG no. 270). Les Mémoires (chapitre 35) donnent la même vision d’ensemble : ‘De toutes les capitales d’Italie, aucune ne m’a laissé d’aussi gracieux souvenirs que Florence’. Au cours de son voyage Berlioz s’arrêtera à Florence quatre fois en tout : la première fois du 1er au 5 mars 1831 en route vers Rome (CG nos. 211, 216), puis pendant une quinzaine de jours au début d’avril (CG nos. 216, 223), une troisième fois, et plus brièvement, du 26 au 28 mai sur le chemin du retour vers Rome après son équipée de Nice (CG nos. 230, 231, 234), et finalement pendant quelques jours à partir du 12 mai 1832 quand il repart pour la France (CG nos. 270, 271, 272bis). Sur les différents séjours à Florence le récit des Mémoires (chapitres 35 et 43) est plusieurs fois sujet à caution : s’il ajoute des précisions qui manquent dans la correspondance, il attribue aux troisième et quatrième séjours des événements qui appartiennent en fait, d’après la correspondance, aux deux premiers, plus longs et plus importants.
C’est au cours du premier séjour en mars qu’on voit s’esquisser le jugement négatif de Berlioz sur les théâtres lyriques en Italie et la musique qu’on y joue. Il y voit I Montecchi ed i Capuletti de Bellini : ‘Ignoble, ridicule, impuissant, nul ; ce petit sot n’a pas eu peur que l’ombre de Shakespeare ne vînt le fatiguer pendant son sommeil ; il le mériterait bien’, écrit-il à son père le 2 mars (CG no. 211, cf. 216). Il voit aussi la Vestale de Pacini : ‘J’ai eu assez de force, après le premier acte, pour me sauver’ (CG no. 216, 12 avril). À Florence Berlioz revoit aussi un architecte danois de sa connaissance, ce qui le fait penser à Hamlet : dans son esprit Florence s’associe à Shakespeare (CG no. 211). Moins d’un mois plus tard, deuxième passage : Berlioz préfère attendre des nouvelles de Camille à Florence où il se plaît plus qu’à Rome. Ce deuxième passage sera le plus long. Cloué au lit par un mal de gorge il est obligé de s’arrêter (CG nos. 216, 223), mais il utilise ce temps à revoir l’instrumentation du Bal de la Symphonie fantastique (Mémoires, chapitre 35). Rétabli, il se promène longuement sur les rives de l’Arno et lit pour la première fois le Roi Lear, d’où il va bientôt tirer une ouverture de ce nom (CG no. 223 ; Mémoires, chapitre 35). Florence suscite aussi des impressions funèbres, souvenirs sans doute en partie shakespeariens : Berlioz raconte longuement avoir assisté à deux enterrements de suite, celui d’une jeune femme morte en couches dont il a voulu toucher le corps, et le lendemain celui d’un jeune neveu de Napoléon Bonaparte (CG nos. 216, 223 ; Mémoires, chapitre 35). Le nom de Napoléon paraît plusieurs fois dans la correspondance du compositeur dès le début de son voyage (CG nos. 216, 229) ; Berlioz remarque, par exemple, que la route de la Corniche de Nice à Gênes a ‘été taillée par Napoléon dans le flanc des rochers à six cents pieds au-dessus de la mer qui se brise à leur base’ (CG no. 230). L’ombre de l’empereur hante Berlioz au cours de son séjour en Italie : on y reviendra.
Le deuxième séjour prend fin subitement de la manière que l’on sait. À son retour de Nice Berlioz ne semble s’arrêter que peu de temps à Florence, et on ne sait presque rien de ce bref passage, sauf que la ville lui plaît de nouveau : ‘C’est avec un bien-être inexprimable que je me suis retrouvé à Florence, où j’avais passé de si tristes moments. On m’a mis dans la même chambre ; j’y ai retrouvé ma malle, mes effets, mes partitions, que je ne croyais plus revoir’ (CG no. 234, à Ferrand, 3 juillet, de Rome).
Sur le tout dernier passage de Berlioz à Florence, en mai 1832, les sources semblent quelque peu contradictoires, mais reflètent sans doute les sentiments mélangés de Berlioz au moment de quitter l’Italie pour de bon. La lettre à Hiller citée ci-dessus témoigne de sa joie à revoir la ville ; on lit par contre dans les Mémoires (chapitre 43) : ‘L’aspect de Florence, où je rentrais pour la quatrième fois, me causa surtout une impression accablante’, et les Mémoires placent aussi à cette époque le récit de l’enterrement de la jeune femme, événement qui appartient sans aucun doute au second passage. Le ton de la lettre à Hiller change du début à la fin et se termine avec cet aveu : ‘Voilà une sotte et froide lettre, je suis tout triste. Chaque fois que j’ai revu Florence, j’ai ressenti un trouble intérieur, un bouillonnement confus que je puis à peine m’expliquer. Je n’y connais personne… Il ne m’y est jamais arrivé d’aventure… J’y suis seul comme j’étais à Nice… C’est peut-être pour cela qu’elle m’affecte d’une façon si étrange. C’est tout à fait bizarre. Il me semble que, quand je suis à Florence ce n’est plus moi, mais quelque individu étranger, quelque Russe ou quelque Anglais qui se promène sur ce beau quai de l’Arno. Il me semble que Berlioz est quelqu’autre part et que je suis une de ses connaissances’. Dans une lettre à sa mère du 21 mai, de Milan, Berlioz affirme par contre avoir ‘trouvé [à Florence] beaucoup de gens de ma connaissance’ (CG no. 271). Même la durée exacte du séjour ne semble pas clairement établie : écrivant à Hiller le 13 mai, le lendemain de son arrivée, Berlioz dit qu’il va partir pour Milan ‘dans trois jours’, soit le 16 mai, alors que dans la lettre à sa mère il dit qu’il n’a ‘demeuré que trois jours’ à Florence (de même CG no. 272bis). À son dernier passage à Florence Berlioz va encore une fois à l’opéra où il voit La Sonnambula de Bellini, mais la partition ne lui inspire que du mépris : ‘Il vous faut voir l’Italie pour vous douter de ce qu’ils osent nommer musique dans ce pays-là !…’ dit-il à Hiller.
Le retour de Florence à Rome, fait en voiture en compagnie de moines, se passe sans encombre ; en cours de route Berlioz travaille à ‘un nouvel ouvrage moitié musique moitié poésie’ CG no. 230) : ce sera le ‘mélologue faisant suite à l’épisode de la vie d’un artiste’, c’est à dire la Symphonie fantastique (CG no. 231, et plus longuement CG nos. 232-4). Berlioz termine la fin du parcours à pied, laissant ses compagnons dans la voiture. Marcheur aguerri, la marche à pied va désormais devenir son mode de voyage préféré pour une bonne partie de ses déplacements en Italie à partir de Rome.
De retour à Rome Berlioz, affranchi des angoisses qui avaient pesé sur son premier séjour dans la capitale, est maintenant en principe libre d’organiser son séjour en Italie à des fins musicales. Mais il ne le fait pas, et le séjour prend rapidement une tournure très particulière. Pratiquement tous les autres voyages de Berlioz à l’étranger, du premier voyage en Allemagne en 1842-3 au dernier voyage en Russie en 1867-8, auront un but commun : Berlioz voyage avant tout pour donner des concerts. Mais avec le voyage en Italie il ne peut en être question, et Berlioz n’y songe même pas. Dans une lettre à sa mère (CG no. 266, 20 mars 1832) il écrit : ‘Vous me demandez quels succès obtiennent mes compositions ?… mais vous savez bien, chère maman, qu’il n’y a point de musique dans ce pays-ci ; il n’y a pas seulement moyen d’y faire exécuter un quatuor.’ En Italie, la musique instrumentale est ‘à peu près inconnue’, et ‘on ne doit pas exiger des orchestres comme ceux de Berlin, de Dresde ou de Paris’ (Memoires, chapitre 41). Quand il passe par Milan juste avant de quitter l’Italie pour de bon, il y entend ‘pour la première fois, un vigoureux orchestre ; cela commence à être de la musique, pour l’exécution au moins’ (CG no. 273, 25 mai 1832). Les seuls ‘concerts’ que Berlioz donnera en Italie, et qu’il donnera souvent, c’est quand il joue de la guitare, soit pour accompagner des soirées à la Villa Medici, soit pour amuser les paysans à la campagne, soit pour s’accompagner lui-même. Et la seule ‘création’ en Italie d’une nouvelle œuvre de Berlioz sera l’exécution en petit comité à la Villa Medici de la mélodie la Captive qu’il compose à Subiaco en février 1832.
Peu de jours après son retour à Rome après une absence de deux mois, Berlioz se sent déjà mal à l’aise et se met à regretter Nice : ‘Oh ! ma jolie petite Nice, et la mer, et les rochers verdoyants, et le vent frais !’ (CG no. 230, à sa sœur Adèle, 6 juin). ‘Si au moins je pouvais être seul, si j’avais la mer à adorer (car je l’adore) comme à ma riante Nice, je ne me plaindrais pas’ (CG no. 231, à Gounet, 14 juin). Il lui faut de nouveau s’évader de Rome.
Quinze jours après son retour à Rome Berlioz part avec un compagnon pour découvrir Tivoli, à six lieues de Rome ; ils font les trois-quarts de la route à pied, mais montent dans une voiture en fin de parcours et arrivent le soir. Berlioz est tout de suite enchanté (CG no. 232, 24 juin, à sa famille) :
Je n’ai jamais rien vu de si délicieusement beau. Ces cascades, ces nuages de poudre d’eau, ces gouffres fumants, cette rivière fraîche, ces grottes, ces innombrables arcs-en-ciel, les bois d’oliviers, les montagnes, les maisons de campagne, le village, tout cela est ravissant et original. […] J’ai vu aussi la villa Adriana, et ces sublimes ruines m’ont rempli de tant de pensées et de sensations que je crois qu’elles ont voulu me dédommager de la non impression de toutes celles de Rome. Figurez-vous une maison de campagne d’une lieue et demi de tour, dans laquelle l’empereur Adrien avait réalisé de véritables rêves. […] Je me suis vu pour la première fois en présence de la grandeur romaine, j’étais oppressé, consterné, anéanti. Encore si j’eusse été seul !… mais patience, ce n’est qu’à une demi-heure de Tivoli, et quand j’y serai établi, je me permettrai d’y passer la journée quelquefois.
Après plusieurs jours à Tivoli, Berlioz retourne à Rome mais avec la ferme intention de repartir aussitôt que possible, et de repartir seul.
Dans les premiers jours de juillet il est de retour à Tivoli, d’où le 8 il écrit à sa sœur Adèle à côté de la grande cascade, dans le petit temple de Vesta, et lui confie qu’il part le lendemain pour Subiaco, ‘petit bourg des montagnes à dix lieues plus loin que Tivoli’ (CG no. 235). Dès avant son départ de Rome il avait décidé d’aller s’y installer avant même d’avoir vu l’endroit (CG nos. 233, 234) : à Rome on lui avait sans doute vanté les charmes du village, très fréquenté par les paysagistes de l’Académie. Dès son arrivée il est enthousiasmé : ‘Ce pays-ci est le plus pittoresque que j’aie encore vue de ma vie. Il n’y a pas les cascades de Tivoli, mais on y voit un torrent furieux presque aussi grand que l’Anio et qui se précipite en deux ou trois endroits avec autant de fracas sinon de majesté que la grande cascade de Tivoli. Et puis des montagnes ! Ah des montagnes ! J’en arrive il y a une heure’ (CG no. 236, 10 et 17 juillet, à sa famille).
La découverte de Subiaco et de ses environs est pour Berlioz, après son séjour à Nice, un des grands moments de son voyage, et il y reviendra constamment par la suite : deux fois en septembre (CG nos. 240, 241), un passage fin octobre à son retour de Naples (CG nos. 246, 247, 250), un autre séjour vers le 20 novembre (CG no. 248), puis de nouveau au début de février 1832 (CG nos. 261, 263), et sans doute encore en avril avant son départ définitif pour la France (Mémoires, chapitre 42). Subiaco, c’est son ‘village chéri’ (CG no. 250), et devient son refuge préféré contre l’ennui de Rome. Subiaco, c’est Nice moins la mer, comme il l’écrit à Mme Lesueur le 2 juillet, avant même son second départ pour Tivoli : ‘Je vais dès maintenant m’établir dans les montagnes de Subiac[o], à dix-huit lieues de Rome, où je recommencerai ma vie libre de Nice : mais, Dieu ! je n’y trouverai pas la mer ; cette belle et vaste mer qui s’étendait sous mes fenêtres, qui me charmait par le flou-flou de sa robe verte, qui rugissait avec moi dans mes jours de rage, et me laissait dormir sur ses cailloux blancs, en se contentant de venir lécher mes pieds, dans mes journées calmes ou mélancoliques… N’importe, il faut que je redevienne seul’ (CG no. 233). Subiaco le ramène aussi à ses souvenirs d’enfance : les montagnes aux alentours lui font penser au Saint-Eynard (CG no. 236). Après un séjour au début de septembre il écrit à son grand-père qui vivait toujours à Meylan : ‘[Je me suis] plu davantage dans les montagnes sauvages des frontières du royaume de Naples où j’ai déjà passé près d’un mois et où je retourne incessamment. Je trouve délicieuse cette vie isolée, ces courses dans les rochers, ces bains dans le torrent, cette société de paysans dont quelques-uns sont pleins d’une affectueuse bonhomie ; séparé entièrement du tracas insipide de la ville, je prends les mœurs agrestes d’autant plus volontiers que la contrainte imposée par celles du monde civilisé (de Rome s’entend) ne se trouve compensée par rien. Je comprends mieux que jamais le plaisir que vous trouvez dans votre solitude de Meylan’ (CG no. 240, 15 septembre). Deux jours plus tard il écrit à Hiller : ‘Je vais retourner dans [mon ermitage] de Subiaco ; rien ne me plaît tant que cette vie vagabonde dans les bois et les rochers, avec ces paysans pleins de bonhomie, dormant le jour au bord d’un torrent, et le soir dansant la saltarelle avec les hommes et les femmes habitués de notre cabaret. Je fais leur bonheur par ma guitare ; ils ne dansaient avant moi qu’au son du tambour de basque, ils sont ravis de ce mélodieux instrument’ (CG no. 241).
Subiaco et ses environs permettent à Berlioz de réaliser dans son imagination l’idéal de la vie du brigand libre, affranchi des contraintes de la civilisation dont il fait cependant partie. Tous ses autres voyages ultérieurs en Allemagne et ailleurs auront pour centre des villes où résident les élites : Weimar, Brunswick, Leipzig etc., où l’on trouve la musique telle que l’entend Berlioz. En Italie, par contre, Berlioz passe une bonne partie de son temps en dehors des villes et fraternise avec le petit peuple des villages et des montagnes. L’idée d’une évasion vers le monde sauvage fait surface tôt dans le voyage en Italie, dès sa première arrivée à Rome. Dans une lettre datée du 25 mars, il lance à sa sœur étonnée cette tirade retentissante : ‘J’ai envie d’aller au mont Pausilippe, dans la Calabre ou à l’île de Capri, demander du service à quelque chef de bravi, dussé-je n’être qu’un simple brigand. Alors au moins je verrai des crimes magnifiques, des vols, des assassinats, des rapts […] Allons donc, voilà la vie’ (CG no. 213). Pratiquement le même passage revient dans une lettre à Ferrand peu après (CG no. 216, 12 avril), et il sera reproduit tel quel dans le Mélologue… En fait, Berlioz n’ira jamais en Calabre, mais dans ses courses dans les Abruzzes, le fusil à la main, il peut s’imaginer partager la vie sauvage du brigand et du chasseur. ‘J’emporte une mauvaise guitare, un fusil à deux coups, des albums pour prendre des notes et quelques livres ; un bagage aussi modeste ne peut tenter les brigands, avec lesquels, à dire le vrai, je serais charmé de faire connaissance’ (CG no. 233, à Mme Lesueur, 2 juillet). À quelques-uns de ses correspondants Berlioz veut faire croire que pendant son voyage de retour de Naples il a couché ‘dans des repaires ou des capitales de brigands’ (CG nos. 256, à Hiller; 258, à Mme Lesueur). À sa sœur Nancy il écrit le 23 février 1832 : ‘Je reviens de la montagne (comme disent les brigands), j’y suis allé voir le froid. J’ai vagabondé de village en village, mon fusil sur l’épaule, mangeant le soir ma chasse du jour, m’arrêtant où je me plaisais, ne donnant jamais à l’ennui le temps de m’atteindre, et chantant par tous les pores un hymne à la liberté […] Les gens du grand monde sont à mille lieues de comprendre les jouissances que je viens d’avoir, ils s’imaginent qu’on ne peut se plaire que dans leurs tumultueux et ennuyeux salons’ (CG no. 263, cf. 264).
Outre son fusil, on l’a vu, la guitare fait régulièrement partie du bagage de Berlioz dans ses excursions montagnardes. Pour Berlioz, la guitare va remplacer l’orchestre digne du nom qu’il cherche vainement en Italie, et il joue beaucoup de cet instrument pendant son séjour. À la Villa Medici il fournit l’accompagnement au cours de soirées musicales quand avec d’autres pensionnaires on chante du Gluck ou du Weber (CG no. 232; Mémoires, chapitre 36). À Subiaco et dans ses environs il a grand succès en faisant danser les paysans : ‘Toutes les petites paysannes étaient d’une joie folle et dansaient avec un abandon délicieux, pendant que la voisine agitait son tambour de basque et que je m’écorchais les doigts en improvisant des saltarelles sur la chitarra francese !’ (CG no. 236, cf. 241 ci-dessus). Parfois même il s’accompagne tout seul, selon les Mémoires (chapitre 37), et improvise des récitatifs sur tel ou tel épisode de l’Énéide. On remarquera à ce propos que c’est précisément dans ses partitions ‘italiennes’ que Berlioz fera par la suite usage de la guitare, dans Benvenuto Cellini (Chœur de masques ; Chœur ‘Bienheureux les matelots’ qui reproduit une mélodie notée dans les Abruzzes, chantée entre autres par son ami Crispino ; cf. CG no. 236 et Mémoires, chapitre 38) et dans Béatrice et Bénédict (Chanson à boire de Somarone ; Chœur lointain). Dans une troisième de ces partitions, Roméo et Juliette, s’il n’y a pas de guitare du moins l’orchestre à plusieurs reprises semble chercher à l’imiter (IIème partie, mesures 81-98, 187-206; on remarquera que Berlioz avait d’abord songé à utiliser la guitare dans le Prologue pour accompagner les Strophes avant de la remplacer par une harpe: voir NBE tome XVIII p. 387). Faut-il voir là une réminiscence personnelle du séjour en Italie ?
Autre souvenir musical de ses randonnées dans les Abruzzes, mais aussi de Rome, qu’on retrouvera dans des compositions ultérieures (Harold en Italie, la Sérénade rustique à la Madone pour orgue mélodium), mais celui-là datant non sans doute de ses premières visites en juillet 1831 mais plutôt des premiers mois de l’année suivante : les pifferari, musiciens ambulants qu’il entend à Rome aux approches de Noël et qu’il décrit pour la première fois pendant l’hiver dans sa ‘Lettre d’un enthousiaste’ (CM I p. 79-80). ‘J’ai entendu ensuite les pifferari chez eux’, ajoutera Berlioz plus tard (Mémoires, chapitre 39), ‘et si je les avais trouvés si remarquables à Rome, combien l’émotion que j’en reçus fut plus vive dans les montagnes sauvages des Abruzzes, où mon humeur vagabonde m’avait conduit’ (la correspondance ne semble pas mentionner les pifferari).
Le premier séjour à Subiaco prend fin après une quinzaine de jours : ‘J’ai quitté les montagnes parce que je n’avais plus d’argent’, avoue Berlioz à sa famille (CG no. 238, le 7 août). Dans les déplacements de Berlioz en Italie la question d’argent joue un rôle sans doute plus déterminant que les Mémoires ne le laissent supposer. Il y est certes question du soulagement de Berlioz quand à Nice il est assuré de ne pas perdre sa pension (chapitre 34), de ‘la brèche énorme que la course de Nice avait faite à ma fortune’ (chapitre 35), et de son manque d’argent avant le départ pour Naples fin septembre (chapitre 40). Mais il faut se tourner vers la correspondance pour en savoir plus long. Par exemple, l’aventure de Nice aurait coûté à Berlioz 1050 frs. (CG no. 231), c’est-à-dire plus d’un tiers de sa pension annuelle de 3000 frs, et depuis ce temps il est en arrière de sa pension (CG no. 247). Il la touche en principe tous les mois (CG nos. 211, 222, 265) et normalement à Rome, même si elle peut parfois être versée ailleurs (CG no. 211 : à Florence ; CG no. 247 : à Naples ; cf. CG no. 249). À Rome Berlioz n’a aucun frais de logis ou de table, étant pensionnaire à la Villa Medici, mais quand il sort de Rome il lui faut payer son logement, sa nourriture et les transports, même s’il se déplace souvent à pied, sans doute par préférence, mais aussi par mesure d’économie. La conclusion était inéluctable : ‘Il fallait bien toujours revenir dans cette éternelle ville de Rome’, dit-il dans les Mémoires (chapitre 39), mais sans en indiquer la raison, que la correspondance donne à plusieurs reprises : ‘Je reviens à Rome quand je n’ai plus d’argent. C’est cette irrésistible raison qui m’y retient encore depuis quinze jours’ (CG no. 264, 4 ou 5 mars 1832). La liberté totale dont il croyait pouvoir jouir était donc plus d’une fois entravée par des questions d’argent.
Le voyage à Naples et en Campanie, qui va occuper presque tout le mois d’octobre, semble avoir été décidé tout d’un coup à l’improviste, d’après le récit donné plus de deux mois après à Mme Lesueur : ‘Je m’y suis déterminé brusquement, un jour que je dormitais dans notre bois de lauriers, couché sur un tas de feuilles mortes […] Ma détermination a été bientôt prise ; je me suis levé, j’ai secoué mon habit, je suis monté faire un petit porte-manteau et avertir M. Horace [Vernet], et le lendemain matin je suis parti’ (CG no. 258, 12 janvier 1832). Dans cette lettre Berlioz donne l’impression que d’un bout à l’autre il a fait le voyage de Naples seul en promeneur solitaire ; ses autres lettres (notamment CG nos. 244, 246, 247) montrent qu’il n’en est rien : presque tout le voyage, au retour comme à l’aller, se fera avec plusieurs autres compagnons. Les Mémoires (chapitre 40) complètent le récit donné dans la lettre à Mme Lesueur : l’idée du voyage remonte à deux camarades de Berlioz à la Villa Medici, et c’est à leur initiative qu’il se décide à partir, même s’il est déjà à court d’argent. Les Mémoires ajoutent que tout le voyage d’aller à Naples est fait ‘bourgeoisement en voiturin’ ; on est loin ici des courses solitaires dans les montagnes de Subiaco, et Berlioz emporte ni sa guitare ni son fusil.
Arrivé à Naples le 1er octobre, Berlioz commence le lendemain une longue lettre qu’il ne terminera qu’une semaine plus tard (CG no. 244). Il commence par Virgile : il écrit ‘du mont Pausilippe sur le tombeau de Virgile. C’est la première chose que je visite. […] Je rêve en me rappelant les premières impressions poétiques que je dus dans mon enfance à l’auteur de l’Enéide’. Puis il raconte son trajet jusqu’à Naples : il a vu Capoue, puis le couvent des Bénédictins au Monte Cassino, et le palais du roi de Naples à Caserta ‘mais rien n’efface ou même n’égale ce golfe qui se déroule devant moi, ce Vésuve fumant, cette mer couverte de barques […] tout ce peuple bigarré qui se précipite dans les rues […] Quelle vie !… Quel mouvement ! Quelle étincelante agitation ! Comme tout cela diffère de Rome, de ses habitants endormis, de son sol nu, dépouillé, inculte et désert ! Les champs Romains si sévèrement mélancoliques sont aux plaines Napolitaines ce que le passé est au présent, la mort à la vie, le silence à un bruit harmonieux et éclatant’. Quelques jours plus tard il raconte sa visite à pied jusqu’au cratère du Vésuve dont il donne une description saisissante : ‘Oh ! ma foi, voilà la véritable scène du Blocksberg de Faust ; un ballet d’étincelles, des serpents de feu, des râlements infernaux, des lueurs éblouissantes à côté d’une obscurité complète’. Deux jours plus tard, visite, mais cette fois seul, à l’île de Nisida en partant de la baie de Baia : ‘C’est là aussi que Virgile fait aborder Enée avec sa flotte délabrée. J’ai pris sur le bord de la mer une petite barque avec quatre rameurs, qui m’ont conduit rapidement à Nisida, petite île charmante, couverte d’arbres fruitiers, oliviers, orangers, figuiers et vignes ; haute, d’une forme bizarre, verdoyante, rouge et dorée. En la voyant de loin je pensais à ma mélodie irlandaise du coucher du soleil, « à ces îles heureuses que dérobent des voiles d’or »’. Le récit de la visite et du retour est à confronter avec celui, plus enjolivé, des Mémoires qui diffère aussi sur plusieurs détails (chapitre 41). Au retour, forte émotion de Berlioz en contemplant du mont Pausilippe le coucher du soleil sur le cap Misène : ‘Cette scène inexprimable, écrasante de sublime, le bruissement de la mer au-dessous de moi, la vue de mon île charmante, son nom gracieux, m’ont placé au centre d’un tourbillon de souvenirs dont la force était augmentée par mon isolement. […] Oh la puissance du génie !… A travers tant de siècles, l’aspect des lieux chantés par le poète latin, une ressemblance fortuite entre le nom d’une île et celui d’une héroïne de Cervantes, m’ont fait verser des torrents de larmes’.
La lettre suivante, également à sa famille, et datée du 17 au 21 octobre de San Germano (CG no. 246), raconte sa visite à Pompéi : ‘Mes quatre compagnons de voyage et le cicerone gâtaient beaucoup, toutefois, mon petit monde antique ; ce n’est pas là l’effet de Pompéi. Je pestais en moi-même contre les circonstances qui m’empêchaient d’être seul, errant, la nuit, au travers des colonnes et des ombres de colonnes, vu de la lune seulement, et libre de me livrer à tous les caprices de mon impressionabilité […] Mais tout cela est impossible. Il y a des gardiens partout, qui vous suivent d’un œil attentif ; je n’ai pas seulement pu voler pour mon père un pauvre petit débris de fresque ou de mosaïque’.
La correspondance ne dit rien des expériences musicales de Berlioz au cours de son voyage à Naples, sauf, détail intéressant, qu’il voit au musée de Pompéi des instruments de musique antique ‘trouvés dans les cendres du Vésuve à Herculanum ; j’ai essayé deux paires de petites cymbales ; pour les instruments à vent ils sont tous incomplets’ (CG no. 244). Il se souviendra des ‘cymbales antiques’ et on les retrouve dans le scherzo de la reine Mab de Roméo et Juliette. La ‘Lettre d’un enthousiaste’ écrite au cours de l’hiver suivant (CM I p. 81-2) ajoute un complément d’information : au Théâtre San Carlo à Naples il entend pour la première fois depuis son arrivée en Italie de la (vraie) musique. L’orchestre lui paraît excellent comparé à ceux qu’il a observé jusqu’alors, mais les chœurs sont très faibles. Conclusion tout de même : ‘L’attrait musical des théâtres de Naples ne pouvait lutter avec avantage contre celui que m’offrait l’exploration des environs de la ville’ (Mémoires, chapitre 41).
Le séjour à Naples dure moins de deux semaines : arrivé le 1er octobre Berlioz part pour Rome le 14, sans avoir pu voir Pestum, Salerne et Amalfi (CG no. 244), et il est obligé de renoncer à aller en Sicile pour des raisons d’argent (CG no. 246). Il ressort d’une lettre à son père d’après son retour à Rome qu’il a touché d’avance à Naples sa pension du dernier mois, et se voit obligé de demander à son père de l’argent (CG no. 247, 7 novembre). L’idée d’un voyage en Sicile continuera à le tenter par la suite, mais il devra y renoncer encore une fois à la veille de son retour en France (CG no. 269, 7 avril 1832). On pourrait aussi citer ici une remarque sur les contraintes du règlement du Prix de Rome que Berlioz fera dans un article publié en 1836 : ‘Je croirai toujours qu’il est inutile de retenir [les pensionnaires] si longtemps dans l’État romain quand ils brûlent du désir, d’explorer l’Italie du sud, la Sicile, les Calabres, la Grande Grèce en un mot, cette terre antique par excellence, qui a de plus le mérite de ne pas avoir été fouillée, piétinée, dans tous les sens, dessinée et décrite sous tous ses aspects, vulgarisée enfin comme le sont Rome, Naples et toutes les stations des Touristes’ (CM II p. 579).
Contraint à écourter son voyage en Campanie par souci d’économie, Berlioz n’en profite pas moins pour revenir à un mode de voyage qu’il préfère : ‘Je suis parti de Naples vendredi dernier [14 octobre] à pied avec deux officiers suédois qui parlent fort bien le français et sont d’une société fort aimable [Ils se nommaient Mauritz Klingspor et Carl Stephan Bennet ; il existe de ce dernier un journal de voyage qui raconte le retour de Naples à Rome en compagnie de Berlioz]. Cette manière de parcourir le pays est incomparablement plus agréable que les moyens ordinaires ; dans ce moment surtout ; le soleil ne brûle plus, le sirocco ne souffle pas, les fruits sont mûrs, on vendange partout, il fait un petit air frais délicieux ; c’est le beau moment de l’Italie. […] Nous n’avons eu encore d’autre inconvénient que la fatigue et des disputes pour des poires ou des raisins ou des figues volées quand les maîtres n’étaient pas là pour nous les vendre’ (CG no. 246, 17-21 octobre). Ils passent par San Germano d’où Berlioz écrit à sa famille la lettre citée ci-dessus, puis par Isola di Sora où ils sont bien accueillis par un Dauphinois de Voiron, chef d’une papeterie dans la ville, ensuite par Alatri et Arcino, et arrivent finalement par les montagnes à Subiaco où ils restent trois jours avant de rentrer à Rome en passant par Tivoli (CG no. 247). Le voyage du retour semble avoir séduit Berlioz tout autant que son séjour à Naples : ‘Le mois dernier je suis revenu de Naples à pied, à travers les montagnes, par les bois, les rochers, les hauts pâturages, et je n’ai pris de guide qu’une fois. Vous ne sauriez croire le charme d’un pareil voyage : ses fatigues, ses privations, ses apparences de danger, tout cela m’enchantait ; j’y ai mis neuf jours que je me rappellerai longtemps’ écrit-il à Gounet de retour à Rome (CG no. 248, 28 novembre).
Les derniers mois de Berlioz à Rome suivent le même rythme : Berlioz s’évade de Rome chaque fois qu’il le peut. Il fait une autre visite à Subiaco en novembre. Après deux mois passés à Rome en décembre et janvier, il reprend le chemin de Subiaco dès février avec son fusil (CG nos. 263, 265), et en mars et avril il continue ses explorations aux alentours de Rome. ‘Je viens encore de courir à Albano, Frascati, Castel-Gandolfo, etc., etc. : des lacs, des plaines, des montagnes, de vieux tombeaux, des chapelles, des couvents, de riants villages, des grappes de maisons pendues aux rochers, la mer à l’horizon, le silence, le soleil, une brise parfumée, l’enfance du printemps ; c’est un rêve, une féerie !…’ écrit-il le 26 mars à Ferrand (CG no. 267). À sa sœur Adèle, le 7 avril : ‘Ma course aux Montagnes ?… Ah ! en vérité j’en fais si souvent que je ne sais guère de laquelle tu veux parler. Pourtant tu sauras que je suis allé dernièrement à Albano, Frascati et autres lieux ravissants. On y voit d’un côté le lac Albano et de l’autre la mer et la plaine. C’est au dessus de toute description’ (CG no. 269).
Avant de prendre le chemin du retour, Berlioz caresse un temps un autre plan de voyage. ‘Avant de quitter la povera bella Italia’, dit-il à Albert Du Boys, ‘je reverrai Florence et Pise, et j’irai faire un pélerinage à l’île d’Elbe et en Corse’ (CG no. 264, 4 ou 5 mars 1832). Dix jours plus tard il précise son intention à Hiller : ‘En quittant Rome, j’irai visiter l’île d’Elbe et la Corse, pour me gorger de souvenirs napoléoniens : j’espère ne pas trouver de belle occasion pour l’autre île, car je serais capable de succomber à la tentation’ (CG no. 265, 16 mars). Le projet n’aboutira pas, comme il l’écrit au même Hiller, cette fois de Florence en route pour la France : ‘Je ne vais pas à l’île d’Elbe ni en Corse ; il y a actuellement des règlements sanitaires, des quarantaines qui me vexeraient’ (CG no. 270, 13 mai). De Florence il se rend à Milan, qu’il voit pour la première fois, et où il séjourne quelques jours (il ne verra jamais Venise). Il se rend au théâtre de la Scala, où l’orchestre lui paraît bon, mais ‘la partition de mon ami Donizetti [sans doute L’Elisir d’amore] peut aller trouver celles de mon ami Paccini ou de mon ami Vaccaï. Le public est digne de pareilles productions. On cause tout haut comme à la Bourse, et les cannes font sur le plancher du parterre un accompagnement presque aussi bruyant que celui de la grosse caisse’ (CG no. 273, 25 mai, à Ferrand, de Turin ; de même CG no. 272bis, à Horace Vernet, de Milan). Après un passage à Turin Berlioz quitte définitivement l’Italie vers la fin du mois.
![]()
Peu avant son départ définitif de Rome, le 29 mars 1832, Berlioz confie à Spontini : ‘Je n’ai presque jamais habité Rome deux mois de suite ; courant sans cesse à Florence, à Gênes, à Nice, à Naples, dans les montagnes, à pied, dans le seul but de me fatiguer, de m’étourdir et de résister plus facilement au spleen qui me tourmentait’ (CG no. 268). Arrivé une première fois vers le 10 mars 1831, Berlioz quitte Rome définitivement le 2 mai de l’année suivante, mais entre ces dates il y aura de nombreux va-et-vient : pour Berlioz Rome est plus souvent un point de départ qu’un point d’arrivée, et plus de la moitié de son séjour en Italie se passe en dehors de la capitale. Son premier séjour en mars 1831 se termine brusquement après trois semaines, quand il repart pour Florence avec l’intention de pousser vers Paris ; il s’arrête en cours de route à Nice pendant presque un mois et n’est de retour à Rome que le 3 juin. Après quinze jours il commence ses courses vers Tivoli puis Subiaco, et ne revient à Rome de manière durable que vers le 25 juillet. Ensuite, premier séjour plus prolongé à Rome, sans doute en grande partie à cause du manque d’argent et peut-être aussi de la chaleur (la correspondance du compositeur s’interrompt pendant plus d’un mois entre le 7 août et le 14 septembre). Mais dès septembre Berlioz fait un nouveau passage à Subiaco, et à la fin du mois part subitement pour Naples et la Campanie d’où il ne revient à Rome que vers la fin octobre. En novembre il refait une excursion à Tivoli et Subiaco, et ce n’est qu’à la fin du mois que commence son seul séjour de plus grande durée à Rome, d’où il ne bouge pas pendant deux mois : c’est sans doute encore à cause de la saison et de son manque d’argent, et de plus il vient de recevoir une commande pour un article sur l’état de la musique en Italie, travail qui l’occupe jusqu’à janvier et lui rapporte probablement aussi un peu d’argent. Mais dès février et malgré le froid il reprend ses courses errantes à Subiaco et aux alentours de Rome. Dès le milieu de mars il fixe son départ au début de mai (CG nos. 265-7), et en avril, dans sa dernière lettre de Rome, il compte les jours qui lui restent avant son départ : il partirait plus tôt s’il ne fallait attendre que son portrait soit achevé (CG no. 269, 7 avril).
Si l’on s’en tenait à la correspondance, on n’aurait qu’une vue partielle de son séjour à Rome. Les récits publiés par la suite, d’où dérivent les Mémoires, ne contredisent pas les lettres, mais ils permettent de les compléter. Ce n’est que là, par exemple, qu’on trouve le récit de son arrivée à Rome et de ses toutes premières impressions : ‘Je ne saurais exprimer le trouble, le saisissement, que me causa l’aspect lointain de la ville éternelle, au milieu de cette immense plaine nue et désolée… Tout à mes yeux devint grand, poétique, sublime ; l’imposante majesté de la Piazza del popolo, par laquelle on entre dans Rome, en venant de France, vint encore, quelque temps après, augmenter ma religieuse émotion ; et j’étais tout rêveur quand les chevaux, dont j’avais cessé de maudire la lenteur, s’arrêtèrent devant un palais de noble et sévère apparence’ (Mémoires, chapitre 32). Berlioz décrit ensuite en détail la Villa Medici, ses jardins, et la vue sur Rome dont on jouit, ‘une des plus belles vues qu’il y ait au monde’. Mais si l’on consulte la correspondance, il ne reste comme trace épistolaire du premier séjour en mars qu’une seule lettre, à sa sœur Nancy et datée du 25 ; il n’y est question ni de Rome ni de ce qu’il y fait, mais seulement de son désespoir de ne point recevoir de nouvelles de sa fiancée Camille Moke, et de ses velléités d’aller prendre du service ailleurs en Italie avec quelque bande de brigands… (CG no. 213). Il faudra attendre l’arrêt à Nice pour recueillir plus de détails d’une longue lettre à tous ses amis à Paris (CG no. 223, 6 mai) : Berlioz arrive à Rome en pleine fièvre politique, les Transteverini ‘supposant que les Français à l’Académie sont partisans de la révolution et hostiles au pape, voulaient tout simplement mettre le feu à l’Académie et nous égorger tous’ mais heureusement le mouvement tourne court (cf. aussi CG no. 216). Ces derniers détails manquent dans les Mémoires, mais par contre il y a concordance entre les sources sur l’accueil sympathique que Berlioz reçoit de ses camarades à la Villa Medici, de son directeur Horace Vernet et sa famille, ainsi que de sa rencontre avec Mendelssohn, ‘une des capacités musicales les plus hautes de l’époque. C’est lui qui a été mon cicerone ; tous les matins, j’allais le trouver, il me jouait une sonate de Beethoven, nous chantions Armide de Gluck, puis il me conduisait voir toutes les fameuses ruines qui me frappaient, je l’avoue, très peu’ (CG no. 223). Berlioz avouera par la suite avoir été peu impressionné par les ruines antiques de Rome : ‘On se familiarise bien vite avec les objets qu’on a sans cesse sous les yeux, et ils finissent par ne plus éveiller dans l’âme que des impressions et des idées ordinaires’ (Mémoires, chapitre 36).
Les lettres d’Italie abondent en descriptions, mais elles sont pour la plupart de paysages et de curiosités qui se trouvent en dehors de Rome. Par exemple on n’y relève que quelques brèves allusions à l’église de Saint-Pierre, et aucune description (CG nos. 238, 244, 258). Ce n’est que de retour à Paris qu’il laisse percer son enthousiasme, non pour la musique indigne qu’on y joue, mais pour l’édifice : ‘Saint-Pierre me faisait aussi toujours éprouver un frisson d’admiration. C’est si grand, si noble, si beau, si majestueusement calme !!! J’aimais à y passer la journée pendant les intolérables chaleurs d’été’ (CM I p. 91, publié en mai 1833, et repris plus tard dans les Mémoires, chapitre 36). ‘A peine arrivé, je cours à Saint-Pierre... immense ! sublime ! écrasant !... voilà Michel-Ange, voilà Raphaël, voilà Canova ; je marche sur les marbres les plus précieux, les mosaïques les plus rares... Ce silence solennel... cette fraîche atmosphère... ces tons lumineux si riches et si harmonieusement fondus...’ (CM I p. 319, publié en juillet 1834, et repris plus tard dans les Mémoires, chapitre 39). De même pour le Colisée, qu’il ne voyait ‘jamais de sang-froid’ mais qui n’est pas mentionné dans les lettres. Les lettres sont également muettes sur la Chapelle Sixtine, mais on sait par ailleurs qu’il n’en appréciait ni la musique ni les fresques (Mémoires, chapitres 39 et 50).
L’impression favorable que lui fait Rome au moment de son arrivée ne dure pas longtemps. ‘Rome est la ville la plus stupide, la plus prosaïque que je connaisse. On n’y vit pas si on a une tête et un cœur, il n’y faut que des sens externes’ écrit Berlioz à Gounet en juin 1831, de retour à Rome après son aventure niçoise (CG no. 231). L’impression que donne sa correspondance de son séjour à Rome est presque uniformément négative, et n’est pas contredite par les Mémoires. Même avec le recul du temps Berlioz avoue qu’à Rome il était ‘méchant comme un dogue à la chaîne’, en proie à un ennui perpétuel. ‘Qu’on y joigne l’influence accablante du sirocco, le besoin impérieux et toujours renaissant des jouissances de mon art, de pénibles souvenirs, le chagrin de me voir, pendant deux ans, exilé du monde musical, une impossibilité inexplicable, mais réelle de travailler à l’Académie, et l’on comprendra ce que devrait avoir d’intensité le spleen qui me dévorait’ (Mémoires, chapitre 36). Il consacre même un chapitre entier à l’analyse de ce mal étrange, qui le mine depuis son enfance et refait surface au cours de son séjour à Rome (chapitre 40). Le mot ‘ennui’ revient constamment dans la correspondance : à la Villa Medici il n’a ‘pas une idée, pas une sensation ; l’ennui y a établi sa demeure, et son sceptre de plomb me paraît cent fois plus lourd qu’ailleurs ; j’essaie quelquefois de descendre à Rome, mais je m’y ennuie encore davantage ; point de spectacle, pas l’ombre de musique, point de cabinet littéraire, des cafés sales, obscurs, mal servis, sans journaux ; dans le pays de marbre on vous sert sur de petits vilains guéridons de bois comme celui qui est à la cuisine pour porter la lampe. Tout y est à cent cinquante ans en arrière de la civilisation, et en général dans toute l’Italie’ (CG no. 232). Par contre quand il s’évade à Subiaco en juillet ‘je défie l’ennui, qui me tourmente si fort quelquefois’ (CG no. 236), mais à son retour ‘l’ennui m’a repris comme jamais il ne s’en était encore avisé ; habitué à une vie morale extrêmement active, je me trouve cloué dans un pays où il n’y a ni livres, ni musique, ni spectacles’ (CG no. 238). Quand en octobre son voyage à Naples va prendre fin ‘nous irons nous endormir à Rome du triste et lourd sommeil de l’ennui’ (CG no. 246).
Pour Berlioz le premier défaut de Rome, c’est qu’il s’y trouve contre son gré et qu’il ne peut en sortir que de temps en temps par manque d’argent : ‘Je reviens à Rome quand je n’ai plus d’argent. C’est cette irrésistible raison qui m’y retient encore depuis quinze jours’ (CG no. 264, 4 ou 5 mars 1832). Rome, c’est la contrainte face à la liberté dont il ne peut jouir qu’en s’échappant en Italie. Or, pour Berlioz, ‘tout lien obligé, tout frein apparent, tout ce qui attente le moins du monde à ma liberté, m’est absolument insupportable’, comme il le dit à son père dans une lettre où il évoque l’humiliation qu’il ressent à devoir dépendre du soutien financier de ses parents (CG no. 262, 18 février 1832). La Villa Medici, lieu de séjour privilégié pour un petit groupe de pensionnaires d’élite, n’est à ses yeux qu’une ‘sotte caserne’ d’où il est heureux de pouvoir s’évader (très souvent dans les lettres : CG nos. 231, 234, 249, 266, 267, 270).
L’autre défaut de Rome, c’est de ne pas être Paris. Paris est alors la seule ville capitale qu’il connaisse directement : il n’a pas encore vu Berlin, Vienne, St Pétersbourg, ou Londres. Paris à cette époque n’est pas encore devenue pour lui la ‘ville barbare’ qu’il fustigera sans ménagement par la suite, mais sans jamais parvenir à rompre ses liens avec elle. Son voyage en Italie fera prendre conscience à Berlioz de tout ce qu’il attend d’une ville capitale : Paris, ce sont des orchestres, des salles de concert, des scènes lyriques et des musiciens de premier ordre, mais aussi des théâtres, des bibliothèques, des librairies, des cafés où l’on rencontre une foule d’amis et de connaissances, ‘les hommes intelligents qui s’y trouvent, le tourbillon d’idées dans lequel on se meut’ (CG no. 1028, 13 mars 1846). Rome n’a rien de cela. ‘Malheureusement je suis forcé de vivre dans un pays où le dieu que je sers est inconnu. Si jamais Rome fut le pays de la musique, on peut dire aujourd’hui avec vérité : Rome n’est plus dans Rome. […] Il faut sortir de Paris pour sentir son immense supériorité en tout et une fois en Italie, il faut renoncer à la plupart des jouissances intellectuelles qui font le charme de notre capitale’ écrit-il à son grand-père (CG no. 240, 15 septembre 1831). Le ‘fameux café Greco […] la plus détestable taverne qu’on puisse trouver’ mais où les visites le soir sont de rigueur (Mémoires, chapitres 33, 36) ne peut soutenir la comparaison avec le Café du Cardinal ou le Café de la Bourse (CG no. 231). À Rome Berlioz souffre autant d’être privé de littérature que de musique : en voyage comme à Paris, Berlioz est un lecteur insatiable. En décembre il écrit à Victor Hugo : ‘Songez que je suis à Rome, exilé, pour deux ans, du monde musical, par un arrêt académique confirmé par le besoin de la pension de grand prix, que je meurs par défaut d’air, comme un oiseau sous le récipient pneumatique, dépourvu de musique, de poésie, de théâtres, d’agitations, de tout, puis figurez-vous qu’après six mois d’attente j’ai fini par obtenir Notre-Dame de Paris, que je viens de la lire au milieu des pleurs et des grincements de dents, et vous concevrez que je vous écrive’ (CG no. 254, cf. 231).
Tout conspire donc à alimenter dans l’esprit de Berlioz un véritable part-pris contre tout ce qui se rapporte à Rome. À Tivoli ‘le peuple y est très beau mais encore plus mendiant qu’à Rome ; toutefois leur mendicité n’a pas le caractère de bassesse repoussante de celle des Romains’ (CG no. 232, 24 juin 1831). Quand il arrive à Subiaco pour la première fois il s’écrie : ‘Ah ! béni soit le ciel de Subiaco et maudit soit le ciel de plomb de Rome qui brûle toujours et n’a ni tonnerre ni éclairs !’ (CG no. 236, 10 juillet). On ne trouve pas de livres à Rome, mais ‘passe encore à Florence où il y a un magnifique cabinet littéraire’ (CG no. 231, 14 juin). L’agitation de Naples le séduit : ‘Comme tout cela diffère de Rome, de ses habitants endormis, de son sol nu, dépouillé, inculte et désert !’ (CG no. 244). Dans le récit du voyage en Campanie qu’il donne à Mme Lesueur en janvier 1832, il affiche son dédain pour Rome (CG no. 258) :
Voilà une ville, Naples ! c’est du bruit, de l’éclat, du mouvement, de la richesse, de l’activité, des théâtres ; c’est tout ce qui nous manque ici et plus encore. Il n’y a pas il est vrai ce fantôme de grandeur qui assombrit la physionomie de Rome et semble couvrir d’un crêpe la désolée campagne qui l’enceint de toutes parts. […] Mais il y a un VÉSUVE, une grande et superbe mer, des îles ravissantes, un golfe de Baya rempli de souvenirs Virgiliens qui me vont au moins aussi bien que la poudre tumulaire et la cendre des empereurs. […] Deux êtres organisés absolument de la même manière ne peuvent que s’ennuyer ensemble ; voilà pourquoi Rome m’assomme.
À l’époque du séjour de Berlioz, la Villa Medici était placée depuis 1828 sous la direction du peintre Horace Vernet (1789-1863) ; grâce à Vernet et à sa famille – sa femme, son grand-père Carle, sa fille Louise – l’ambiance de la ‘sotte caserne’ était en fait particulièrement sympathique et accueillante. ‘[Ses] rapports avec nous étaient plutôt d’un excellent camarade que d’un sévère directeur’, écrira Berlioz plus tard (Mémoires, chapitre 36), et il n’aura qu’à se féliciter de l’indulgence dont Vernet fait preuve d’un bout à l’autre du séjour de son difficile pensionnaire. Vernet lui donnera même permission de quitter Rome des mois à l’avance, à condition de ne pas se montrer à Paris avant la fin de l’année, ce qui évitera à Berlioz la tentation peu honorable de faire un ‘tour de passe-passe’ au directeur (CG nos. 249, 255, 261).
Dans la famille Vernet tout le monde aime la musique ; Carle adore Gluck, Louise chante et joue du piano. Berlioz dresse le portrait d’Horace Vernet : ‘C’est un petit homme sec, d’une tournure élégante, obligeant mais sensible, fils respectueux, aimant sa fille comme un frère, et sa femme comme un oncle, gagnant vingt mille frances en 8 jours, tirant le pistolet et l’épée comme Saint-Georges, admirable tambour dansant la tarantelle avec sa fille à faire s’écrouler le salon d’applaudissements, raide et sec, bon et franc, aimant Gluck et Mozart et détestant l’Académie. Il y a beaucoup de bon là-dedans’ (CG no. 224). De même pour son père Carle : ‘C’est ce soir la fête de notre directeur, il y aura grand bal, le père Carle va me reprendre pour parler de Gluck ; il est si content que je ne sois pas comme mon prédécesseur qui trouvait tout cela rococo ! C’est un homme singulier, qui passe la moitié de la journée à courir à cheval (car il ne peint plus) et le reste du temps à faire des calembours et à se tourmenter de la santé de son fils, qu’il aime comme les vieillards n’aiment guère’ (CG no. 232). Si Berlioz exprime au départ des réserves sur le talent de cantatrice de Louise Vernet (CG no. 232), elle et sa mère éprouvent bien vite une vive sympathie pour le jeune compositeur, comme en témoigne Ernest Legouvé, de passage à la Villa Medici en 1832 peu après le départ de Berlioz. ‘Il venait de la quitter et y laissait le souvenir d’un artiste de talent, d’un homme d’esprit mais bizarre et se plaisant à l’être ; on prononçait volontiers à son sujet le mot de poseur. Mme Vernet et sa fille le défendaient et le vantaient beaucoup ; les femmes sont plus perspicaces que nous à deviner les hommes supérieurs’ (Soixante ans de souvenirs, chapitre 16 ; Mme Vernet fournira à Legouvé une lettre de recommendation à Berlioz). Sympathie partagée par Berlioz, qui peu après son départ définitif de Rome écrit : ‘Je passais toutes mes soirées chez M. Horace, dont la famille me plaît beaucoup, et qui, à mon départ, m’a donné toutes entières des marques d’attachement et d’affection, auxquelles j’ai été d’autant plus sensible que je m’y attendais moins. Mlle Vernet est toujours plus jolie que jamais, et son père toujours plus jeune homme’ (CG no. 270, 13 mai 1832). De retour en France il s’en prend à regretter déjà son séjour romain, et de La Côte-Saint-André il écrit en juillet à Mme Vernet : ‘J’étouffe par défaut de musique ; je n’ai plus à espérer le soir le piano de Mlle Louise, ni les sublimes adagios qu’elle avait la bonté de me jouer, sans que mon obstination à les lui faire répéter pût altérer sa patience ou nuire à l’expression de son jeu. […] J’aurais bien voulu envoyer à Mlle Louise quelque petite composition dans le genre de celles qu’elle aime ; mais ce que j’avais écrit ne me paraissant pas digne d’exciter le sourire d’approbation du gracieux Ariel, j’ai suivi le conseil de mon amour-propre et je l’ai brûlé’ (CG no. 282). On sait que la première exécution de la Captive sera donnée à la Villa Medici par Louise Vernet, et que Berlioz lui dédiera en 1833 la première version qu’il publiera de cette mélodie (Holoman no. 60C). Deux ans plus tard il dédie à Horace Vernet la cantate le Cinq mai (Holoman no. 74). Une lettre de Horace Vernet à Berlioz l’en remercie, tardivement certes, mais Vernet voulait d’abord entendre une exécution de l’ouvrage : ‘Il y déjà longtemps que j’ai reçu la musique que vous avez bien voulu me dédier. Il y a donc longtemps que je devrais vous avoir remercié ; mais je ne voulais le faire qu’en joignant à l’expression de ma gratitude pour votre bon souvenir, celle de mon admiration pour cette dernière production de votre vigoureux génie, dont le sujet, il faut le dire aussi, est si digne de lui’ (CG no. 730ter, 28 août 1840). Une lettre de Berlioz à un correspondant anonyme datant de la fin de 1835 apprend que le thème du refrain de cette cantate sur la mort de Napoléon fut composé à l’improviste au cours d’une promenade le long du Tibre (CG no. 449). Plus de vingt ans plus tard cette même information est confiée au lecteur au hasard d’une digression dans un feuilleton (Journal des Débats, 23 juillet 1861, repris dans À Travers chants). On se souviendra que Berlioz avait songé avant de quitter l’Italie à aller visiter l’île d’Elbe et la Corse sur les traces de l’empereur.
Sa toute première impression des autres pensionnaires de l’Académie est bonne : ‘Tous les camarades qui m’attendaient m’ont reçu avec la cordialité la plus franche’ (CG no. 223, 6 mai). Mais dès son retour de Nice il s’impatiente : ‘Je suis environné, dans ma maudite caserne, d’être vulgaires, sans âme d’artistes dont la société et le bourdonnement m’impatientent horriblement ; il y a deux ou trois exceptions tranchées, mais c’est tout’ (CG no. 231, 14 juin). ‘Il faut que je redevienne seul ; je m’aperçois que ces messieurs de l’Académie, avec lesquels du reste je sympathise très peu, m’observent avec malignité et contrôlent toutes mes actions ; il faut pour ne pas leur paraître maniéré (c’est leur mot) se façonner à leurs manières de sentir, de voir, de parler […] en un mot, il faut être tout autre que je ne suis’ (CG no. 233, 3 juillet). ‘L’air que je partage avec les industriels de l’Académie ne plaît pas à mes poumons ; je vais en respirer un plus pur’ (CG no. 234, même jour).
Mais Berlioz force sans doute la note : une fois hors de Rome il se détend. Peu après il écrit de Subiaco : ‘Il y a dans la maison où je suis plusieurs paysagistes français, venus pour copier la belle nature de Subiaco ; nous dînons ensemble, l’un d’eux est un de mes camarades de l’Académie’ (CG no. 236, 10 juillet). Plus loin la lettre précise le nom de ce dernier : c’est le paysagiste Jean-Baptiste Gibert, à propos duquel Berlioz écrira bientôt la nouvelle Vincenza, parue d’abord en 1833 (CM I p. 94-7), reprise ensuite dans le Voyage de 1844 puis finalement dans les Soirées de l’orchestre. Un autre peintre résidant à Subiaco, Isidore Flacheron, est mentionné dans les Mémoires (chapitres 37, 38, 41) : ami du Crispino rendu célèbre par Berlioz, il épousera une belle italienne de Subiaco ; Berlioz le reverra à Lyon en 1845 et lui enverra un exemplaire de son Voyage musical où il est mentionné (CG no. 987). En octobre c’est en compagnie de deux autres pensionnaires, l’architecte Dufeu et le sculpteur Dantan, qu’il fait le voyage à Naples (Mémoires, chapitres 40-41) ; un médaillon de Berlioz à Rome est l’œuvre de ce dernier (cf. CG no. 223), et les deux hommes auront quelques rapports par la suite.
Même à Rome Berlioz peut être bon vivant avec ses camarades, d’autant plus qu’il reconnaît ‘à la louange de mes commensaux de l’Académie, que leur goût musical était des moins vulgaires’ ; le soir au clair de lune il chante avec eux des mélodies ou chœurs de Weber, Gluck, Spontini ou Mozart (Mémoires, chapitre 36). Il raconte ensuite certains concerts improvisés à la Villa Medici après dîner avec quelques camarades (le récit doit se placer avant septembre 1831) : il nomme Dantan, (Alexandre) Montfort, (Émile) Signol, l’auteur présumé du portrait officiel de Berlioz à la Villa Medici, et ‘le spirituel et savant architecte’ Duc. De Montfort, second grand prix de Rome en 1830, Berlioz n’a qu’une piètre opinion : il ironisera plus tard sur ses opéras comiques dans ses feuilletons (Journal des Débats 19 juin 1839 ; 7 mai 1853 ; 19 octobre 1855). Bien autre est (Joseph-Louis) Duc, avec qui Berlioz sympathise très vite : il l’initie à Beethoven, et quand Duc repart pour Paris en septembre Berlioz lui donne une lettre de recommendation pour François Réty, fontionnaire au Conservatoire. Duc dira à Réty ‘qu’il est extrêmement avide d’entendre les ouvrages de Beethoven, et qu’à ma recommendation il espère que vous voudrez bien lui en faciliter les moyens dans le cas où il y aurait toujours autant de difficultés à se procurer des billets. C’est un homme fort aimable’ (CG no. 239). Il ressort d’une lettre à Hiller quelques jours plus tard (CG no. 241) que Berlioz a aussi remis en confiance à Duc un paquet pour une mission délicate : Duc ‘s’est chargé de remettre à notre Sainte Vierge [c’est-à-dire Camille Moke !] un paquet contenant ses présents, ses lettres d’amour, son anneau, etc…’ Duc et Berlioz resteront par la suite très liés et se verront souvent à Paris, comme leur correspondance l’indique (CG no. 900 : ‘un de mes anciens camarades de Rome (Duc l’architecte de la colonne de la Bastille), un grand amateur de musique’). De Londres en mai 1848 Berlioz lui dédie un arrangement de l’Apothéose de la Symphonie funèbre et l’entretient longuement de sa situation (CG no. 1200 : ‘Je t’assure que je regrette bien souvent nos charmantes causeries sans gêne et sans prétentions, le soir, chez Mme Vanderkelle’). On connaît l’histoire des origines de l’Adieu des bergers à la Sainte-Famille, improvisé par Berlioz au coin du feu un soir dans un salon en présence de Duc, et attribuée malicieusement au compositeur imaginaire ‘Pierre Ducré, maître de musique de la Sainte-Chapelle’ (la supercherie est racontée en détail dans CG no. 1485, 15 mai 1852 ; repris dans les Grotesques de la musique). Duc assiste plus tard à la première exécution de l’Enfance du Christ en décembre 1854, et fait allusion aux origines de l’ouvrage dans une lettre à Marie Berlioz (citée dans CG IV p. 636 n. 4).
Outre les pensionnaires de l’Académie, Rome est un lieu de rencontre pour nombre de visiteurs étrangers, musiciens et autres. La rencontre la mieux connue est celle de Berlioz et Mendelssohn. Moins connue est celle de Berlioz et Glinka : Berlioz n’y fait allusion que plus tard, dans un feuilleton de 1845 (Journal des Débats, 16 avril 1845). Elle ne porte fruit que quand les deux compositeurs se revoient à Paris et conçoivent une estime réciproque. On remarquera qu’au cours de son séjour Berlioz ne rencontre pas de compositeurs italiens, et même qu’il s’y refuse. Dans une lettre à Hiller datant de son dernier passage à Florence (CG no. 270, 13 mai 1832) Berlioz dit s’attendre à revoir à Milan le compositeur Josef Dessauer, ‘homme de talent’ qu’il a rencontré à Rome : ‘Il connaît beaucoup Mendelssohn et Bellini. Il veut absolument me lier avec Bellini, ce que je refuse de toutes mes forces ; la Sonnambula, que j’ai vue hier, redouble mon aversion pour une pareille connaissance. Quelle partition !!! Quelle pitié !!! ’ Le seul compositeur italien vivant pour lequel Berlioz a une admiration sans partage, c’est Spontini, alors à Berlin, auquel il écrit le 29 mars peu avant son départ de Rome : ‘Mes observations musicales dans les parties de l’Italie que j’ai parcourues sont loin d’être à l’avantage du « bel paese » : je n’y ai trouvé qu’enfantillage, mesquinerie, imitation servile, platitude, défaut absolu de grandes pensées et de génie. J’ai vu de pauvres exécutants incapables, de malheureux maestri ignorants, et les uns et les autres tellement persuadés de leur supériorité sur le reste de l’Europe qu’ils n’excitaient plus en moi que le sourire de la pitié’ (CG no. 268). Les autres dieux de Berlioz sont morts, et ils sont tous allemands : Gluck, Beethoven, et Weber.
Dans la carrière de Berlioz, son séjour en Italie est une période-charnière : il retrouve son équilibre après le choc de la trahison de Camille Moke sa fiancée, cherche sa voie et réfléchit sur son avenir. Les lettres datant de son séjour abondent en réflexions sur toute sorte de thèmes: la vie et la mort (CG nos. 211, 216, 223), son besoin d’amitié (CG no. 225), sa quête de sensations nouvelles (CG no. 238), le rôle du poète (CG no. 240), l’inexistence du beau absolu (CG no. 256), le mariage (CG nos. 219, 229, 261, 262, 264), l’éducation et l’enseignement des langues (CG no. 262), la politique (CG nos. 213, 216, 233, 255, 257, 266), Napoléon (CG nos. 216, 223, 229, 230, 244, 265, 266), et même le saint-simonisme (CG no. 237). Au terme de son séjour, il établit un constat : ‘Depuis que j’ai recouvré ma liberté morale, j’ai appris à l’apprécier. Mon isolement même, mon exil en Italie, la privation des jouissances de mon art, la raréfaction de mon atmosphère intellectuelle, en me jetant dans la vie sauvage, m’ont fait sentir tout le charme de la liberté physique absolue’ (CG no. 264, 4 ou 5 mars 1832).
Berlioz a relativement peu composé enItalie, comme il le souligne au cours de son séjour et par la suite (CG no. 256 ; Mémoires, chapitre 39) ; de ce qu’il a écrit très peu a été entièrement composé à Rome (sauf l’étonnante Méditation religieuse (Holoman no. 56) ‘composée à Rome, un jour que je mourais du spleen’). L’ouverture du Roi Lear (Holoman no. 53) est écrite à Nice, l’ouverture de Rob-Roy (Holoman no. 54), commencée à Nice est achevée à Subiaco, le Mélologue (Holoman no. 55), commencé pendant le retour de Nice est bien achevé à Rome, mais utilise largement de la musique déjà écrite, et la mélodie la Captive (Holoman no. 60) est le résultat d’une visite à Subiaco en février 1832 (CG nos. 261, 264-6). On y ajoutera le Quartetto e coro dei maggi (Holoman no. 59) qui réutilise peut-être de la musique composée plus tôt, et deux œuvres perdues (Holoman nos. 57 et 58). Selon les Mémoires, ‘l’atmosphère anti-harmonique’ de Rome le rend incapable de composer. Par contre il échafaude en Italie de grands projets qui, s’ils n’aboutissent pas, laissent sans doute des traces dans des compositions ultérieures : entre autres un oratorio sur le Dernier Jour du monde qui annonce le Requiem (Holoman no. 61), et, d’après un carnet d’esquisses de 1832-1836 (Holoman no. 62), une Symphonie militaire sur le retour de l’armée Italie, qui annonce la Symphonie funèbre et triomphale. L’idée en est suggérée par son passage à Lodi sur la route du retour, et Berlioz y fait allusion dans une lettre du 25 mai 1832 (CG no. 273) : ‘Quelles superbes et riches plaines que celles de la Lombardie ! Elles ont réveillé en moi des souvenirs poignants de nos jours de gloire, "comme un vain songe enfui"’. On se souviendra que la même inspiration napoléonienne se retrouve dans la cantate le Cinq mai, écrite en partie à Rome.
À l’approche de son départ, Berlioz semble devenir plus sensible aux beautés de Rome. Le 20 mars il écrit à sa mère : ‘Je compte les jours qui me restent encore à passer dans cette sotte caserne. Je reverrai Rome avec plaisir pour ses sublimes plaines et ses délicieuses montagnes, mais alors je serai libre et aujourd’hui je ne le suis pas, alors une absence forcée ne me rendra pas malade de besoin de musique, je viendrai au contraire m’y délasser, comme dans un beau jardin, que j’apprécierai bien mieux’ (CG no. 266). En fait Berlioz ne reviendra jamais à Rome ni en Italie. Resteront les souvenirs, littéraires d’abord, musicaux ensuite. Dès 1833 il entreprend une série d’articles sur ses expériences italiennes, qui fourniront la matière au Voyage musical de 1844, et de là aux Mémoires. Au fil des ans on retrouvera aussi de nombreux souvenirs de ses expériences italiennes dans une série de grands ouvrages, d’Harold en Italie à Béatrice et Bénédict en passant par Benvenuto Cellini, Roméo et Juliette et les Troyens. Au cours de son voyage il a reçu beaucoup ‘de ces impressions de la nature dont les artistes font provision et qui s’extravasent ensuite de leur âme’ (Mémoires, Postface, à propos du duo nocturne de Béatrice et Bénédict). On pourrait citer à ce propos une autre réflexion de Berlioz, dans une lettre du 10 septembre 1855 à Richard Wagner (CG no. 2014) : ‘Cela doit être superbe d’écrire en présence de la grande nature !… Voilà encore une jouissance qui m’est refusée ! Les beaux paysages, les hautes cimes, les grands aspects de la mer, m’absorbent complètement au lieu de provoquer chez moi la manifestation de la pensée. Je sens alors et je ne saurais exprimer. Je ne puis dessiner la lune qu’en regardant son image au fond d’un puits.’
Quel autre Prix de Rome en musique pourrait se vanter d’avoir laissé des traces aussi éblouissantes de son séjour en Italie ?
![]()
Site Hector Berlioz créé par Michel Austin et Monir Tayeb le 18 juillet 1997; les pages Berlioz en Italie créées le 7 décembre 2003; cette page ajoutée le 1er février 2015.
© Michel Austin et Monir Tayeb. Tous droits de reproduction réservés.
Avertissement: Tous droits de publication et de reproduction des textes, photos, images, et partitions musicales sur l’ensemble de ce site, y compris leur utilisation sur Internet, sont réservés pour tous pays. Toute mise en réseau, toute rediffusion, sous quelque forme, même partielle, est donc interdite.