Par
HECTOR BERLIOZ
VI.
Préjugés grotesques. — Les athées de l’expression. — Mme Stoltz, Mme Sontag. Les millions. — Heur et malheur.
Les dilettanti du grand monde. Le poëte et le cuisinier. — Les bois d’orangers, le gland et la citrouille.
Les passades. — Sensibilité et laconisme. Une oraison funèbre en trois syllabes.
Le préjugé, chez nous, dit beaucoup plus qu’ailleurs d’énormes sottises, et voudrait du haut de son insolence régenter toutes les parties de l’art musical. Sans relever ce qu’il dit de l’harmonie, de la mélodie, du rhythme, à en croire l’une de ses assertions outrecuidantes, il n’y aurait qu’une seule forme à donner aux textes destinés au chant ; il serait impossible de chanter de la prose ; les vers alexandrins seraient les pires de tous pour le compositeur. Enfin certaines gens soutiennent que tous les vers destinés au chant doivent être, sans exception, ce qu’on appelle des vers rhythmiques, c’est-à-dire scandés d’une façon uniforme du commencement à la fin d’un morceau, ayant chacun un nombre égal de syllabes longues et brèves placées aux mêmes endroits.
Quant à faire de la musique sur de la prose, rien n’est plus facile ; il s’agit seulement de savoir sur quelle prose. Les illustres chefs-d’œuvre de l’art religieux, messes et oratorios, ont été écrits par Haendel, Haydn, Bach, Mozart, sur de la prose anglaise, allemande et latine. « Oui, dit-on, cela se peut en latin, en allemand et en anglais, mais c’est impraticable en français. » On appelle toujours chez nous impraticable ce qui est impratiqué. Or ce n’est pas même impratiqué ; il y a de la musique écrite sur de la prose française, et il y en aura tant qu’on voudra. Dans les opéras les plus célèbres on entend chaque jour des passages où les vers de l’auteur du livret ont été disloqués par le compositeur, brisés, hachés, dénaturés par la répétition de certains mots et par l’addition même de certains autres, de telle sorte que ces vers sont devenus en réalité de la prose, et cette prose se trouve convenir et s’adapter à la pensée du musicien que les vers contrariaient.
Cela se chante pourtant sans peine, et le morceau de musique n’en est pas moins beau comme musique pure ; et la mélodie se moque de vos prétentions à la guider, à la soutenir par des formes littéraires arrêtées à l’avance par un autre que le compositeur.
Un librettiste critiquait violemment devant moi les vers d’un opéra nouveau :
« Quels rhythmes ! » disait-il, « quel désordre ! C’est comme de la prose. Ici un grand vers, là un petit vers, aucune concordance dans la distribution des accents, les longues et les brèves jetées au hasard ! quel tohu-bohu ! Faites donc de la musique là-dessus ! »
Je le laissai dire. Quelques jours plus tard, en me promenant avec lui, je chantais, mais sans paroles, une mélodie qui paraissait le charmer :
« Connaissez-vous cela? lui dis-je.
— Non, c’est délicieux ; cela doit être de quelque opéra italien, car les Italiens au moins savent faire des paroles qui n’empêchent pas de chanter.
— C’est la musique des vers que vous trouviez si antimélodiques l’autre jour. »
Combien de fois ne me suis-je pas amusé à faire tomber dans le même piége des partisans de l’emploi exclusif des vers rhythmiques en leur chantant au contraire une mélodie à laquelle j’avais adapté des paroles italiennes ; puis, quand mes auditeurs s’étaient bien évertués à prouver l’heureuse influence de la coupe des vers italiens sur l’inspiration du compositeur, je soufflais sur leur enthousiasme, en leur apprenant que la forme des vers ne pouvait en aucune façon avoir, en ce cas, déterminé celle de la mélodie, puisque le chant qu on venait d’entendre appartenait à une symphonie de Beethoven et qu’il avait par conséquent été écrit sans paroles.
Ceci ne veut point dire que les vers rhythmiques ne puissent être excellents pour la musique. Bien plus, j’avouerai qu’ils sont fort souvent indispensables. Si le compositeur a adopté pour son morceau un rhythme obstiné dont la persistance même est la cause de l’effet, tel que celui du chœur des démons dans l’Orphée de Gluck :
Quel est l’audacieux
Qui dans ces sombres lieux,
il est bien évident que cette forme doit se retrouver dans les vers, sans quoi les paroles n’iraient pas sur la musique.
Si plusieurs strophes différentes sont destinées à être chantées successivement sur la même mélodie, il serait fort à désirer également qu’elles fussent toutes coupées et rhythmées de la même façon ; on empêcherait ainsi les fautes grossières de prosodie produites nécessairement par la musique sur les couplets qui ne sont point rhythmés comme le premier, ou l’on éviterait au compositeur soigneux l’obligation de corriger ces fautes en modifiant sa mélodie pour les diverses strophes, lorsqu’il a tout intérêt à ne pas la modifier.
Mais dire que dans un air, dans un duo, dans une scène où la passion peut et doit s’exprimer de mille façons diverses et imprévues, il faut absolument que les vers soient uniformément coupés et rhythmés, prétendre qu’il n’y a pas de musique possible sans cela, c’est prouver clairement tout au moins qu’on n’a pas d’idée de la constitution de cet art ; et l’application de ce système par les poëtes italiens, en mainte occasion où la musique la repousse, n’a sans doute pas peu contribué à donner à l’ensemble des productions musicales de l’Italie l’uniformité de physionomie qu’on a le droit de lui reprocher.
Quant à la prévention contre les vers alexandrins, prévention que beaucoup de compositeurs partagent, elle est d’autant plus étrange, que ni poëtes ni musiciens ne manifestent d’aversion pour les vers de six pieds. Or, qu’est-ce qu’un vers alexandrin coupé en deux par l’hémistiche, sinon deux vers de six pieds qui ne riment pas ? Et que fait la rime, je vous prie, au développement d’une période mélodique ?... Bien plus, il arrive souvent que ces poëtes, compteurs si rigoureux de syllabes, croyant faire deux vers de six pieds, font un abominable vers de treize pieds, faute de tenir compte de la non-élision de la fin du premier vers avec le commencement du second. Telle fut la maladresse commise par l’auteur des paroles du Pré aux Clercs, quand Hérold lui demanda des vers rhythmiques (il en fallait là) de six pieds pour un de ses plus jolis morceaux :
C’en est fait, le ciel même
A reçu leurs serments.
Sa puissance suprême
VIENT d’unir deux amants.
L’ensemble des deux premiers vers, grâce à l’élision qui les unit, fait bien douze syllabes pour le musicien, mais l’ensemble des deux autres en forme évidemment treize, l’élision ne pouvant avoir lieu entre suprême et vient, et il résulte de cette syllabe surnuméraire l’obligation d’ajouter dans la musique une note qui dérange l’ordonnance de la phrase et produit un petit soubresaut des plus disgracieux. Voilà de la barbarie !
Dans un livre très-bien fait sous plusieurs rapports, intitulé Essai de rhythmique française, M. Ducondut a prouvé fort catégoriquement, que malgré le préjugé qui existe contre ses aptitudes à cet égard, la langue française pouvait se prêter sans peine à toutes les formes de vers et à toutes les divisions rhythmiques, et que si on n’avait pas fait jusqu’à présent usage des formes qu’il croit indispensables à la musique, il fallait s’en prendre aux poëtes et non pas accuser l’insuffisance de la langue. Les exemples qu’il donne de vers rhythmiques de toutes sortes démontrent avec évidence sa théorie. Mais cette théorie, admettant comme une nécessité absolue de la poésie lyrique l’emploi des règles qu’elle donne, est en soi radicalement fausse, je le répète. La musique est en général insaisissable dans ses caprices, alors même qu’elle semble le moins en avoir ; et hors les cas exceptionnels dont j’ai parlé tout à l’heure, il est parfaitement insensé de prétendre n’employer pour le chant que des vers rhythmiques,. et de croire que la cadence monotone de vers ainsi faits facilitera la composition de la mélodie en lui imposant à l’avance une forme invariable ; car si la mélodie n’avait pas fort heureusement mille moyens de s’y dérober, ce serait en réalité précisément le contraire.
« La musique, dit M. Ducondut, procède par phrases, qui se composent de mesures égales entre elles et dont chacune se divise elle-même en temps forts et en temps faibles ; elle a ses notes frappées et levées, avec ses points de repos ou cadences ; et le retour régulier de toutes ces choses, dans les membres correspondants de la période mélodique, constitue, avec la carrure des phrases, le rhythme musical. La poésie qui prétend s’allier à la musique est tenue de se conformer à cette marche... etc., sans quoi il y a désaccord entre les deux arts associés. » Sans doute, mais cette marche de la musique est fort loin d’avoir la régularité absolue que vous lui attribuez et qui existe dans vos vers. Une mesure est égale à une autre mesure ; égale en durée, je le veux bien, mais cette durée est inégalement partagée. Dans celle-ci, je n’emploierai que deux notes qui porteront deux syllabes ; dans la suivante j’en écrirai quatre ou six ou sept qui pourront porter quatre ou six ou sept syllabes si je le veux, ou une seule syllabe, s’il me plaît que la série de notes soit vocalisée. Que devient alors votre rhythme poétique établi à si grand-peine ? La musique le détruit, le broie, l’anéantit. La poésie est esclave du rhythme qu’elle s’est imposé, la musique, non seulement est indépendante, mais c’est elle qui crée le rhythme et qui, tout en le conservant dans ses éléments constitutifs, peut le modifier de mille manières dans ses détails. Et le mouvement, dont les auteurs de théories poétiques ne parlent jamais et qui seul peut donner au rhythme son caractère, qui est-ce qui le détermine ? C’est le musicien. Car le mouvement est l’âme de la musique, et les poëtes n’ont jamais songé seulement à trouver le moyen de fixer le degré de rapidité ou de lenteur convenu à la récitation de leurs vers.
L’écriture du langage d’aucun peuple n’a les signes indicateurs de la division du temps. La musique (moderne) seule les possède ; la musique peut écrire le silence et en déterminer la durée, ce que les langues parlées ne sauraient faire. La musique enfin, et pour couper court à ces singulières prétentions renouvelées des Grecs qu’élèvent des grammairiens et des poëtes qui ne la connaissent pas, existe par elle-même ; elle n’a aucun besoin de la poésie ; et toutes les langues humaines périraient qu’elle n’en resterait pas moins le plus poétique et le plus grand des arts, comme elle en est le plus libre. Qu’est une symphonie de Beethoven, sinon la musique souveraine dans toute sa majesté ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel est encore le préjugé toujours ranimé à propos de tous les musiciens de style, de la suprématie accordée par eux, dit-on, à la partie instrumentale au détriment de la vocale. Vienne un compositeur qui sait écrire, qui possède son art à fond, qui, par conséquent, sait employer l’orchestre avec discernement, avec finesse, le faire parler avec esprit, se mouvoir avec grâce, jouer comme un gracieux enfant, ou chanter d’une voix puissante, ou tonner, ou rugir ; qui ne va pas, à l’exemple des compositeurs vulgaires, se ruer à coups de pieds, à coups de poing sur les instruments, celui-là, dira-t-on, est un homme d’un grand talent, mais il a mis la statue dans l’orchestre. Et cette niaise critique des opéras de Mozart, faite il y a quatre-vingts ans par le faux bonhomme Grétry, reste et restera longtemps encore infligée comme un blâme par la foule des connaisseurs ou par les connaisseurs de la foule, aux musiciens qui ont le plus de droits à l’éloge contraire. Si quelqu’un avait osé répondre la vérité à Grétry censurant ainsi Mozart, il lui eût dit : « Mozart, à votre avis, a mis le piédestal sur la scène et la statue dans l’orchestre ? Cette comparaison saugrenue pourrait en mainte circonstance n’être pas un blâme, on vous le prouvera ; dans votre bouche elle en est un. Or ce blâme est injuste, la critique porte à faux ; l’orchestre de Mozart est charmant, sinon très-riche de coloris, il est discret, délicatement ouvragé, énergique quand il le faut, parfait ; aussi parfait que le vôtre est délabré, impotent et ridicule.
» Mais la partie vocale de ses opéras n’en est pas moins restée, presque partout, la partie dominante, la scène n’en est pas moins toujours remplie par le sentiment humain, ses personnages n’en chantent pas moins librement et d’une façon dominatrice la vraie phrase mélodique. Ôtez l’orchestre, monsieur Grétry, remplacez-le par un clavecin, et vous verrez, à votre grand regret, j’imagine, que l’intérêt principal de l’opéra de Mozart est resté sur la scène et que son piédestal a autant de traits humains et paraît encore plus beau que toutes vos statues. » Voilà ce qu’on aurait pu répliquer à ce faux bonhomme qui faisait de faux bons mots sur Gluck et sur Mozart. On aurait dû ajouter que si quelques compositeurs ont mis réellement la statue dans l’orchestre, en certains cas, ce sont les Italiens. Oui, ce sont les maîtres de l’école italienne qui, avec autant de bon sens que de grâce, ont les premiers imaginé de faire chanter l’orchestre et réciter les paroles sur une partie de remplissage, dans les scènes bouffes où le canto parlato est de rigueur, et dans beaucoup d’autres même où il serait absolument contraire au bon sens dramatique de faire chanter par l’acteur une vraie mélodie. Le nombre d’exemples que l’on pourrait citer de cet excellent procédé chez les maîtres italiens, depuis Cimarosa jusqu’à Rossini, est incalculable. La plupart des compositeurs français modernes ont eu le bon esprit de les imiter ; les Allemands, au contraire, recourent très-rarement à ce déplacement de l’intérêt musical. Mais ce sont eux précisément que l’on accuse de mettre la statue dans l’orchestre, uniquement parce qu’ils n’écrivent pas des orchestres de bric-à-brac. Ainsi le veut le préjugé.
Le préjugé veut encore, à Paris, qu’un musicien ne soit apte à faire que ce qu’il a déjà fait. Tel a débuté par un drame lyrique, qui sera inévitablement taxé d’outrecuidance s’il prétend écrire un opéra bouffon, seulement parce qu’il a montré des qualités éminentes dans le genre sérieux. Si son coup d’essai a été une belle messe : « Quelle idée, dira-t-on, à celui-ci de vouloir composer pour le théâtre ! Il va nous faire du plain-chant ; que ne reste-t-il dans sa cathédrale ? »
Si le malheur veut qu’il soit un grand pianiste : « Musique de pianiste ! » s’écrie-t-on avec effroi. Et tout est dit, et voilà notre homme à demi écrasé par un préjugé contre lequel il aura à lutter pendant de longues années. Comme si un grand talent d’exécution impliquait nécessairement l’incapacité de composition, et comme si Sébastien Bach, Beethoven, Mozart, Weber, Meyerbeer, Mendelssohn et d’autres n’ont pas été à la fois de grands compositeurs et de grands virtuoses.
Si un musicien a commencé par écrire une symphonie, et si cette symphonie a fait sensation, le voilà classé ou plutôt parqué : c’est un symphoniste, il ne doit songer à produire que des symphonies, il doit s’abstenir du théâtre, pour lequel il n’est point fait ; il ne doit pas savoir écrire pour les voix, etc. Bien plus, tout ce qu’il fait ensuite est appelé par les gens à préjugés : symphonie ; les mots, pour parler de lui, sont détournés de leur acception. Ce qui, produit par tout autre, serait appelé de son vrai nom de cantate, est, sortant de sa plume, nommé symphonie ; un oratorio, symphonie ; un chœur sans accompagnement, symphonie ; une messe, symphonie. Tout est symphonie venant d’un symphoniste.
Il eût échappé à cet inconvénient si sa première symphonie eût passé inaperçue, si ç’eut été une platitude ; il eût même alors rencontré chez plus d’un directeur de théâtre un préjugé en sa faveur : « Celui-ci, eût-on dit, n’a pas réussi dans la musique de concert, il doit réussir au théâtre. Il ne sait pas tirer parti des instruments, donc il saura parfaitement employer les voix. C’est un mauvais harmoniste, au dire des musiciens, il doit êtrefarci de mélodies. »
Par contre on n’eût pas manqué de dire : « Il traite magistralement l’orchestre, il ne doit pas savoir traiter les voix. C’est un harmoniste distingué, il faut se méfier de sa mélodie, s’il en a. Enfin il ne veut pas écrire comme tout le monde, il croit à l’expression en musique, il a un système... c’est un homme dangereux... »
Les prôneurs de ces belles doctrines ont au ciel deux puissants protecteurs dont le nom ressemble fort à celui des patrons des savetiers ; ils s’appellent, dit-on, saint Crétin et saint Crétinien.
![]()
« La musique, a dit Potier, est, comme la justice, une bien belle chose... quand elle est juste. »
Je parlais tout à l’heure des compositeurs qui croient à l’expression musicale, mais qui y croient avec réserve et bon sens, sans méconnaître les limites imposées à cette puissance expressive par la nature même de la musique et qu’elle ne saurait en aucun cas dépasser.
Il y a beaucoup de gens à Paris et ailleurs qui, au contraire, n’y croient pas du tout. Ces aveugles niant la lumière, prétendent sérieusement que toutes paroles vont également bien sous toute musique. Rien ne leur semble plus naturel, si le livret d’un opéra est jugé mauvais, que d’en faire composer un autre d’un genre entièrement différent sans déranger la partition. Ils font des messes avec des opéras bouffes de Rossini. J’en connais une dont les paroles se chantent sur la musique du Barbier de Séville. Ils ajusteraient sans remords le poëme de la Vestale sous la partition du Freyschütz, et réciproquement. On ne discute point de telles absurdités, qui, professées par des hommes placés dans certaines positions particulières, peuvent pourtant avoir sur l’art une détestable influence.
On aurait beau répondre à ces malheureux comme cet ancien qui marchait pour prouver le mouvement, on ne les convertirait pas.
Aussi est-ce pour le divertissement des esprits sains seulement, que nous présentons ici les paroles de deux morceaux célèbres, placées, les premières sous l’air de la Grâce de Dieu, les autres sous celui de la chanson Un jour maître corbeau.
Paroles de la Marseillaise
Adaptées à la musique de la Grâce de Dieu.
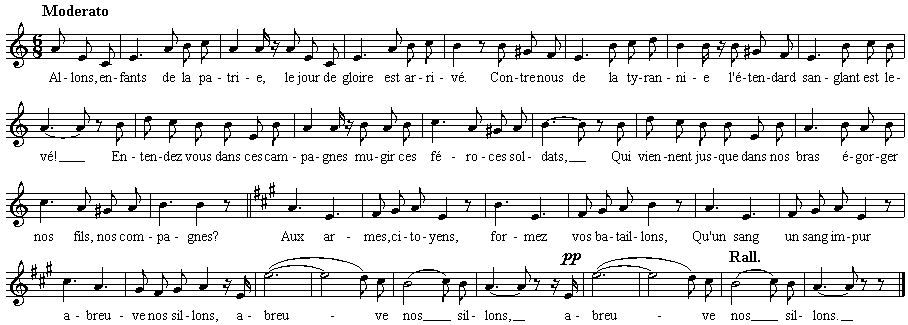
Paroles de l’air d’Éléazar dans la Juive
ADAPTÉES A LA MUSIQUE DE LA CHANSON
Un jour, maître Corbeau
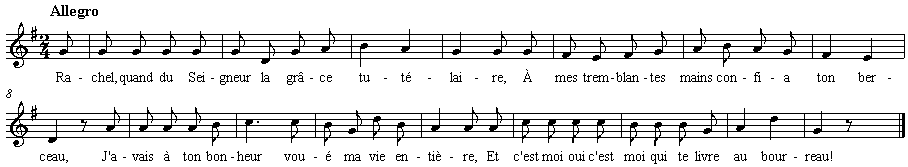
Ces deux exemples grimaçants, dans lesquels une musique nouvelle et spéciale, substituée à la noble inspiration de Rouget de l’Isle et de M. Halévy, se trouve accolée à des vers pleins d’enthousiasme et de tendresse, forment le pendant de l’hymne de Marcello, que j’ai cité en commençant ce livre. Dans ce morceau trop célèbre, une mélodie d’une jovialité bouffonne fut composée par l’auteur pour une ode italienne d’un style élevé et grandiose ; et c’est en adaptant des paroles joviales au chant de Marcello, que j’ai établi une concordance parfaite entre la musique et les vers.
Cette irrévérencieuse plaisanterie, qui n’ôte rien à mon admiration pour les belles œuvres de Marcello, ne choquera pas plus les athées de l’expression que la parodie de la Marseillaise et celle de l’air d’Eléazar, puisque, à les en croire, toutes paroles vont également bien sous toute musique.
Voici le thème du compositeur vénitien avec le double texte des poëtes :
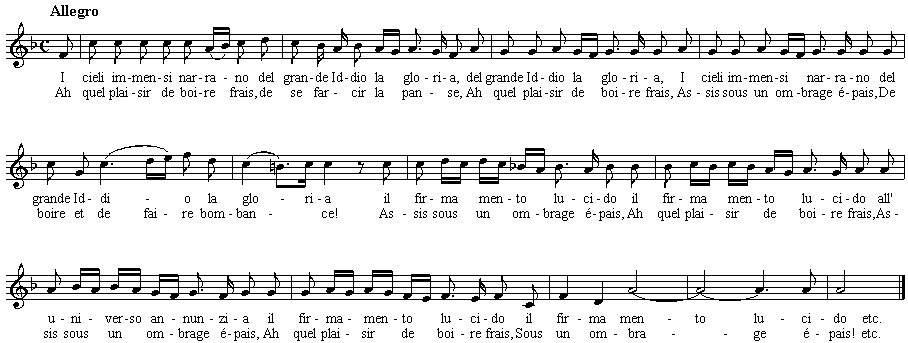
La musique de ce morceau est le chant d’un marchand de bœufs revenant joyeux de la foire, plutôt que celui d’un religieux admirateur des merveilles du firmament. Les athées de l’expression n’admettent point qu’il puisse exister entre deux chants de cette espèce la moindre différence de caractère.
Marcello a produit un grand nombre de très-beaux psaumes, de véritables odes, qui lui valurent le glorieux surnom de Pindare de la musique, mais on n’en chante aucun. Il eut le malheur de laisser échapper de sa plume cette grotesque mélodie, on l’entend aujourd’hui partout ; elle est devenue à Paris presque populaire.
Allons, les athées ont raison ; écrions-nous avec Cabanis : « Je jure qu’il n’y a point de Dieu. »
Le vrai est le faux, le faux est le vrai ! L’horrible est beau, le beau est horrible !
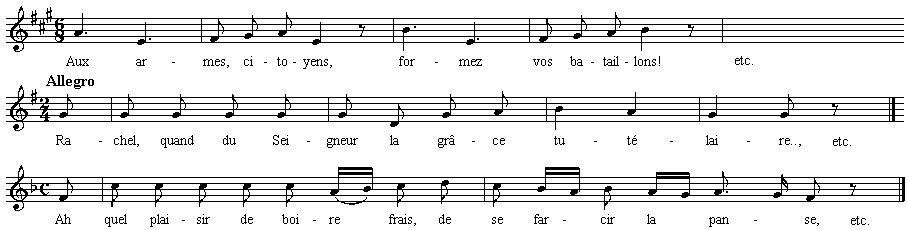
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
![]()
Mme Stoltz, Mme Sontag. —Les millions.
En 1854, après une clôture assez longue, le théâtre de l’Opéra fit sa réouverture par la reprise de la Favorite. J’écrivis à ce sujet les observations suivantes, qui ne me semblent pas hors de propos aujourd’hui.
« L’Opéra a fait sa réouverture. Nous avons revu Mme Stoltz plus dramatique que jamais dans son beau rôle de Léonor. Cette brillante soirée a été suivie de deux autres exécutions non moins remarquables du même ouvrage, après quoi l’Opéra, pour se reposer, nous a donné une fois le Maître chanteur, de M. Limnander, partition dans laquelle se trouvent de charmantes choses qu’on ne remarque point assez, à mon sens. Après le Maître chanteur est venue la Reine de Chypre, où Mme Stoltz a reconquis les honneurs du triomphe, au son des trompettes du théâtre, aux bouquets des loges d’avant-scène, aux acclamations enthousiastes de tous. Le monde entier de l’Opéra s’en est mêlé ; et je n’y étais pas ! Le fabuliste a raison, l’absence est le plus grand des maux, pour moi surtout qui jouis d’un guignon infatigable. Quand je suis à Paris, rien n’est plus terne ni plus stagnant que nos théâtres lyriques, et je n’ai pas plutôt tourné les talons qu’on y tire des feux d’artifice merveilleux, et que les chandelles romaines du succès y montent au ciel de l’art par myriades.
« Mme Stoltz n’a rien perdu de sa voix ni de sa verve brûlante, c’est ce que chacun dit ; mais je lui dirai, moi, qu’elle se prodigue, qu’elle met trop de voiles au vent, qu’elle donne trop de son âme, qu’elle se tue, qu’elle se brûle par les deux bouts. Il faut faire vie qui dure, et notre public de l’Opéra n’est pas habitué à un tel luxe d’élans dramatiques, à une telle profusion d’accents passionnés. Il y a beau temps qu’il avait fait son deuil de toutes ces choses ; ne souffrons pas qu’il en reprenne l’habitude. Mme Stoltz pourrait, elle le devrait même, en se bornant au tiède nécessaire, se dire encore ce que disait Rossini : E troppo buono per questi, etc. »
D’illustres exemples d’illustrissimes cantatrices prouvent surabondamment ce que j’avance. L’une supprime une partie des phrases de ses plus beaux airs, elle compte des pauses pour ne pas se fatiguer, et s’abstient dans presque tout le reste de ses rôles d’articuler les paroles ; vocaliser est plus facile, même quand on ne sait pas vocaliser. L’autre s’arme d’un calme monumental, d’un froid de marbre, et vous récite de la passion comme Bossuet récitait ses sermons, sans gestes, sans mouvements, sans varier l’accentuation de son débit, en maintenant toujours ce qu’elle croit être son âme au degré de chaleur modérée recommandé par les professeurs d’hygiène. Et voilà comme on fait les bonnes maisons ! Aussi ces cantatrices ménagères vivent beaucoup plus longtemps que ne vivent les roses, elles n’acceptent que des centaines de mille francs, achètent des châteaux, en bâtissent en France, et deviennent marquises ou duchesses. Tandis que Mme Stoltz, qui n’a peut-être encore bâti de châteaux qu’en Espagne et ne possède pas le moindre titre dont elle puisse faire précéder son nom, est forcée d’accepter des cinquantaines de mille francs, des misères, pour se consumer comme elle le fait dans la flamme de son inspiration. Voyez, la voilà obligée déjà par les fatigues d’un seul mois de demander un congé, et d’aller chercher de nouvelles forces sous le ciel doux et bienfaisant de l’Angleterre. Qu’elle y profite au moins des bons exemples que Londres ne lui refusera point. C’est là qu’on voit des cantatrices dont l’âme n’use pas le fourreau ; c’est là que les artistes ardentes apprennent à se tremper dans les ondes stygiennes de bons gros oratorios d’où elles sortent froides, rigides et inaccessibles à l’émotion.
Cela vaut mieux, en tout cas, beaucoup mieux que d’aller courir au-delà de l’Océan chez les peuples intertropicaux et plus ou moins anthropophages. Quel besoin de musique peuvent avoir les sauvages, et quel charme pouvez-vous trouver à leurs détellements de chevaux, à leurs bouquets de diamants, quand le choléra, quand le vomito nero, quand la fièvre jaune, dardant sur vous leurs yeux vitreux, sont là mêlés au cortége de vos adorateurs ? Mme Stoltz est revenue une fois déjà de Rio de Janeiro, il est vrai, mais Mme Sontag est restée à Mexico, bien morte, la malheureuse femme ; elle n’en reviendra pas.
Où l’aiglonne a passé le rossignol demeure.
Pauvre Sontag ! aller mourir si tristement, si absurdement, loin de l’Europe, qui seule pouvait savoir quelle artiste elle était !
On m’a reproché de ne lui avoir pas payé le moindre tribut de regrets. Ce n’est pas au moins qu’une telle perte m’ait trouvé insensible, je puis le dire. Je connais toute l’étendue du malheur qui en frappant l’incomparable cantatrice a frappé l’art musical. Mais on fait journellement tant d’étalage de douleurs mensongères, on a tant abusé du prétexte de la mort pour illustrer des médiocrités, que l’élégie, devenue lieu commun, me fait peur, surtout quand il s’agit de parler de choses et d’êtres essentiellement dignes d’admiration. Je ne sais bien faire d’ailleurs qu’une espèce d’oraison funèbre, celle des artistes médiocres vivants.
Et puis, le dirai-je ? Je blâmais en ma conscience cette course au million entreprise par Mme Sontag, et poursuivie jusqu’au sommet des Andes. Je ne pouvais me faire à la voir si âpre au gain, elle, une artiste, une artiste sainte, possédant réellement tous les dons de l’art et de la nature : la voix, le sentiment musical, l’instinct dramatique, le style, le goût le plus exquis, la passion, la rêverie, la grâce, tout, et quelque chose de plus que tout. Elle chantait les bagatelles sonores, elle jouait avec les notes comme jamais jongleur indien ne sut jouer avec ses boules d’or ; mais elle chantait aussi la musique, la grande musique immortelle, comme les musiciens rêvent parfois de l’entendre chanter. Oui, elle pouvait tout interpréter, même les chefs-d’œuvre ; elle les comprenait comme si elle les eût faits. Je n’oublierai jamais mon étonnement un soir à Londres. J’assistais à une représentation du Figaro de Mozart. Quand, dans la scène nocturne du jardin, Mme Sontag vint soupirer ce divin monologue de femme amoureuse que je n’avais jusque-là jamais entendu que grossièrement exécuté ; à cette mezza voce si tendre, si douce et si mystérieuse en même temps, cette musique secrète, dont j’avais pourtant le mot, me parut mille fois plus ravissante encore. Enfin, pensai-je, car je n’avais garde de me récrier, enfin voilà l’admirable page de Mozart fidèlement rendue ! Voilà le chant de la solitude, le chant de la rêverie voluptueuse, le chant du mystère et de la nuit ; c’est ainsi que doit s’exhaler la voix d’une femme dans une scène pareille ; voilà le clair-obscur de l’art du chant, la demi-teinte, le piano enfin, ce piano, ce pianissimo que les compositeurs obtiennent des orchestres de cent musiciens, des chœurs de deux cents voix, mais que, ni pour or, ni pour couronnes, ni par la flatterie, ni par la menace, ni par les caresses, ni par les coups de cravache, ils ne pourraient obtenir de la plupart des cantatrices, savantes ou inhabiles, italiennes ou françaises, intelligentes ou sottes, humaines ou divines. Presque toutes vocifèrent plus ou moins avec la plus exaspérante obstination ; elles ne sauraient s’aventurer au-delà du mezzo forte, ce juste-milieu de la sonorité ; elles semblent craindre de n’être pas entendues. Eh ! malheureuses, nous ne vous entendons que trop ! Oui, l’Allemande Sontag nous avait enfin rendu le chant secret, le chant de l’a parte, le chant de l’oiseau caché sous la feuillée, saluant le crépuscule du soir. Elle connaissait cette nuance exquise dont la simple apparition donne aux auditeurs bien organisés un frisson de plaisir à nul autre comparable ; elle chantait piano aussi finement, aussi sûrement, aussi mystérieusement que le font vingt bons violons avec sourdines dirigés par un habile chef ; elle savait enfin tout l’art du chant...
Admirable Sontag !... Elle eût été Juliette, s’il eût existé un opéra de Roméo shakspearien... elle fût sortie triomphante de la scène du balcon ; elle eût bien dit le fameux passage :
J’ai oublié pourquoi je t’ai rappelé :
Reste, mon Roméo, jusqu’à ce qu’il m’en souvienne ;
elle eût été digne de chanter l’incomparable duo d’amour du dernier acte du Marchand de Venise :
« Ce fut par une nuit semblable que la jeune Cressida, quittant les tentes des Grecs, alla rejoindre au pied des murs de Troie Troïlus son amant. »
Quelque invraisemblable que cela puisse paraître, Mme Sontag, je le crois, eût pu chanter Shakspeare. Je ne connais pas d’éloge comparable à celui-là.
Et pour quelques milliers de dollars ! ... aller mourir...
Auri sacra fames !...
Mais quel besoin d’avoir tant d’argent quand on n’est qu’une cantatrice ? Quand vous avez maison de ville, maison de campagne, l’aisance, le luxe, le sort de vos enfants assuré, que vous faut-il donc de plus ? Pourquoi ne pas se contenter de cinq cent mille francs, de six cent mille francs, de sept cent mille francs ? Pourquoi vous faut-il absolument un million, plus d’un million ? C’est monstrueux cela, c’est une maladie.
Ah ! si vous ambitionnez de faire de grandes choses dans l’art, à la bonne heure ; gagnez des millions tant que vous pourrez ; pourtant arrêtez-vous à temps pour conserver les forces nécessaires à la tâche que vous vous êtes proposé d’accomplir. Tâche royale que nul roi n’a encore envisagée dans son ensemble. Oui, gagnez des millions, et alors nous pourrons voir un vrai théâtre lyrique où l’on exécutera dignement des chefs-d’œuvre, de temps en temps, et non trois fois par semaine ; où les barbares à aucun prix ne pourront être admis ; où il n’y aura pas de claqueurs ; où les opéras seront des œuvres musicales et poétiques seulement ; où l’on ne se préoccupera jamais de la valeur en écus de ce qui est beau. Ce sera un théâtre d’art et non un bazar. L’argent y sera le moyen et non le but.
Gagnez des millions, et vous établirez un gigantesque Conservatoire, où l’on enseignera tout ce qu’il est bon de savoir en musique et avec la musique ; où l’on formera des musiciens artistes, lettrés, et non des artisans ; où les chanteurs apprendront leur langue, et l’histoire et l’orthographe, avec la vocalisation, et même aussi la musique, s’il se peut ; où il y aura des classes de tous les instruments utiles sans exception, et vingt classes de rhythme ; où l’on formera d’immenses corps de choristes ayant de la voix et sachant réellement chanter et lire et comprendre ce qu’ils chantent ; où l’on élèvera des chefs d’orchestre qui ne frappent pas la mesure avec le pied et sachent lire les grandes partitions ; où l’on professera la philosophie et l’histoire de l’art, et bien d’autres choses encore.
Gagnez des millions et vous construirez de belles salles de concerts faites pour la musique et non pour des bals et des festins patriotiques, ou destinées à devenir plus tard des greniers à foin.
Vous y donnerez de véritables concerts, rarement ; car la musique n’est pas destinée à prendre place parmi les jouissances quotidiennes de la vie, comme le boire, manger, le dormir ; je ne sais rien d’odieux comme ces établissements où bouillotte invariablement chaque soir le pot au feu musical. Ce sont eux qui ruinent notre art, le vulgarisent, le rendent plat, niais, stupide, qui l’ont réduit à n’être plus à Paris qu’une branche de commerce, que l’art de l’épicerie en gros.
Gagnez des millions et vous détruirez d’une main en édifiant de l’autre, et vous civiliserez artistement une nation. Alors on vous pardonnera votre richesse et l’on vous louera même d’avoir pris tant de peine à l’acquérir, d’être allée la chercher à Mexico, à Rio, à San-Francisco, à Sydney, à Calcutta.
Mais du diable si un tel rêve préoccupe jamais une cantatrice ni un chanteur à millions ; et je suis bien sûr que ceux qui vont lire cette inconvenante sortie, si tant est que j’aie des lecteurs parmi les gens à millions, vont me regarder comme le plus rare imbécile. Imbécile, oui, mais rare, non. Nous sommes par le monde un assez bon nombre de gens de cette trempe, dont le mépris pour les millions inintelligents est cent millions de fois plus vaste et plus profond que l’Océan.
Il faut en prendre votre parti et ne pas trop vous brûler la cervelle, si vous en avez, pauvres millionnaires !
![]()
Il y eut au siècle dernier une cantatrice adorée, parfaitement inconnue aujourd’hui. Elle se nommait Tonelli. Fut-elle une de ces éphémères immortelles, fléaux de la musique et des musiciens, qui, sous le nom de prime donne ou de dive, mettent tout en désarroi dans un théâtre lyrique, jusqu’au moment où quelque homme d’acier fin, compositeur ou chef d’orchestre, se met en travers de leurs prétentions, et, sans efforts ni violence, coupe net leur divinité ? Je ne crois pas. Il semble, au contraire, à en juger par ce qu’ont dit d’elle Jean-Jacques Rousseau et Diderot, que cette cantatrice italienne ait été une gracieuse et simple fille, pleine de gentillesse, dont la voix avait tant de charme, qu’à l’entendre dans ces petits opéras vagissants qu’on appelait alors opere buffe, les hommes d’esprit de ce temps-là s’imaginaient déguster d’excellente musique, des mélodies exquises, des accents dignes du ciel. Oh ! les bons hommes, les dignes hommes que les hommes d’esprit de ce siècle philosophique, écrivant sur l’art musical sans en avoir le moindre sentiment, sans en posséder les notions premières, sans savoir en quoi il consiste ! Je ne dis pas cela pour Rousseau, qui en possédait, lui, les notions premières. Et pourtant que d’étonnantes plaisanteries ce grand écrivain a mises en circulation et auxquelles il a donné une autorité qui subsiste encore et que les axiomes du bon sens n’acquerront jamais !
C’est si commode, convenons-en, de trouver sur un art ou sur une science des opinions toutes faites et signées d’un nom illustre ! On s’en sert comme de billets de banque dont la valeur n’est pas discutable. O philosophes ! Prodigieux bouffons ! Mais ne rappelons, à propos de la Tonelli, que l’enthousiasme excité à Paris sous son règne par les bouffons italiens. A lire le récit des extases de leurs partisans, à voir la rudesse avec laquelle ces connaisseurs traitent un grand maître français, Rameau, ne dirait-on pas que les œuvres des compositeurs italiens de ce temps, de Pergolèse surtout, débordaient de sève musicale, que le chant, un chant de miel et de lait, y coulait à pleins bords, que l’harmonie en était céleste, les formes d’une beauté antique ?... Je viens de relire la Serva Padrona. Non... jamais... mais, tenez, vous ne me croiriez pas. Voir remettre en scène cet opéra tant prôné et assister à la première représentation de cette reprise serait un plaisir digne de l’Olympe.
Ce qui n’empêchera pas le nom de Pergolèse de rester un nom illustre pendant longtemps encore ; tandis qu’un autre Italien qui possédait réellement au plus haut degré le don de la mélodie expressive et facile, Della Maria, qui écrivit pour le théâtre Feydeau de si charmantes petites partitions dont la grâce est encore fraîche et souriante, est à peu près oublié maintenant. On connaît ses jolis airs, on ignore son nom.
Rousseau, Diderot, le baron de Grimm, Mme d’Épinay et toute l’école philosophique du siècle dernier ont vanté Pergolèse, et aucun philosophe de notre siècle n’a parlé de Della Maria. C’est la cause... Ah ! jeunes élèves ! jeunes maîtres ! jeunes virtuoses ! jeunes compositeurs ! membres et lauréats de l’Institut, profitez de l’exemple, tâchez de ne pas vous mettre mal avec nous autres philosophes du temps présent ; gardez-vous de notre malveillance, ne faites rien pour nous blesser. Si vous donnez des concerts, n’allez pas oublier de nous y faire assister, et qu’ils ne soient pas trop courts ; invitez-nous à vos répétitions générales, à vos distributions de prix ; ne négligez pas de venir à domicile nous chanter vos romances, nous jouer vos messes et vos polkas. Car il n’y a pas de philosophie qui tienne, nous nous vengerions en refusant à votre nom une place dans nos œuvres sublimes ; nous vous ferions la guerre du silence, la pire de toutes les guerres, souvenez-vous-en. Plus de gloire, plus d’immortalité, plus rien ; et dans trois mille ans, eussiez-vous écrit chacun trois douzaines d’opéras-comiques, on ne parlerait pas même de vous autant qu’on parle aujourd’hui de ce pauvre Della Maria.
![]()
Les dilettanti du grand monde. — Le poëte et le cuisinier.
On entend souvent les gens du monde se plaindre de la longueur des grands opéras, de la fatigue causée à l’auditeur par ces œuvres immenses, de l’heure avancée de la nuit où s’achève leur représentation, etc., etc. En réalité pourtant ces mécontents ont tort de se plaindre ; il n’y a pas d’opéras en cinq actes pour eux, mais seulement des opéras en trois actes et demi. Le public élégant étant dans l’usage de ne paraître à l’Opéra que vers le milieu du second acte et quelquefois plus tard, que l’on commence à sept heures, à sept heures et demie ou à huit heures, peu importe, il ne se montrera pas dans les loges avant neuf heures. Il n’en est pas moins sans doute désireux d’avoir des places aux premières représentations, mais ce n’est point l’indice de son empressement à connaître l’œuvre, qui l’intéresse fort médiocrement ; il s’agit d’être vu dans la salle ce soir-là et de pouvoir dire : J’y étais, en ajoutant quelque opinion superficielle sur la nature de l’ouvrage nouveau et une appréciation telle quelle de sa valeur ; voilà tout. Aujourd’hui un compositeur qui aurait écrit un premier acte admirable peut être certain de le voir exécuté devant une salle aux trois quarts vide, et d’obtenir seulement le suffrage de MM. les claqueurs, qui sont à leur poste longtemps avant le lever du rideau. On donne à peine maintenant un grand opéra tous les deux ans ; le public fashionable aurait donc à déroger à ses habitudes une fois en deux ans pour entendre dans son entier, à sa première représentation, une production de cette importance ; mais cet effort est trop grand et la plus miraculeuse inspiration d’un grand musicien ne ferait pas ce monde, qui passe pour beau et poli, avancer seulement d’un quart d’heure..... le dîner de ses chevaux.
Il est vrai que les auteurs ont le droit de se consoler de cette discourtoise indifférence par une indifférence plus grande encore, et de dire : « Qu’importe l’absence des locataires des stalles d’amphithéâtre et des premières loges ? Le suffrage d’amateurs de cette force n’a pour nous aucune valeur. »
Il en est de même presque partout. Combien de fois n’avons-nous pas vu les gens naïfs s’indigner au Théâtre-Italien, quand on y représentait le Don Giovanni, de la précipitation avec laquelle les premières loges se vidaient au moment de l’entrée de la statue du commandeur. Il n’y avait plus de cavatines à entendre. Rubini avait chanté son air, il ne restait que la dernière scène (le chef-d’œuvre du chef-d’œuvre), il fallait donc partir au plus vite pour aller prendre le thé.
Dans une grande ville d’Allemagne où l’on passe pour aimer sincèrement la musique, l’usage est de dîner à deux heures. La plupart des concerts de jour commencent en conséquence à midi. Mais si à deux heures moins un quart le concert n’est pas terminé, restât-il à entendre un quatuor chanté par la Vierge Marie et la sainte Trinité et accompagné par l’archange Michel, les braves dilettanti n’en quitteront pas moins leur place, et, tournant tranquillement le dos aux virtuoses divins, ne s’achemineront pas moins impassibles vers leur pot-au-feu.
Tous ces gens-là sont des intrus dans les théâtres et dans les salles de concerts ;
L’art n’est pas fait pour eux, ils n’en ont pas besoin.
Ce sont les descendants du bonhomme Chrysale :
Vivant de bonne soupe et non de beau langage,
et Shakspeare et Beethoven sont fort loin à leurs yeux d’avoir l’importance d’un bon cuisinier.
![]()
Les bois d’orangers, le gland et la citrouille.
Nos auteurs de vaudevilles et d’opéras-comiques ne manquent jamais de placer des bois d’orangers à tout bout de champ, si l’action de leur pièce se passe en Italie.
L’un d’eux eut l’idée d’en placer un dans le voisinage de la grande route qui va de Naples à Castellamare. Ce bois-là ne pouvait manquer de m’intriguer beaucoup. Où donc est-il caché ? J’eusse été si heureux de le trouver et de m’endormir sous son ombre parfumée, quand je fis à pied, en 1832, le voyage de Castellamare, par une chaleur de deux cent vingt-trois degrés, et caché, comme un dieu d’Homère, dans un nuage... de poussière ardente. Bah ! pas plus de bois d’orangers que dans le jardin de la Tauride à Saint-Pétersbourg, ou dans la plaine de Rome. Mais c’est une idée indéracinable de la tête de tous les hommes du Nord qui ont lu la fameuse chanson de Gœthe : Connais-tu le pays où fleurit l’oranger ? que cet arbre fruitier pousse en Italie comme poussent en Irlande les pommes de terre. On a beau leur dire : L’Italie est grande, elle commence en deçà des Alpes et finit aux îles Lipari. Chambéry est en Savoie, la Savoie fait partie du royaume de Sardaigne, la Sardaigne est en Italie, les Savoyards sont pourtant très-peu Italiens. Or s’il y a réellement de vastes et magnifiques bois d’oranger dans l’île de Sardaigne, s’il s’en trouve même un assez joli dans un enclos de Nice, sur la rive droite du Payon, il ne faut pas s’attendre à rencontrer le jardin des Hespérides à Suze ni à Saint-Jean-de-Maurienne.
N’importe ! il y a peut-être aujourd’hui des bois d’orangers sur la route de Castellamare ; car quand ces bois-là se mettent à pousser quelque part, ils poussent vite ; il ne s’agit que de commencer.
En tout cas, il n’y a pas, à coup sûr, de bois de citronniers. Il serait impie de le croire.
— Pourquoi cela ?
— Pourquoi ? Vous n’avez donc jamais lu la fable le Gland et la Citrouille ? Vous ignorez donc que les citronniers, au lieu d’être ronds comme les oranges, sont armés d’une protubérance fort dure, qui pourrait, si le fruit tombait sur la figure d’un voyageur endormi au pied du citronnier, lui crever un œil. La Providence sait ce qu’elle fait. L’auteur de l’apologue que je viens de citer le démontre clairement : Si Dieu a suspendu aux branches du chêne, dit-il, un fruit léger, quand la citrouille monstrueuse, plus convenable en apparence à un arbre puissant, repose à terre entre les feuilles d’une misérable herbe rampante, c’est afin de préserver les gens tentés de s’endormir au pied du chêne, d’avoir le nez écrasé par la chute de la citrouille.
Sans doute il y a dans les contrées intertropicales beaucoup d’autres arbres, des cocotiers, par exemple, et des calebassiers, portant des fruits très-lourds, dangereux pour le nez de l’homme ; mais les moralistes ne sont point obligés de tenir compte de ce qui se passe aux antipodes. Que de gens de toutes couleurs on y voit d’ailleurs qui ont le nez écrasé de père en fils !
![]()
Les personnes qui s’absentent de Paris pour un temps plus ou moins long sont tout étonnées, à leur retour, de la persistance avec laquelle les pâtissiers font chaque jour les mêmes brioches, les petits théâtres lyriques produisent le même opéra-comique nouveau, et de l’obstination du grand Opéra à jouer les mêmes anciens ouvrages.
Quant à la persistance des pâtissiers et des petits théâtres lyriques à produire toujours le même opéra-comique nouveau et les mêmes brioches, elle n’a rien d’étonnant ; on a trouvé depuis longtemps le procédé qui assure le plus haut degré de perfection à ces agréables produits : pourquoi en changerait-on ? Là surtout le mieux serait l’ennemi du bien. L’important pour les consommateurs, c’est que le four soit bon, et que brioches et opéras, toujours servis frais, restent en conséquence très-peu de temps en étalage. Ce système est l’inverse de celui du grand Opéra, où l’on étalera certains ouvrages jusqu’à ce que les abonnés ne puissent plus y mordre, faute de dents.
On appelle passade, dans les écoles de natation, l’opération au moyen de laquelle un nageur fait passer entre ses jambes le nageur qui se trouve devant lui, et, appuyant la main sur sa tête, le pousse brusquement au fond de l’eau. C’est précisément ce puis un temps immémorial à l’Opéra-Comique et au Théâtre-Lyrique ; à peine un baigneur avec sa ceinture de sauvetage (sans laquelle il ne surnagerait pas) parvient-il à montrer sa tête au-dessus du courant, qu’un autre lui donne la passade. Le malheureux qui la reçoit disparait aussitôt ; il se remontre quelquefois à demi-mort, s’il a une bonne haleine, mais c’est rare ; pour l’ordinaire, il est noyé du coup.
Le public se divertit fort de ces facéties nautiques ; sans le spectacle des passades, les écoles de natation seraient peu fréquentées. Cela s’appelle varier le répertoire. A l’Opéra, où l’on ne donne pas de passades, et où les ouvrages, quand ils ne coulent pas à fond tout seuls,
Apparent rari nantes
et flottent tranquillement comme des bouées dans un port, on s’obstine seulement à maintenir le répertoire. Ces divers systèmes, en dernière analyse, sont tous bons, puisque le public afflue partout ; boutique de pâtissiers, théâtres lyriques grands et petits, ne désemplissent pas ; on consomme, on consomme, et tout le monde est content, excepté les noyés.
![]()
Sensibilité et laconisme.
Une oraison funèbre en trois syllabes.
Cherubini se promenait dans le foyer de la salle des concerts du Conservatoire pendant un entr’acte. Les musiciens autour de lui paraissaient tristes : ils venaient d’apprendre la mort de leur confrère Brod, virtuose remarquable, premier hautbois de l’Opéra. L’un d’eux, s’approchant du vieux maitre : « Eh bien, M. Cherubini, nous avons donc perdu ce pauvre Brod !... — Eh !... quoi ? — (Le musicien élevant la voix :) Brod, notre camarade Brod... — Eh bien ? — Il est mort ! — Euh ! petit son !
![]()