Par
HECTOR BERLIOZ
I.
Le droit de jouer en fa dans une symphonie en ré. — Un virtuose couronné. — Un nouvel instrument de musique.
Le régiment de colonels. — Une
cantate. — Un programme de musique grotesque. — Est-ce une ironie?
L’Évangéliste du tambour. — L’Apôtre du flageolet. — Le
Prophète du trombone. — Chefs d’orchestre.
Appréciateurs de Beethoven. — La version Sontag. — On ne peut pas danser en MI.
Un baiser de Rossini. — Un
Concerto de clarinette.
L’art musical est sans contredit celui de tous les arts qui fait naître les passions les plus étranges, les ambitions les plus saugrenues, je dirai même les monomanies les plus caractérisées. Parmi les malades enfermés dans les maisons de santé, ceux qui se croient Neptune ou Jupiter sont aisément reconnus pour monomanes ; mais il en est beaucoup d’autres, jouissant d’une entière liberté, dont les parents n’ont jamais songé à recourir pour eux aux soins de la science phrénologique, et dont la folie pourtant est évidente. La musique leur a détraqué le cerveau. Je m’abstiendrai de parler à ce sujet des hommes de lettres, qui écrivent, soit en vers, soit en prose, sur des questions de théorie musicale dont ils n’ont pas la connaissance la plus élémentaire, en employant des mots dont ils ne comprennent pas le sens ; qui se passionnent de sang-froid pour d’anciens maîtres dont ils n’ont jamais entendu une note ; qui leur attribuent généreusement des idées mélodiques et expressives que ces maîtres n’ont jamais eues, puisque la mélodie et l’expression n’existaient pas à l’époque où ils vécurent ; qui admirent en bloc, et avec la même effusion de cœur, deux morceaux signés du même nom, dont l’un est beau en effet, quand l’autre est absurde ; qui disent et écrivent enfin ces étonnantes bouffonneries que pas un musicien ne peut entendre citer sans rire. C’est convenu, chacun a le droit de parler et d’écrire sur la musique ; c’est un art banal et fait pour tout le monde ; la phrase est consacrée. Pourtant, entre nous, cet aphorisme pourrait bien être l’expression d’un préjugé. Si l’art musical est à la fois un art et une science ; si, pour le posséder à fond, il faut des études complexes et assez longues ; si, pour ressentir les émotions qu’il procure, il faut avoir l’esprit cultivé et le sens de l’ouïe exercé ; si, pour juger de la valeur des œuvres musicales, il faut posséder en outre une mémoire meublée, afin de pouvoir établir des comparaisons, connaître enfin beaucoup de choses qu’on ignore nécessairement quand on ne les a pas apprises ; il est bien évident que les gens qui s’attribuent le droit de divaguer à propos de musique sans la savoir, et qui se garderaient pourtant d’émettre leur opinion sur l’architecture, sur la statuaire, ou tout autre art à eux étranger, sont dans le cas de monomanie. Ils se croient musiciens, comme les autres monomanes dont je parlais tout l’heure se croient Neptune ou Jupiter. Il n’y a pas la moindre différence.
Quand Balzac écrivait son Gambara et tentait l’analyse technique du Moïse de Rossini, quand Gustave Planche osait imprimer son étrange critique de la Symphonie héroïque de Beethoven, ils étaient fous tous les deux. Seulement la folie de Balzac était touchante ; il admirait sans comprendre ni sentir, il se croyait enthousiasmé. L’insanité de Planche était irritante et sotte, au contraire ; sans comprendre, ni sentir, ni savoir, il dénigrait Beethoven et prétendait lui enseigner comment il faut faire une symphonie.
Je pourrais nommer une foule d’autres écrivains qui, pour le malheur de l’art et le tourment des artistes, publient leurs idées sur la musique, en prenant constamment, comme le singe de la fable, le Pirée pour un homme. Mais je veux me borner à citer divers exemples de monomanie inoffensive et par cela même essentiellement plaisante, que l’histoire moderne me fournit.
![]()
Le droit de jouer en fa dans une symphonie en ré.
A l’époque où, après huit ou dix ans d’études, je commençais à entrevoir la puissance de notre grand art profané, un étudiant de ma connaissance fut député vers moi par les membres d’une société philharmonique d’amateurs, récemment constituée dans le local du Prado, pour me prier d’être leur chef d’orchestre. Je n’avais encore alors dirigé qu’une seule exécution musicale, celle de ma première messe dans l’église de Saint-Eustache. Je me méfiais extrêmement de ces amateurs ; leur orchestre devait être et était en effet exécrable. Toutefois l’idée de m’exercer à la direction des masses instrumentales, en expérimentant ainsi in animâ vili, me décida, et j’acceptai.
Le jour de la répétition venu, je me rends au Prado ; j’y trouve une soixantaine de concertants qui s’accordaient avec ce bruit agaçant particulier aux orchestres d’amateurs. Il s’agissait d’exécuter quoi ?... Une symphonie en ré de Gyrowetz. Je ne crois pas que jamais chaudronnier, marchand de peaux de lapins, épicier romain ou barbier napolitain ait rêvé des platitudes pareilles. Je me résigne, nous commençons. J’entends une discordance affreuse produite par les clarinettes. J’interromps l’orchestre, et m’adressant aux clarinettistes : « Vous aurez pris sans doute un morceau pour un autre, messieurs ; nous jouons en ré et vous venez de jouer en fa ! — Non, monsieur, c’est bien la symphonie désignée ! — Recommençons. » Nouvelle discordance, nouveau temps d’arrêt. « Mais c’est impossible, envoyez-moi votre partie. » On me fait passer la partie des clarinettes : « Parbleu ! la cacophonie s’explique. Votre partie est écrite en fa, à la vérité, mais pour des clarinettes en la, et votre fa, en ce cas, devient l’unisson de notre ré. Vous vous êtes trompés d’instrument. — Monsieur, nous n’avons que des clarinettes en ut. — Eh bien, transposez à la tierce inférieure. — Nous ne savons pas transposer. — Alors, ma foi, taisez-vous. — Ah ! par exemple ! Nous sommes membres de la société, et nous avons le droit de jouer comme tous les autres. »
A ces mots incroyables, laissant tomber mon bâton, je me sauvai comme si le diable m’emportait, et jamais depuis lors je n’entendis parler de ces philharmoniques.
![]()
Un roi d’Espagne, croyant aimer fort la musique, se plaisait à faire sa partie dans les quatuors de Boccherini ; mais il ne pouvait jamais suivre le mouvement d’un morceau. Un jour où, plus que de coutume, il était resté en arrière des autres concertants, ceux-ci, effrayés du désordre produit par le royal archet, en retard de trois ou quatre mesures, firent mine de s’arrêter : — « Allez toujours, cria l’enthousiaste monarque, je vous rattraperai bien ! » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
![]()
Un nouvel instrument de musique.
Un musicien que tout Paris connaissait, il y a quinze ou vingt ans, vient me trouver un matin, portant sous son bras un objet soigneusement enveloppé dans du papier : —
« Je l’ai trouvé ! je l’ai trouvé ! s’écrie-t-il comme Archimède, en entrant chez moi. J’étais depuis longtemps à la piste de cette découverte, qui ne peut manquer de produire dans l’art une immense révolution. Vois cet instrument, une simple boîte de fer-blanc percée de trous et fixée au bout d’une corde ; je vais la faire tourner vivement comme une fronde, et tu entendras quelque chose de merveilleux. Tiens, écoute : Hou ! hou ! hou ! Une telle imitation du vent enfonce cruellement les fameuses gammes chromatiques de la Pastorale de Beethoven. C’est la nature prise sur le fait ! C’est beau, et c’est nouveau ! Il serait de mauvais goût de faire ici de la modestie. Beethoven était dans le faux, il faut le reconnaître, et je suis dans le vrai. Oh ! mon cher, quelle découverte ! et quel article tu vas m’écrire là-dessus dans le Journal des Débats ! Cela te fera un honneur extraordinaire ; on te traduira dans
toutes les langues. Que je suis content, va, mon vieux ! Et crois-le bien, c’est autant pour toi que pour moi. Cependant, je l’avouerai, je désire employer le premier mon instrument ; je le réserve pour une ouverture que j’ai commencée et dont le titre sera : l’Ile d’Eole ; tu m’en diras des nouvelles. Après cela, libre à toi d’user de ma découverte pour tes symphonies. Je ne suis pas de ces gens qui sacrifieraient le présent et l’avenir de la musique à leur intérêt personnel, non ; tout pour l’art, c’est ma
devise. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
![]()
Un monsieur, riche proprétaire, daigne me présenter son fils, âgé de vingt-deux ans, et ne sachant, de son aveu, pas encore lire la musique.
— Je viens vous prier, monsieur, me dit-il, de vouloir bien donner des leçons de haute composition à ce jeune homme, qui vous fera honneur prochainement, je l’espère. Il avait eu d’abord l’idée de se faire colonel, mais malgré l’éclat de la gloire militaire, celle des arts le séduit décidément ; il aime mieux se faire grand compositeur.
— Oh ! monsieur, quelle faute ! Si vous saviez tous les déboires de cette carrière ! Les grands compositeurs se dévorent entre eux ; il y en a tant !... Je ne puis d’ailleurs me charger de le conduire au but de sa noble ambition. A mon avis, il fera bien de suivre sa première idée et de s’engager dans le régiment dont vous me parliez.
— Quel régiment ?
— Parbleu ! le régiment des colonels.
— Monsieur, votre plaisanterie est fort déplacée ; je ne vous importunerai pas plus longtemps. Heureusement vous n’êtes pas le seul maître et mon fils pourra se faire grand compositeur sans vous. Nous avons l’honneur de vous saluer.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
![]()
Peu de temps avant l’entrée à Paris des cendres de l’empereur Napoléon Ier, des marches funèbres furent demandées à MM. Auber, Adam et Halévy, pour le cortége qui devait conduire le mort immortel à l’église des Invalides.
J’avais, en 1840, été chargé de composer une symphonie pour la translation des restes des victimes de la révolution de Juillet et l’inauguration de la colonne de la Bastille ; en conséquence, plusieurs journaux, persuadés que ce genre de musique était ma spécialité, m’annoncèrent comme le compositeur honoré une seconde fois de la confiance du ministre dans cette occasion solennelle.
Un amateur belge, induit en erreur avec beaucoup d’autres, m’adressa alors un paquet contenant une lettre, des vers et de la musique.
La lettre était ainsi conçue :
« Monsieur,
» J’apprends par la voie des journaux que vous êtes chargé de composer une symphonie pour la cérémonie de la translation des cendres impériales au Panthéon. Je vous envoie une cantate qui, fondue dans votre ouvrage, et chantée par sept ou huit cents voix, doit produire un certain effet.
» Vous remarquerez une lacune dans la poésie après le
vers :
Nous vous rendons votre Empereur.
» Je n’ai pu terminer complétement que la musique, car je ne suis guère poëte. Mais vous vous procurerez aisément ce qui manque ; Hugo ou Lamartine vous feront ça. Je suis marié, j’ai trois populos (trois enfants) ; si cela rapporte quelques écus vous me feriez plaisir de me les envoyer ; je vous abandonne la gloire. »
………………………………………………………………………………………….
Voici la cantate.
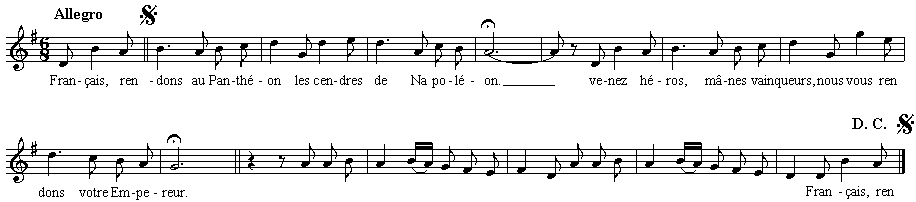
Il m’abandonnait la gloire !!!
![]()
Un programme de musique grotesque.
A l’époque où l’Odéon était un théâtre lyrique, on y représentait souvent des pièces de l’ancien répertoire de Feydeau. Je fus, par hasard, témoin d’une répétition générale pour la reprise de la Rosière de Salency de Grétry. Je n’oublierai jamais le spectacle offert par l’orchestre à cette occasion ; son hilarité en exécutant l’ouverture, les cris des uns, les contorsions des autres, les applaudissements ironiques des violons, le premier hautbois avalant son anche, les contre-basses trépignant devant leur pupitre et demandant d’une voix étranglée la permission de sortir, assurant qu’il était encore temps. Et le chef d’orchestre, M. Bloc, ayant la force de tenir son sérieux... ; et moi, m’élevant jusqu’au sublime en blâmant cette explosion irrévérencieuse, et trouvant indécente l’idée des joueurs de contre-basse. Mais ces pauvres artistes ne tardèrent pas à être bien vengés de ma sotte pruderie. Une demi-heure après l’exécution de l’étonnante ouverture, le calme s’étant rétabli, on en était revenu au sérieux et à l’attention, l’orchestre accompagnait tranquillement un morceau de chant de la troisième scène, quand je tombai subitement à la renverse au milieu du parterre, en poussant un cri de rire rétrospectif... La nature reprenait ses droits, je faisais long feu.
Deux ou trois ans plus tard, réfléchissant à certains morceaux de ce genre qu’on trouve, il faut bien le reconnaître, chez plusieurs grands maîtres, l’idée me vint d’en faire figurer une collection dans un concert préparé ad hoc, mais sans prévenir le public de la nature du festin musical auquel il était convié, me bornant à annoncer un programme décoré exclusivement de noms illustres.
L’ouverture de la Rosière de Salency, cela se conçoit, y figurait en première ligne, — puis un air anglais célèbre : « Arm ye brave ! » — une sonate diabolique pour le violon, — le quatuor d’un opéra français où l’on trouve ce passage :
J’aime assez les Hollandaises,
Les Persanes, les Anglaises,
Mais je préfère des Françaises
L’esprit, la grâce et la gaîté.
— une marche instrumentale qui fut exécutée, à l’indescriptible joie du public, dans un concert très-grave donné à Paris, il y a six ou sept ans ; — le finale du premier acte d’un grand opéra qui n’est plus au répertoire, mais dont la phrase : « Viens, suis-moi dans les déserts, » produisit aussi sur une partie de l’orchestre l’hilarité la plus scandaleuse, lors de la dernière reprise du chef-d’œuvre ; — la fugue sur Kyrie Eleison, d’une messe de Requiem ; — un hymne qui passe pour appartenir au style pindarique, dont les paroles sont :
I cieli immensi narrano
Del grande iddio la gloria !
(Les cieux immenses racontent la gloire du grand Dieu !) mais dont la musique, pleine de jovialité et de rondeur, sans se soucier des merveilles de la création, dit tout bonnement ceci :
Ah ! quel plaisir de boire frais,
De se farcir la panse !
Ah ! quel plaisir de boire frais,
Assis sous un ombrage épais,
Et de faire bombance !
— des variations pour le basson sur l’air : Au clair de la lune, célèbres pendant vingt ans, et qui firent la fortune de l’auteur.
Enfin, une très-fameuse symphonie (en ré), dont Gyrowetz n’est pas coupable.
Ce mirobolant programme une fois arrêté, l’orchestre conspirateur se réunit pour une répétition préliminaire. Quelle matinée !... Inutile de dire qu’on ne vit pas la fin de l’expérience. L’ouverture de la Rosière produisit son effet extraordinaire ; le finale : « Viens ! suis-moi », alla jusqu’au bout, au milieu des transports joyeux des exécutants, mais l’hymne :
Ah ! quel plaisir de boire frais !
ne put être achevé : on se tordait, on tombait à terre, on renversait les pupitres, le timbalier avait crevé la peau d’une de ses timbales ; il fallut renoncer à aller plus avant. Enfin, ce qui restait de gens à peu près sérieux dans l’orchestre fut réuni en conseil, et la majorité déclara ce concert impossible, assurant qu’il en résulterait un scandale affreux, et que malgré la célébrité, la haute et juste illustration de tous les compositeurs dont les œuvres figuraient dans le programme, le public serait capable d’en venir à des voies de fait et de nous jeter des gros sous.
O naïfs musiciens ! Vous connaissez bien mal l’urbanité du public ! Lui, se fâcher ! Allons donc ! Sur les huit cents personnes réunies dans la salle que nous avions choisie pour cette épreuve, cinquante peut-être eussent ri du meilleur de leur cœur, les autres fussent restées fort sérieuses et de grands applaudissements, je le crains, eussent suivi l’exécution de l’hymne et du finale. Quant au Kyrie, on eût dit : « C’est de la musique savante ! » et l’on eût fort goûté la symphonie.
Pour l’ouverture, la marche et l’air anglais, quelques-uns se fussent permis d’exprimer un doute et de dire à leurs voisins : « Est-ce une plaisanterie ? »
Mais voilà tout.
Les anecdotes à l’appui de cette opinion ne me feraient pas défaut, En voici une entre vingt.
![]()
Je venais de diriger au théâtre de Dresde la second exécution de ma légende : la Damnation de Faust. Au second acte, à la scène de la cave d’Auerbach, les étudiants ivres, après avoir chanté la chanson du rat mort empoisonné dans une cuisine, s’écrient en chœur : Amen !
Pour l’amen une fugue !
dit Brander,
Une fugue, un choral !
Improvisons un morceau magistral !
Et les voilà reprenant, dans un mouvement plus large, le thème de la chanson du rat, et faisant une vraie fugue scolastico-classique, où le chœur, tantôt vocalise sur a a a a, tantôt répète rapidement le mot tout entier, amen, amen, amen, avec accompagnement de tuba, d’ophicléide, de bassons et de contrebasses. Cette fugue est écrite selon les règles les plus sévères du contre-point, et, malgré la brutalité insensée de son style et le contraste impie et blasphématoire établi à dessein entre l’expression de la musique et le sens du mot amen, l’usage de ces horribles caricatures étant admis dans toutes les écoles, le public n’en est point choqué, et l’ensemble harmonieux qui résulte du tissu de notes, dans cette scène, est toujours et partout applaudi. Cela rappelle le succès du sonnet d’Oronte à la première représentation du Misanthrope…
Après la pédale obligée et la cadence finale de la fugue, Méphistophélès s’avance et dit :
Vrai Dieu ! messieurs, votre fugue est fort belle,
Et telle
Qu’à l’entendre on se croit aux saints lieux.
Souffrez qu’on vous le dise,
Le style en est savant, vraiment religieux,
On ne saurait exprimer mieux
Les sentiments pieux
Qu’en terminant ses prières, l’Église
En un seul mot résume, etc.
Un amateur vint me trouver dans un entr’acte. Ce récitatif, sans doute, lui avait donné à réfléchir, car, m’abordant avec un timide sourire :
— Votre fugue sur amen est une ironie, n’est-ce pas, c’est une ironie ?...
— Hélas ! monsieur, j’en ai peur !
Il n’en était pas sûr !!!
![]()
Je me suis souvent demandé : Est-ce parce que certaines gens sont fous qu’ils s’occupent de musique, ou bien est-ce la musique qui les a fait devenir fous ?... L’observation la plus impartiale m’a amené à cette conclusion : la musique est une passion violente, comme l’amour ; elle peut donc sans doute faire quelquefois en apparence perdre la raison aux individus qui en sont possédés. Mais ce dérangement du cerveau est seulement accidentel, la raison de ceux-là ne tarde pas à reprendre son empire ; encore reste-t-il à prouver que ce prétendu dérangement n’est pas une exaltation sublime, un développement exceptionnel de l’intelligence et de la sensibilité.
Pour les autres, pour les vrais grotesques, évidemment la musique n’a point contribué au désordre de leurs facultés mentales, et si l’idée leur est venue de se vouer à la pratique de cet art, c’est qu’ils n’avaient pas le sens commun. La musique est innocente de leur monomanie.
Pourtant Dieu sait le mal qu’ils lui feraient si cela dépendait d’eux, et si les gens acharnés à démontrer à tout venant, en tout pays et en tout style, qu’ils sont Jupiter, n’étaient pas reconnus de prime abord par le bon sens public pour des monomanes !
D’ailleurs, il y a des individus qu’on honore beaucoup en les plaçant dans la classe des esprits dérangés ; ils n’eurent jamais d’esprit ; ce sont des crânes vides, ou du moins vides d’un côté ; le lobe droit ou le lobe gauche du cerveau leur manque, quand les deux lobes ne leur manquent pas à la fois. Le lecteur fera sans peine le classement des exemples que nous allons citer et saura distinguer les fous des hommes simplement... simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il s’est trouvé un brave musicien, jouant fort bien du tambour. Persuadé de la supériorité de la caisse claire sur tous les autres organes de la musique, il écrivit, il y a dix ou douze ans, une méthode pour cet instrument et dédia son ouvrage à Rossini. Invité à me prononcer sur le mérite et l’importance de cette méthode, j’adressai à l’auteur une lettre dans laquelle je trouvai le moyen de le complimenter beaucoup sur son talent d’exécutant.
« Vous êtes le roi des tambours, disais-je, et vous ne tarderez pas à être le tambour des rois. Jamais, dans aucun régiment français, italien, anglais, allemand ou suédois, on ne posséda une qualité de son comparable à la vôtre. Le mécanisme proprement dit, le maniement des baguettes, vous fait prendre pour un sorcier par les gens qui ne vous connaissent pas. Votre fla est si moelleux, si séduisant, si doux ! C’est du miel ! Votre ra est tranchant comme un sabre. Et quant à votre roulement, c’est la voix de l’Éternel, c’est le tonnerre, c’est la foudre qui tombe sur un peuplier de quatre-vingts pieds de haut et le fend jusques en bas. »
Cette lettre enivra de joie notre virtuose ; il en eût perdu l’esprit, si la chose eût été possible. Il courait les orchestres de Paris et de la banlieue, montrant sa lettre de gloire à tous ses camarades.
Mais un jour il arrive chez moi dans un état de fureur indescriptible : « Monsieur ! on a eu l’insolence, hier, à l’état-major de la garde nationale, de m’insinuer que votre lettre était une plaisanterie, et que vous vous étiez (si j’ose m’exprimer ainsi), f... moqué de moi. Je ne suis pas méchant, non, on le sait. Mais le premier qui osera me dire cela positivement en face, le diable me brûle si je ne lui passe pas mon sabre au travers du corps !... »
Pauvre homme ! il fut l’évangéliste du tambour ; il se nommait Saint-Jean.
![]()
Un autre, l’apôtre du flageolet, était rempli de zèle ; on ne pouvait l’empêcher de jouer dans l’orchestre dont il faisait le plus bel ornement, alors même que le flageolet n’y avait rien à faire.
Il doublait alors soit la flûte, soit le hautbois, soit la clarinette ; il eût doublé la partie de contre-basse, plutôt que de rester inactif. Un de ses confrères s’avisant de trouver étrange qu’il se permit de jouer dans une symphonie de Beethoven : « Vous mécanisez mon instrument, et vous avez l’air de le mépriser ! Imbéciles ! Si Beethoven m’avait eu, ses œuvres seraient pleines de solos de flageolet, et il eût fait fortune.
» Mais il ne m’a pas connu ; il est mort à l’hôpital. »
![]()
Un troisième s’est passionné pour le trombone. Le trombone, selon lui, détrônera tôt ou tard et remplacera tous les autres instruments. Il en est le prophète Isaïe. Saint-Jean eût joué dans le désert ; celui-ci, pour prouver l’immense supériorité du trombone, se vante d’en avoir joué en diligence, en chemin de fer, en bateau à vapeur, et même en nageant sur un lac de vingt mètres de profondeur. Sa méthode contient, avec les exercices propres à enseigner l’usage du trombone en nageant sur les lacs, plusieurs chansons joyeuses pour noces et festins. Au bas de l’un de ces chefs-d’œuvre est un avis ainsi conçu : « Quant on chante ce morceau dans une noce, à la mesure marquée X, il faut laisser tomber une pile d’assiettes ; cela produit un excellent effet. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
![]()
Un célèbre chef d’orchestre, faisant répéter une ouverture nouvelle, répondit à l’auteur qui lui demandait une nuance de piano dans un passage important : « Piano, monsieur ? chimère de cabinet ! »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J’en ai vu un autre, pensant diriger quatre-vingts exécutants, qui tous lui tournaient le dos.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un troisième, conduisant la tête baissée et le nez sur les notes de sa partition, ne s’apercevait pas plus de ce que faisaient les musiciens que s’il eût de Londres dirigé l’orchestre de l’Opéra de Paris.
Une répétition de la symphonie en la de Beethoven ayant lieu sous sa direction, tout l’orchestre se perdit ; l’ensemble une fois détruit, une terrible cacophonie ne tarda pas à s’ensuivre, et bientôt les musiciens cessèrent de jouer. Il n’en continua pas moins d’agiter au-dessus de sa tête le bâton au moyen duquel il croyait marquer les temps, jusqu’au moment où les cris répétés : « Eh ! cher maître, arrêtez-vous, arrêtez-vous donc ! Nous n’y sommes plus ! » suspendirent enfin le mouvement de son bras infatigable. Il relève la tête alors, et d’un air étonné : « Que voulez-vous? Qu’est-ce qu’il y a ?
— Il y a que nous ne savons où nous en sommes, et que tout est en désarroi depuis longtemps.
— Ah ! ah !... »
Il ne s’en était pas aperçu.
Ce digne homme fut, comme le précédent, honoré de la confiance particulière du roi, qui le combla d’honneurs, et il passe encore dans son pays, auprès des amateurs, pour une des illustrations de l’art. Quand on dit cela devant des musiciens, quelques-uns, les flatteurs, gardent leur sérieux.
![]()
Un fameux critique, théoricien, parolier, décompositeur, correcteur des maîtres, avait fait un opéra avec la pièce de deux auteurs dramatiques et la musique de quatre compositeurs. Il me trouve un jour à la bibliothèque du Conservatoire lisant l’orage de la symphonie pastorale de Beethoven.
— Ah ! ah ! dit-il en reconnaissant le morceau, j’avais introduit cela dans mon opéra la Forêt de Sénart, et j’y avais fourré des trombones qui produisaient un diable d’effet !
— Pourquoi y en avoir fourré, lui dis-je, puisqu’il y en a déjà ?
— Non, il n’y en a pas !
— Bah ! et ceci (lui montrant les deux lignes de trombones) qu’est-ce donc ?
— Ah ! parbleu ! je ne les avais point vus.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un grand théoricien, érudit, etc., a imprimé quelque part que Beethoven savait peu la musique.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un directeur des beaux-arts (qui déplorent sa perte) a reconnu devant moi que ce même Beethoven n’était pas sans talent.
![]()
Une admirable cantatrice, la tant regrettée Sontag, avait, à la fin du trio des masques de Don Juan, inventé une phrase qu’elle substituait à la phrase originale. Son exemple fut bientôt suivi ; il était trop beau pour ne pas l’être, et toutes les cantatrices de l’Europe adoptèrent pour le rôle de dona Anna l’invention de Mme Sontag.
Un jour, à une répétition générale à Londres, un chef d’orchestre de ma connaissance, entendant à la fin du trio cette audacieuse substitution, arrêta l’orchestre et s’adressant à la prima donna :
— Eh bien, qu’est-ce qu’il y a ? Avez-vous oublié votre rôle, madame ?
— Non, monsieur, je chante la version Sontag.
— Ah ! très-bien ; mais oserais-je prendre la liberté de vous demander pourquoi vous préférez la version Sontag à la version Mozart, qui est pourtant la seule dont nous ayons à nous occuper ici ?
— C’est qu’elle fait mieux.
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !………………..……..
![]()
Un danseur qui, en Italie, s’était élevé jusqu’aux nues, vient débuter à Paris ; il demande l’introduction, dans le ballet où il va paraître, d’un pas qui lui valut des avalanches de fleurs à Milan et à Naples. On obéit. Arrive la répétition générale ; mais cet air de danse, pour une raison ou pour une autre, avait été copié un ton plus haut que dans la partition originale.
On commence ; le danseur part pour le ciel, voltige un instant, puis, redescendant sur la terre : « En quel ton jouez-vous, messieurs ? dit-il, en suspendant son vol. Il me semble que mon morceau me fatigue plus que de coutume.
— Nous jouons en mi.
— Je ne m’étonne plus maintenant. Veuillez transposer cet allegro et le baisser d’un ton, je ne puis le danser qu’en ré. »
![]()
Un amateur de violoncelle eut l’honneur de jouer devant Rossini.
« Le grand maître, racontait notre homme, dix ans après, a été si enchanté de mon jeu, que, m’interrompant au milieu d’un cantabile, il est venu me donner un baiser sur le front. Depuis lors, pour conserver l’illustre empreinte, je ne me suis plus lavé la figure. »
![]()
Dœlher venait d’annoncer un concert dans une grande ville d’Allemagne, quand un inconnu se présenta chez lui :
« Monsieur, dit-il à Dœlher, je me nomme W***, je suis une grande clarinette, et je viens à H... dans l’intention d’y faire apprécier mon talent. Mais on me connaît peu ici, et vous me rendriez un éminent service en me permettant de jouer un solo dans la soirée que vous organisez. L’effet que j’espère y produire attirera sur moi l’attention et la faveur du public, et je vous devrai ainsi de pouvoir donner avec succès mon premier concert.
— Que voudriez-vous exécuter à ma soirée ? répond l’obligeant Dœlher.
— Un grand concerto de clarinette.
— Eh bien, monsieur, j’accepte votre offre ; je vais vous placer dans mon programme ; venez ce soir à la répétition ; je suis enchanté de vous être agréable. »
Le soir venu, l’orchestre rassemblé, notre homme se présente, et l’on commence à répéter son concerto. Selon l’usage fashionable de quelques virtuoses, il s’abstient de jouer sa partie, se bornant à faire répéter l’orchestre et à indiquer les mouvements. Le tutti principal, assez semblable à la marche des paysans du Freyschütz, parut fort grotesque aux assistants et inquiéta Dœlher. « Mais, disait celui-ci en sortant, la partie principale rachètera tout ; ce monsieur est probablement un habile virtuose ; on ne peut exiger qu’une grande clarinette soit en même temps un grand compositeur. »
Le lendemain, au concert, un peu intimidé par le triomphe éclatant de Dœlher, le clarinettiste entre en scène à son tour.
L’orchestre exécute le tutti, qui se terminait par un repos sur l’accord de la dominante, après lequel commençait le premier solo. « Tram, pam, pam, tire lire la ré la, » comme dans la marche du Freyschütz. Arrivé à l’accord de la dominante, l’orchestre s’arrête, le virtuose se campe sur la hanche gauche, avance la jambe droite, embouche son instrument, et tendant horizontalement ses deux coudes, fait mine de commencer. Ses joues se gonflent, il souffle, il pousse, il rougit ; vains efforts, rien ne sort du rebelle instrument. Il le présente alors devant son œil droit par le côté du pavillon ; il regarde dans l’intérieur comme il eût fait d’un télescope ; n’y découvrant rien, il essaye de nouveau, il souffle avec rage ; pas un son. Désespéré, il ordonne aux musiciens de recommencer le tutti : « Tram, pam, pam, tire lire la ré la, » et, pendant que l’orchestre s’escrime, le virtuose, plaçant sa clarinette, je ne dirai pas entre ses jambes, mais beaucoup plus haut, le pavillon en arrière, le bec en avant, se met à dévisser précipitamment l’anche et à passer l’écouvillon dans le tube...
Tout cela demandait un certain temps, et déjà l’impitoyable orchestre, ayant fini son tutti, était de nouveau parvenu à son repos sur l’accord de la dominante.
« Encore ! Encore ! Recommencez ! » crie aux musiciens l’artiste en pâtiments. Et les musiciens d’obéir. « Tram, pam, pam, tire lire la ré la. » Et pour la troisième fois, après quelques instants, les voilà de retour à la mesure inexorable qui annonce l’entrée du solo. Mais la clarinette n’est pas prête : « Da capo ! encore ! encore ! » Et l’orchestre de repartir gaiement : « Tram, pam, pam, tire lire la ré la. »
Pendant cette dernière reprise, le virtuose ayant réarticulé les diverses pièces du malencontreux instrument, l’avait remis entre... ses jambes, avait tiré de sa poche un canif et s’en servait pour gratter précipitamment l’anche de la clarinette placée comme vous savez.
Les rires, les chuchotements bruissaient dans la salle : les dames détournaient le visage, se cachaient dans le fond des loges ; les hommes se levaient debout, au contraire, pour mieux voir ; on entendait des exclamations, de petits cris étouffés, et le scandaleux virtuose continuait à gratter son anche.
Enfin, il la croit en état ; l’orchestre est revenu pour la quatrième fois au temps d’arrêt du tutti, le soliste réembouche sa clarinette, écarte et élève de nouveau ses coudes, souffle, sue, rougit, se crispe, et rien ne sort ! Quand un effort suprême fait jaillir, comme un éclair sonore, le couac le plus déchirant, le plus courroucé qu’on ait jamais entendu. On eût dit de cent pièces de satin déchirées à la fois ; le cri d’un vol de vampires, d’une goule qui accouche, ne peuvent approcher de la violence de ce couac affreux !
La salle retentit d’une exclamation d’horreur joyeuse, les applaudissements éclatent, et le virtuose éperdu, s’avançant sur le bord de l’estrade, balbutie : « Mesdames et messieurs, je ne sais... un ac... cident... dans ma cla... rinette... mais je vais la faire rac... commoder... et je vous prie de vouloir bien... venir, à ma soirée musi... cale, lundi prochain, ent... en... entendre la fin de mon concerto. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
![]()