6. BENVENUTO CELLINI
Cette page présente les douze articles publiés par Julien Tiersot dans la série Berlioziana avec le sous-titre “Benvenuto Cellini”. Voir la page principale Julien Tiersot: Berlioziana.
Note: pour les lettres de Berlioz citées par Tiersot on a ajouté entre crochets des renvois au numérotage de la Correspondance Générale, par exemple [CG no. 398].
| Le Ménestrel, 5 Février 1905 | Le Ménestrel, 26 Mars 1905 |
![]()
![]() Le Ménestrel, 5 Février 1905, p. 43-44
Le Ménestrel, 5 Février 1905, p. 43-44
BENVENUTO CELLINI
Benvenuto Cellini est une des œuvres du théâtre lyrique dont l’histoire et les transformations sont des plus compliquées qu’on puisse dire.
Les Mémoires de Berlioz en résument la genèse par ces simples mots :
« J’avais été vivement frappé de certains épisodes de la vie de Benvenuto Cellini ; j’eus le malheur de croire qu’ils pouvaient offrir un sujet d’opéra dramatique et intéressant, et je priai Léon de Wailly et Auguste Barbier, le terrible poète des Iambes, de m’en faire un livret. »
D’autre part, Auguste Barbier, qui a publié son poème dans un recueil de pièces de théâtre paru après la mort de Berlioz (1), s’exprime ainsi dans l’avant-propos de Benvenuto Cellini :
« En 1837 (date inexacte), M. Berlioz... eut l’idée d’un drame lyrique qui devait retracer les principaux actes de la vie de Benvenuto Cellini, ciseleur et sculpteur florentin du XVIe siècle. Ce célèbre Italien ayant laissé des mémoires originaux, M. Berlioz y avait puisé plusieurs faits remarquables et en avait composé un grand tableau en quatre parties où, indépendamment des luttes de l’artiste avec ses rivaux et l’autorité gouvernementale, il comprenait la part prise par lui au siège de Rome et à la mort du connétable de Bourbon. C’était un drame sérieux et comportant d’assez longs développements. L’administration de l’Opéra fit des difficultés pour admettre une œuvre aussi considérable de la part d’un musicien qui n’avait pas encore travaillé pour le théâtre et ne voulut exécuter de lui que deux actes d’un genre modéré et écrits dans un ton plutôt gai que tragique. M. Berlioz réduisit sa pensée à la simple lutte de Benvenuto avec le pouvoir, et ce fut un épisode du premier drame qui devint le sujet de la pièce consentie.
« L’histoire de Benvenuto Cellini, poursuit le poète, n’était pas un événement pris au hasard. Le personnage et ses actes avaient quelque rapport avec la situation et le caractère du musicien lui-même. Ce drame était donc une image de sa vie de labeur et de combat ; malheureusement ce ne fut pas celle de son triomphe. »
Benvenuto Cellini fut représenté en 1838, et nous allons voir bientôt que, dès 1834, Berlioz avait formulé sa résolution d’écrire cette œuvre. L’idée première n’en est-elle pas plus ancienne encore ? Aucun document ne nous permet de l’affirmer ; mais nous avons tout lieu de penser que cette idée remonte à l’époque même de son séjour en Italie, en 1831. Contant, dans ses Mémoires, le récit d’un départ de Florence au printemps de cette année, il note ce souvenir : « Je salue du regard le Persée de Benvenuto, et sa fameuse inscription : Si quis te læserit, ego tuus ultor ero, et nous partons » ; et un renvoi donne l’explication des mots latins, ajoutant : « Cette statue célèbre est sur la place du Grand-Duc où se trouve aussi la poste. » Or la statue de Persée est, pourrait-on dire, le principal personnage du Benvenuto de Berlioz, et il aimait à citer son inscription hautaine, que, dans son œuvre définitive, il fait proclamer à voix haute par son héros au dénouement. D’autre part, en cette année d’inaction qui lui fut si pénible, il tua le temps par des lectures. « Une bibliothèque, dit-il en décrivant la vie à la Villa Médicis, totalement dépourvue d’ouvrages nouveaux, mais assez bien fournie en livres classiques (2), est ouverte jusqu’à trois heures aux élèves laborieux, et présente au désœuvrement de ceux qui ne le sont pas une ressource contre l’ennui. » Il est fort à croire que c’est dans cette bibliothèque que Berlioz a lu les Mémoires de Benvenuto Cellini, desquels il a tiré le sujet de son œuvre.
Rentré à Paris, après les aventures passionnelles qui l’absorbèrent pendant toute l’année 1833, il songe à aborder le théâtre. Il écrit à Ferrand, le 15 mai 1834 : « Mes affaires, à l’Opéra, sont entre les mains de la famille Bertin, qui en a pris la direction. Il s’agit de me donner l’Hamlet de Shakespeare, supérieurement arrangé en opéra... En attendant, j’ai fait choix, pour un opéra-comique en deux actes, de Benvenuto Cellini, dont vous avez lu sans doute les curieux mémoires et dont le caractère me fournit un texte excellent sous plusieurs rapports ». [CG no. 398, 15 ou 16 mai]
Continuons l’historique de cette œuvre à l’aide de citations purement documentaires.
Le 31 août suivant, Berlioz écrit au même correspondant :
« Auguste Barbier vient d’éprouver à mon sujet un désappointement assez désagréable. J’avais proposé à Léon de Wailly, jeune poète de grand talent et son ami intime, de me faire un opéra en deux actes sur les mémoires de Benvenuto Cellini ; il a choisi Auguste Barbier pour l’aider ; ils m’ont fait à eux deux le plus délicieux opéra-comique qu’on puisse trouver. Nous nous sommes présentés tous les trois comme des niais à M. Crosnier ; l’opéra a été lu devant nous et refusé. Nous pensons, malgré les protestations de Crosnier, que je suis la cause du refus. On me regarde, à l’Opéra-Comique, comme un sapeur, un bouleverseur du genre national, et on ne veut pas de moi. En conséquence, on a refusé les paroles pour ne pas avoir à admettre la musique d’un fou. J’ai écrit cependant la première scène, le Chant des Ciseleurs de Florence, dont ils sont engoués tous au dernier point. On l’entendra dans mes concerts ». [CG no. 408]
En avril 1835, changement de front : Benvenuto s’oriente vers l’Opéra. « Le nouveau directeur, Duponchel, est engagé avec moi sur sa parole pour un opéra en deux actes. Il demande des changements importants dans le poème ». [CG no. 440, 23 août 1835, à Ferrand. Lettres intimes, que cite Tiersot, date cette lettre d’avril ou mai] Ce sont ces changements dont nous a déjà parlé la préface d’Auguste Barbier.
Le 2 août 1835, dans une lettre à sa sœur Adèle (inédite), nous relevons la première nouvelle qu’il donne à sa famille de ce projet d’opéra. « Duponchel, il y a six mois, s’est engagé sur l’honneur entre les mains de Meyer-Beer et de M. Bertin, en ma présence et devant Barbier, que si, comme il est probable, il devenait directeur de l’Opéra, son premier acte en y entrant serait de s’occuper de me faire écrire un ouvrage ». [CG no. 439]
Le 11 octobre, à sa mère (lettre inédite) : « Je viens d’être reçu à l’Opéra. Le nouveau directeur étant dans de tout autres dispositions que son prédécesseur, je lui ai présenté un opéra en deux actes qui a été fait sous mes yeux par MM. Alfred de Vigny, Auguste Barbier et Léon de Wailly. Il l’a reçu avec le plus vif empressement. En conséquence, je vais me mettre sous peu à écrire la partition ». [CG no. 445]
Le 16 décembre, à Ferrand : « J’ai un opéra reçu à l’Opéra ; Duponchel est en bonnes dispositions ; le libretto, qui, cette fois, sera un poème, est d’Alfred de Vigny et Auguste Barbier. C’est délicieux de vivacité et de coloris. Je ne puis pas encore travailler à la musique, le métal me manque, comme à mon héros (vous savez peut-être déjà que c’est Benvenuto Cellini). » [CG no. 453]
Le 24 décembre, à sa sœur Adèle (inédit) : « Je n’ai pas encore pu commencer mon opéra. Les petits journaux, à notre grand regret, en ont annoncé le sujet. Quelque indiscrétion le leur aura fait connaître. Dieu veuille que les vaudevillistes ne s’en emparent pas avant notre représentation ! » [CG no. 454]
A Liszt, un mois plus tard : « La commission de l’Opéra a demandé à M. Thiers d’autoriser Duponchel à contracter avec moi pour mon opéra. (Le poème est de de Vigny, Barbier et Léon de Wailly). M. Thiers s’y refuse, en disant que, M. Duponchel n’étant pas assuré d’être directeur de l’Opéra à l’époque où ma partition pourrait être représentée, il ne doit pas grever la succession du directeur futur d’un ouvrage qui pourrait ne pas lui convenir. A présent je propose à Duponchel de faire un contrat conditionnel ; il hésite, en mettant en avant l’incertitude où il est que cet engagement convienne à Rossini et à Aguado son banquier. Cet homme s’est jeté à corps perdu dans les bras de Rossini depuis quelque temps, et tu penses quelles conséquences cela peut amener, les bras de Rossini ! A présent, Meyerbeer et Bertin m’engagent à écrire néanmoins mon opéra, persuadés qu’au moment de le monter on trouvera un biais pour y parvenir ; c’est ce que je vais faire. » [CG no. 461, 25 janvier 1836]
A sa sœur Adèle, le 1er juillet 1836 (inédit) : « Je suis dans le grand tourbillon de la composition de mon opéra ; j’en ai à peu près fait la moitié. C’est énormément long à écrire ; mais j’avoue qu’en comparaison de la difficulté que présentent les compositions symphoniques, ce n’est qu’un jeu. » [CG no. 474]
Deux catalogues d’autographes (Charavay) nous donnent enfin les indications complémentaires que voici :
Date et destinaire inconnus : « Il (Berlioz) mande qu’il veut faire entendre à MM. Bertin et Duponchel des fragments de son opéra Benvenuto Cellini. » [CG no. 442, octobre 1835]
A Théophile de Ferrières, 15 août 1836 : « Pour ma partition, j’y travaille de toutes mes forces et j’espère avoir fini dans quelques mois. C’est un rude travail qu’un grand opéra. » [CG no. 476]
Le 2 octobre (3), à Humbert Ferrand : « Je touche à la fin de ma partition, je n’ai plus qu’une partie, assez longue il est vrai, de l’instrumentation à écrire. J’ai, à l’heure qu’il est, l’assurance écrite du directeur de l’Opéra d’être représenté un peu plus tôt, un peu plus tard ; il ne s’agit que de prendre patience jusqu’à l’écoulement des ouvrages qui doivent passer avant le mien ; il y en a trois malheureusement. Le directeur Duponchel est toujours plus engoué de la pièce et se méfie tous les jours davantage de ma musique (qu’il ne connaît pas, comme de juste !), il en tremble de peur. Il faut espérer que je lui donnerai un bon démenti et que mes collaborateurs en consoleront son amour-propre. Alfred de Vigny, le protecteur de l’association, est venu hier passer la journée chez moi ; il a emporté le manuscrit pour revoir attentivement les vers ; c’est une rare intelligence et un esprit supérieur, que j’admire et que j’aime de toute mon âme. » [CG no. 480 bis, 2 octobre 1836, voyez aussi CG no. 443, note 1]
L’on voit par ces divers extraits qu’Alfred de Vigny a pris une part très réelle à l’élaboration du poème. Auguste Barbier a écrit dans la préface déjà citée : « Le poète que M. Berlioz avait cherché pour les paroles de son opéra avait été d’abord M. Alfred de Vigny. Mais ce dernier, occupé d’ouvrages plus importants, désigna comme devant le suppléer dans sa tâche M. Léon de Wailly, qui vint lui-même trouver M. Auguste Barbier et lui demander sa collaboration. Elle lui fut sans peine accordée... » Il n’en est pas moins vrai que Benvenuto Cellini a été annoncé avec le nom d’Alfred de Vigny presque jusqu’à la veille de la représentation ; et nous avons vu par la dernière lettre citée que Berlioz considérait comme « protecteur de l’association » l’auteur de Chatterton et de la Colère de Samson, et que celui-ci ne dédaigna pas de mettre la main à l’ouvrage et d’apporter quelques touches à la versification des collaborateurs en titre.
____________________________________
(1) Études dramatiques
par AUGUSTE BARBIER, auteur des Iambes. Nouvelle édition, Paris, 1874. — L’avant-propos de Benvenuto Cellini est daté : A. B. 1872.![]()
(2) Il résulte de certains renseignements, que nous aimerions à croire inexacts, que les Mémoires de Berlioz sont, aujourd’hui encore, complètement inconnus à la bibliothèque de l’Académie de France à Rome.![]()
(3) Le volume des Lettres intimes date cette lettre de 1835 ; mais l’erreur est manifeste, tous les faits qui y sont contenus (répétitions de la Esmeralda, composition avancée de Benvenuto Cellini, traité ferme avec le directeur de l’Opéra) appartenant à l’année suivante.![]()
![]()
![]() Le Ménestrel, 19 Février 1905, p. 60-61
Le Ménestrel, 19 Février 1905, p. 60-61
(Suite)
Une lettre à Adèle Berlioz, du 22 décembre 1836, annonce que l’opéra est fini : il ne reste plus qu’à écrire la dernière scène et à terminer l’instrumentation. Mais il faut que Stradella de Niedermeyer, puis un opéra d’Halévy, puis encore un autre d’Auber, passent avant le sien. [CG no. 485] — Mêmes particularités dans une lettre à Humbert Ferrand, du 11 avril 1837, avec cette addition : « Mon opéra est fini. » [CG no. 493]
Mais 1837, c’est l’année du Requiem, dont la composition, puis l’exécution, occupèrent suffisamment Berlioz pour qu’il pût attendre avec patience que l’heure sonnât pour Benvenuto Cellini. Il augure favorablement d’ailleurs du bruit fait autour de son œuvre monumentale : « Tout cela arrange fort bien mes affaires à l’Opéra, et je suis à peu près sûr à présent, quand cet interminable opéra d’Halévy (Guido et Ginevra) qu’on répète depuis huit mois sera monté, d’être mis à l’étude ». (Lettre à sa mère, du 17 décembre 1837). [CG no. 529]
Le 19 mars 1838, en effet, il peut écrire à son père : « Enfin on monte mon opéra. Les intrigues se croisent autour de moi depuis mes deux premières répétitions au point de me donner des vertiges ; il faut les suivre cependant, avoir l’œil sur tout, et ne s’effrayer de rien. » [CG no. 547] Tout le printemps et tout l’été se passent en répétitions fiévreuses, avec des alternatives d’espoirs et de craintes. Enfin, le 10 septembre, l’œuvre, après avoir été d’abord annoncée pour le 3, puis remise à huitaine pour indisposition d’un des interprètes, est représentée pour la première fois.
Pour en finir avec cette chronologie antérieure à l’apparition de Benvenuto Cellini devant le public, notons la date d’une lettre écrite à Legouvé et faisant allusion à l’acte de bonne et généreuse amitié qu’accomplit celui-ci en avançant à Berlioz la somme d’argent (le métal, suivant son expression tirée de la dernière scène de l’opéra) qui lui était nécessaire pour activer la composition de son œuvre. Cette lettre est du 31 juillet 1838, et commence ainsi :
« Mon cher Legouvé, je ne sais comment vous dire tout ce que votre noble amitié et votre exquise délicatesse m’inspirent de sentiments d’affection et de reconnaissance (1)... » [CG no. 561]
Malgré le ton de ces effusions, l’on ne peut voir là une réponse immédiate au prêt si à propos consenti (ou plutôt proposé) par Legouvé, car Berlioz a très bien spécifié, et rien ne permet d’en douter, que ce fut pendant qu’il travaillait à la composition de son opéra, alors qu’il n’en avait pas même terminé le premier acte, que Legouvé lui fit l’obligeante proposition que l’on sait. Or, en juillet 1838, on était en pleines répétitions de Benvenuto Cellini. Les paroles de reconnaissance qu’on vient de lire ne sauraient donc se rapporter qu’à quelque épisode nouveau dans lequel Legouvé aurait continué à manifester ses bonnes dispositions à son ami, par exemple en l’assurant (l’hypothèse est très vraisemblable) qu’il n’était pas pressé de rentrer en possession d’une somme qu’avec bien d’autres que Berlioz il aurait pu considérer comme sacrifiée (2).
La scène racontée dans les Mémoires doit donc être placée deux ans et demi environ avant cette lettre. Berlioz s’y plaignait d’être arrêté constamment dans la composition de son opéra par l’obligation où il était d’écrire des articles pour gagner sa vie : et nous avons pu constater en feuilletant la collection du Journal des Débats que si, pendant le dernier semestre de 1835, sa collaboration fut assidue, par contre dans les six premiers mois de 1836 il ne donna à ce journal que trois articles. C’est donc au commencement de cette année même que Legouvé dut faire l’avance qui le tira d’embarras. Et cela s’accorde à merveille avec toutes les lettres dont nous avons cité des extraits : le 16 décembre 1835, faisant déjà usage de son expression favorite, il écrivait : « Je ne puis travailler, le métal me manque », tandis qu’à partir de janvier 1836 nous le voyons résolument à l’ouvrage, qu’en juillet il dit être « dans le grand tourbillon de la composition », et qu’au commencement d’octobre il « touche à la fin » de sa partition.
Benvenuto Cellini tomba.
Il n’entre pas dans le cadre de cette étude de rechercher les causes de cette chute. Disons simplement qu’elles furent multiples, les unes extérieures (la réalité de la cabale ne saurait être mise en doute), d’autres inhérentes à l’œuvre, soit musicale, soit littéraire. De fait, ce poème, sur lequel Berlioz avait fondé tant d’espérances, très différent par le fond et par la forme des livrets de Scribe qui avaient alors imposé leur poétique à la scène lyrique, parut choquant à l’unanimité des auditeurs, et les meilleurs amis de Berlioz furent empressés à sacrifier ses collaborateurs pour le sauver.
Auguste Barbier en convient franchement, se bornant, dans la préface déjà citée, à plaider les circonstances atténuantes : « Quant aux auteurs, y avait-il eu de leur faute dans cet échec ? Le poème était-il mal construit et sans intérêt ? Ce sont des allégations qui ont été formulées à l’apparition de l’ouvrage par quelques organes de la critique, mais sont-elles vraiment justes ? Sans avoir eu la prétention de faire un chef-d’œuvre, les auteurs, renfermés strictement dans une donnée imposée par le compositeur lui-même, ont tâché d’en tirer le meilleur parti possible, etc. »
Berlioz, lui, enregistre aussi le fait, mais il n’abandonne pas ses amis pour cela : « Leur travail, disent les Mémoires, à en croire même nos amis communs, ne contient pas les éléments nécessaires à ce qu’on nomme un drame bien fait. Il me plaisait néanmoins, et je ne vois pas encore aujourd’hui en quoi il est inférieur à tant d’autres qu’on représente journellement. »
Cela même n’est pas assez dire : il ne suffit pas d’accorder que le poème de Benvenuto Cellini, écrit selon les indications d’Alfred de Vigny et de Berlioz par Auguste Barbier et Léon de Wailly, n’est pas plus mauvais qu’un autre livret d’opéra : il faut proclamer, au contraire, qu’en tant qu’œuvre d’art, il est bien supérieur à tout ce qu’on a représenté à l’Opéra pendant la première moitié du XIXe siècle. Les vers ont de la fermeté, de la précision, du pittoresque ; l’action est vivante, très mouvementée, et les quelques accents dramatiques qu’elle comporte sont exprimés en des termes excellents. Peut-être Barbier a-t-il eu raison de dire : « Une personnalité d’artiste est rarement un sujet piquant pour le public des théâtres, d’ordinaire peu au courant des choses de l’art et peu imbu du sentiment esthétique. » Mais on a fait aussi la même objection aux Maîtres-Chanteurs, et ce n’est pas moi qui l’admettrai jamais ; quant au public, s’il est assez peu au courant des choses de l’art pour moins s’intéresser aux aventures de Benvenuto Cellini ou aux rêves de Hans Sachs qu’aux amours d’Alfred et d’Ernestine, c’est tant pis pour lui.
Pourtant le poème de Benvenuto avait des défauts d’appropriation certains. Plusieurs des situations qu’il développait n’étaient pas musicales. Certaines scènes fournissaient au compositeur un si grand nombre de vers qu’il était vraiment impossible que la musique n’offrît pas des longueurs. Enfin, — et c’est cela surtout qui apparut dès le premier jour, — l’œuvre était traitée en un style familier, humoristique, ironique, qui parut déplacé sur la scène de l’Opéra, surtout étant associé aux accords superbes de la musique de Berlioz.
Bref, il fut évident dès le soir de la première que, pour que l’œuvre pût se présenter et se soutenir, il y fallait faire des modifications immédiates. Berlioz y consentit, et entreprit tout aussitôt d’y apporter des remaniements.
Ce travail dura quinze ans, — presque jusqu’au jour où l’auteur commença les Troyens.
Comme l’étude de ces remaniements, par laquelle nous arriverons à reconstituer la forme originale de l’œuvre et à en retrouver, les parties disparues, est la principale raison d’être de cet écrit, que la plupart furent motivés par des modifications au poème, qu’enfin nous possédons celui-ci sous sa forme originale, tandis que la partition gravée est très différente de celle qui fut représentée à l’Opéra en 1838, nous allons tout d’abord analyser avec quelques détails l’action première de Benvenuto Cellini : les lecteurs familiers avec l’ouvrage définitif apercevront eux-mêmes les différences ; pour tous, la connaissance de cette action est nécessaire à l’intelligence de la suite.
____________________________________
(1) J’ai publié dans le Temps (août 1903) cette lettre, qui m’a été obligeamment communiquée par M. Paladilhe, ainsi que le texte inédit d’une dédicace de Benvenuto Cellini que Berlioz, dans sa reconnaissance pour le service rendu, avait projeté d’offrir à Legouvé.![]()
(2) « Il nous a donné en remerciements cent pour cent de notre argent, comme s’il ne nous l’avait pas remboursé », a dit Legouvé dans ses Soixante ans de souvenirs. Il est probable que les vingt mille francs de Paganini, reçus à la fin de cette même année 1838, ne furent pas inutiles à ce remboursement.![]()
![]()
![]() Le Ménestrel, 26 Février 1905, p. 67-68
Le Ménestrel, 26 Février 1905, p. 67-68
(Suite)
Benvenuto Cellini, ciseleur florentin, — « bandit de génie », l’a qualifié Berlioz.
Fieramosca, sculpteur du pape, — ni bandit, ni génie : artiste officiel. Admirons au passage l’heureuse formation de son nom : fiera mosca, « fière mouche » !
Giacomo Balducci, trésorier du pape.
Teresa, sa fille. Celle-ci est courtisée par les deux artistes : ses préférences sont pour le coureur d’aventures, naturellement ; celles du père, non moins naturellement, pour l’homme en place.
Le Cardinal Salviati, camerlingue. Ce personnage, lors de la composition de l’œuvre, était le pape Clément VII en personne ; mais la censure interdit au pape de monter sur la scène de l’Opéra.
Ascanio, élève de Cellini.
Pompeo, spadassin, ami de Fieramosca.
Hommes et femmes du peuple, ciseleurs, gardes, moines, etc., etc.
La scène est à Rome, au XVIe siècle, sous le pontificat de Clément VII, les lundi et mardi gras et le mercredi des cendres.
La première partie du premier acte se passe chez Balducci. Le vieux trésorier, mandé chez le Pape, sort en grognant, laissant seule sa fille Teresa. Des masques passent chantant devant la maison ; le bonhomme remonte pour répéter ses recommandations. S’approchant de la fenêtre, il reçoit une grêle de confetti qui lui couvrent le corps et le visage de taches blanches ; sur quoi Teresa éclate de rire ; et lui de s’écrier, en colère :
Oui, riez, la belle affaire !
Pour changer il est trop tard.
Ah ! grand Dieu ! chez le saint-père
J’aurai l’air d’un léopard (1).
Teresa s’approche à son tour de la fenêtre et reçoit une pluie de fleurs. Les masques s’éloignent, le père s’en va enfin. Dans un bouquet, la jeune fille a trouvé un billet : c’est Cellini qui lui donne rendez-vous, il veut la voir sur l’heure. Et précisément le voici. Mais presque aussitôt survient l’autre soupirant, Fieramosca, qui a profité de la même absence du père. Surprenant le tête-à-tête, il ne se montre pas, et il entend Cellini convenir avec Teresa que le lendemain soir, à la faveur du carnaval, il l’enlèvera sous le déguisement d’un moine en robe brune, avec l’aide de son élève costumé en pénitent blanc.
Soudain le père rentre. Cellini parvient à s’esquiver, tandis que Fieramosca se cache dans la chambre prochaine, où il est surpris par Balducci ; Teresa, ravie de la diversion, appelle à l’aide voisins et voisines, qui se mettent aux trousses du malheureux, et, après avoir empêché toute tentative d’explication de sa part, le jettent bruyamment à la porte.
Le deuxième tableau a pour théâtre la place Colonna, centre de la cohue du mardi gras. Le peuple a, ce jour-là, toute licence pour s’amuser ; la nuit venue, chacun allume des moccoli, petites bougies portées à la main, que l’on s’efforce de se souffler l’un à l’autre. Mais à minuit, le canon du fort Saint-Ange retentit par trois fois : à la troisième, toutes les lumières doivent être éteintes, la place est plongée dans la nuit : le carnaval est fini.
Au début, Cellini et les ciseleurs, attablés devant une auberge, chantent et boivent, célébrant la gloire de l’art. Il y a là une scène épisodique de règlement de compte avec un cabaretier qui est fort pittoresque et caractéristique des mœurs italiennes. Ascanio, l’élève de Cellini, survient au nom du Pape, et fait promettre à son maître que, dès le lendemain, il procédera à la fonte de sa statue de Persée, attendue et promise depuis longtemps. L’artiste s’y engage ; mais la journée d’aujourd’hui n’est pas faite pour le travail : il faut d’abord fêter le carnaval.
Des promeneurs circulent. Fieramosca fait confidence à son ami Pompeo de ce qu’il a entendu la veille : Cellini et Ascanio déguisés doivent enlever Teresa ; il faut qu’ils prennent eux-mêmes le déguisement convenu, et ils opéreront l’enlèvement pour son propre compte.
La nuit vient ; la foule augmente. On chante. On danse l’entraînant saltarello. Et voici les théâtres en plein vent qui s’ouvrent. Balducci et sa fille doivent assister au spectacle : les amis de Cellini en ont profité pour préparer la représentation d’une farce en pantomime, dans laquelle le vieux trésorier sera caricaturé sur la scène : le sujet est le Roi Midas ou les oreilles d’âne. Tout se passe comme on l’avait prévu, et quand, au dénouement, le faux Balducci se pavane sur les tréteaux, exhibant avec complaisance ses longues oreilles, et poursuivi par les coups de batte d’Arlequin, le vrai Balducci ne peut retenir son indignation : il s’élance au milieu des baladins, les menaçant de sa canne, et pendant ce temps laisse sa fille seule au milieu de la cohue. Le moment est bon pour l’enlèvement. Teresa aperçoit à sa droite un moine blanc et un brun : elle va les suivre. Mais voici qu’à sa gauche apparaissent un autre moine blanc et un brun. Lequel est Cellini ? Celui-ci, exaspéré par ce contretemps, ne se démasque pas, mais dégaine et poursuit l’autre moine blanc, qui est Fieramosca : ce brave n’a rien de plus pressé que de tourner les talons. Il provoque donc l’autre, Pompeo, bretteur professionnel, l’étend mort du premier coup, et tente de s’échapper dans la foule.
Grand scandale ! En pleine nuit de carnaval, deux moines qui s’entretuent !
Assassiner un capucin !
Un camaldule… c’est infâme !
— C’est un brigand de l’Apennin.
— C’était l’amant de quelque femme…
Le déguisement de Cellini ne sert plus maintenant qu’à le trahir : à la lueur des moccoli on l’aperçoit, il est enveloppé, on va le saisir... Mais le canon du fort Saint-Ange se fait entendre. Aussitôt les lumières s’éteignent, il fait nuit noire : profitant de l’instant favorable, les amis de Cellini le dégagent ; il s’enfuit, — et voici que précisément Balducci se retrouve d’un autre côté, en face d’un moine masqué : il l’arrête lui-même, croyant que c’est Cellini, — et c’est Fieramosca. La cohue est à son comble ; Ascanio emmène Teresa éperdue, tandis que son père l’appelle en vain ; tout le monde crie ; l’acte est fini.
Jusqu’ici on n’a pas trouvé de très grandes différences entre cette analyse et l’action qui se développe dans la partition connue de Benvenuto Cellini. Mais à partir du second acte (dénommé troisième dans cette partition, où les deux tableaux ont constitué définitivement chacun un acte) ces différences vont s’accuser et devenir considérables.
Le rideau se relève, le mercredi matin, sur l’atelier de sculpture de Cellini, où Ascanio a entraîné Teresa. Celle-ci est dévorée d’inquiétude : qu’est-il devenu ? On entend passer dans la rue une procession de moines chantant les litanies ; Cellini, toujours déguisé, s’est joint à eux ; il rentre, et d’abord raconte les péripéties de sa fuite. Le temps presse, il faut partir. Mais la statue, promise pour le jour même ? Au diable la statue ! Le danger est imminent, Teresa le suivra à Florence ; elle-même l’arme, lui tend sa cuirasse, son épée, et ils échangent des paroles d’amour.
Mais il est déjà trop tard : Balducci et Fieramosca, à la recherche de Teresa, surviennent ; on se dispute à grands cris, quand soudain tout se calme : c’est le Pape qui vient en personne visiter l’atelier de son artiste favori.
Balducci et Fieramosca demandent justice.
Le Saint-Père les écoute avec bienveillance ; pourtant il a un souci qui l’inquiète davantage : la statue ? Cellini est obligé d’avouer qu’elle n’est pas fondue. C’en est trop : qu’on l’arrête, un autre sera chargé d’achever l’œuvre ! Sous cette menace l’artiste se redresse. Un autre fondre sa statue ! Plutôt la détruire de ses propres mains ! Et déjà il a levé son marteau pour briser le plâtre ; tant et si bien que le Pape, trop ami des arts pour consentir un tel sacrifice, se voit, pour le calmer, obligé de lui promettre sa grâce, la main de Teresa, et de l’autoriser à procéder lui-même à la fonte. Mais il veut qu’il finisse à l’instant même, et en sa présence. Cellini a besoin de la journée pour achever ses préparatifs : le Pape se rendra donc le soir à la fonderie ; si l’artiste n’a pas tenu parole, il sera livré à la justice.
Cette analyse, aussi condensée que possible, semble, à quelques détails près, correspondre exactement au sextuor gravé dans la partition ; disons donc, pour indiquer dès maintenant les différences, que, dans l’œuvre originale, ce sextuor était d’un développement au moins double de ce qu’il’est devenu.
Quant au tableau suivant, il nous était, sauf la fin, presque entièrement inconnu.
Le théâtre représentait l’atelier de fonderie établi dans le Colisée, un rideau, au fond, cachant la fournaise. Ascanio, puis Cellini, chantaient des airs qui ont été reportés, plus ou moins arbitrairement, au tableau précédent, de même que le chœur des ouvriers travaillant au dehors : « Bienheureux les matelots. » Mais les scènes suivantes ont complètement disparu. On y voyait Fieramosca, accompagné de deux spadassins porteurs d’immenses rapières, venir, au grand étonnement de tous, provoquer Cellini en duel : rendez-vous était pris immédiatement ; Cellini n’hésitait pas à s’y rendre, malgré ce que son travail avait de pressant, et en dépit des instances de Teresa, revenue auprès de lui en échappant encore une fois à son père. Dans le même temps, les ouvriers, découragés, pas payés, menaçaient, en l’absence du maître, de suspendre l’ouvrage. Fieramosca revenait ; Teresa, le voyant seul, croyait qu’il avait tué Cellini : mais sa provocation n’était qu’une feinte : il n’avait voulu qu’éloigner son rival, et il se présentait aux ouvriers en révolte, les poches pleines d’or, pensant l’occasion bonne pour les débaucher. Il n’en fallait pas plus pour rappeler ces ouvriers modèles à l’honneur de leur art : la tentative de corruption tournait à la honte du corrupteur ; Cellini, après avoir vainement attendu son lâche adversaire, rentrait chez lui, et, l’y trouvant, le menaçait d’un châtiment exemplaire : en attendant, il l’obligeait à se joindre à ses propres ouvriers et à travailler pour lui. L’heure de la fonte était venue, le Pape était là, il fallait accomplir l’œuvre.
Le rideau du fond se relevait donc, et laissait voir la fonderie, avec la perspective du Colisée. Au milieu de la scène, dit le livret, passait une rigole destinée à recevoir le métal en fusion et à l’introduire dans le moule enfoncé sous terre. Dès le début, Fieramosca, heureux d’annoncer une mauvaise nouvelle, venait dire que le métal manquait. Cellini, agité, soucieux, donnait le coup d’œil du maître à l’opération, puis revenait rassurer l’assistance :
De métal je viens de repaître
La chaudière… on double les feux,
A présent tout va pour le mieux.
Mais (ici nous retrouvons l’œuvre définitive) l’accalmie est courte : les ouvriers reviennent, demandant à grands cris encore du métal. Cellini n’en a plus ! La situation est-elle donc désespérée ? Soudain il s’élance, pris d’un magnifique enthousiasme. Qu’on prenne dans son atelier tout ce qui s’y trouve, ses anciens ouvrages d’art, en argent, cuivre, bronze, et qu’on les jette au brasier ! Ses amis, fiévreusement, exécutent cet ordre extraordinaire ; et bientôt on entend un grand bruit : c’est la chaudière qui dégorge, laissant échapper en un jet rayonnant le métal liquide, qui se précipite dans la terre. L’œuvre est accomplie : l’artiste a vaincu.
____________________________________
(1) Nous insistons de préférence, dans cette analyse, sur les développements et les vers qui ont
été supprimés de la partition définitive.![]()
![]()
![]() Le Ménestrel, 5 Mars 1905, p. 76-77
Le Ménestrel, 5 Mars 1905, p. 76-77
(Suite)
Il nous a fallu développer cette analyse, car un résumé plus court, en même temps qu’il eût donné une idée incomplète de la comédie musicale, n’eût pas permis de comprendre les détails qui vont être donnés sur les transformations de la partition.
Mais, avant d’y entrer, il nous faut recommencer à raconter l’histoire de l’œuvre.
Donc, dès le lendemain de la première représentation, Berlioz se mit à faire des coupures. Le 20 septembre 1838 il écrivait à son père: « La seconde et la troisième représentation ont marché à merveille, grâce à la suppression des scènes qui avaient le plus indisposé le public. » Et plus loin, dans la même lettre : « Il a fallu tant de remaniements occasionnés par les changements apportés dans la pièce que j’en suis tout hébété de fatigue. » [CG no. 569] Quatre mois plus tard, au lendemain de la reprise qui eut lieu avec Alexis Dupont dans le rôle abandonné par Duprez (11 janvier 1839), il disait à Jules Janin : « L’opposition s’est bornée à chuter le sextuor du second acte, qui est réellement trop long, et que je vais raccourcir autant que me le permettront les paroles. » [CG no. 619] D’ailleurs le retrait immédiat de l’œuvre rendit ces intentions inutiles.
Plus tard, commençant d’évoquer ses anciens souvenirs, l’auteur écrivait : « Il y a quatorze ans (il fallait dire douze, si, comme il l’affirme, le chapitre des Mémoires qui contient cette phrase fut écrit en 1850) que j’ai été ainsi traîné sur la claie à l’Opéra. Je viens de relire avec soin et la plus parfaite impartialité ma pauvre partition, et je ne puis m’empêcher d’y rencontrer une variété d’idées, une verve impétueuse et un éclat de coloris musical que je ne trouverai peut-être jamais et qui méritaient un meilleur sort. »
Or, quelques mois à peine après qu’il eût exprimé ce mélancolique regret, il survint pour Berlioz une occasion inespérée de voir revivre son œuvre.
C’était l’époque où Liszt, après avoir achevé la première partie de sa carrière consacrée à la haute virtuosité, était allé se fixer à Weimar et y commençait une nouvelle vie d’activité personnelle en même temps que d’apostolat artistique. Son premier acte comme directeur de la musique dans la petite ville de Cour, déjà si riche en grands souvenirs, fut de représenter le Lohengrin de Wagner exilé. Quand cette tâche fut accomplie, il songea à réparer l’injustice commise envers son autre ami, exilé aussi de sa patrie, sinon dans sa personne, du moins dans son œuvre. Car après la chute de Benvenuto Cellini à Paris était venue celle, plus douloureuse encore, de la Damnation de Faust. Liszt fit donc part à Berlioz de son intention de monter son opéra sur la scène grand-ducale de Weimar (juillet 1851).
Ce fut pour lui une immense joie, un baume rafraîchissant mis sur son cœur, désormais profondément ulcéré. Ses lettres à Liszt en témoignent sans contrainte :
J’arrive de Londres, écrit-il le 6 août 1851. Belloni m’apprend que tu as le projet de monter Benvenuto à Weimar. Je te remercie mille fois d’y avoir songé. Ce sera un grand plaisir pour moi de voir ce pauvre ouvrage renaître ou plutôt naître sous ta direction. Je viens de mettre la partition entre les mains de mon copiste, qui la répare et y fait quelques changements que je crois nécessaires. Tout sera prêt dans quelques jours, et Belloni t’enverra le paquet. N’oublie pas de m’informer de son arrivée, car je n’ai pas d’autre copie de cet ouvrage. Puis, quand le copiste de Weimar n’en aura plus besoin, retire-le de la circulation du théâtre. Je sais ce que les manuscrits deviennent dans ces bagarres. [CG no. 1426]
Et le voilà tout aussitôt à la besogne, passant près d’un mois à « panser les plaies de sa pauvre partition », comme il écrira plus tard pour les Troyens. Le 29 août il reprend la plume, et fait à son ami les communications suivantes :
Je n’ai pas perdu de temps, et pourtant je viens de terminer aujourd’hui seulement les réparations de Benvenuto. Je t’assure que maintenant la tâche du copiste n’est plus compliquée. (Suivent quelques lignes d’explications pour le travail matériel, puis il poursuit.) Mais je t’en prie, exige que les copistes ne me dissipent pas ma partition que j’ai eu tant de peine à mettre en bon état.
Après des recommandations minutieuses relatives à plusieurs détails d’interprétation, Berlioz continue :
Maintenant, quelque enfantine que ma joie puisse te paraître, je ne la dissimulerai pas avec toi. Oui, je suis très joyeux de voir cet ouvrage présenté à un public sans préventions et présenté par toi. Je viens de l’examiner sérieusement après treize ans d’oubli, et je te jure que je ne retrouverai jamais cette verve et cette impétuosité Cellinienne, ni une telle variété d’idées. Mais l’exécution n’en est que plus difficile ; les gens du théâtre, les chanteurs surtout sont si déshérités de l’humour ! Au reste, je compte sur toi et sur ta flamme pour pygmalioniser ces statues. [CG no. 1430]
Tout n’alla pourtant pas cette fois encore sans encombre. La représentation était annoncée pour le 16 février 1852, et Berlioz, engagé pour quatre mois de concerts à Londres à partir de mars, se faisait fête de commencer son voyage en assistant à la résurrection de son œuvre. « Je te remercie encore, écrivait-il le 4 précédent, de toutes les peines que tu prends pour cet enfant si malvenu à Paris et que Dieu veuille bien faire venir à Weimar. Je n’ajoute rien, faute de pouvoir trouver… On dit quelquefois ce qu’on ne sent pas, on ressent aussi bien souvent ce qu’on ne dit pas… » Mais voici que cette joie se trouva subitement calmée par la nouvelle de l’indisposition de deux artistes, qui obligea Liszt à reculer la date de la représentation (1) : Berlioz dut partir pour Londres, et c’est là qu’il reçut la nouvelle du succès obtenu en son absence par Benvenuto Cellini à Weimar, le 20 mars 1852 (2).
Malgré la bonne impression produite, Liszt se rendit compte que l’œuvre contenait des parties faibles qu’il était facile de retrancher. Il en fit part à Berlioz, lui annonçant en même temps son intention de donner de nouveau l’ouvrage à la fin de l’année, dans une « semaine Berlioz » à laquelle il l’invitait. Démentant l’opinion préconçue et malveillante précédemment exprimée par Wagner en ces termes : « La susceptibilité de Berlioz est si excessive que même son plus intime ami n’oserait lui faire la proposition de débarrasser ses œuvres d’un bon nombre d’imperfections qui les déparent », l’auteur de la Symphonie fantastique répondit tout aussitôt (2 juillet 1852) :
Tes observations sur Benvenuto sont parfaitement justes ; toute la partie que tu proposes de supprimer m’a toujours paru glaciale et insupportable. Mais personne ne m’avait encore mis sur la voie du moyen tout simple qui en permet la suppression ; c’est toi qui l’as trouvé. Il ne s’agit en effet que de ne pas faire sortir le Cardinal après la scène de la statue et de courir au dénouement. Seulement, j’ai trouvé le moyen de conserver et le chœur des ouvriers : « Bienheureux les matelots » qui commencerait le dernier acte en donnant les soli à Francesco et Bernardino, l’air d’Ascanio (avec un changement de paroles) et l’air de Cellini : « Sur les monts. » Ces trois morceaux, malgré le peu d’élévation du style du second, doivent, je crois, être conservés…
Il y aura un petit travail à faire pour le traducteur, pour reproduire en allemand les drôles de vers que j’ai dû bâcler.
Il résulte de ton idée et de la mienne que l’opéra sera maintenant en trois actes, que la décoration du troisième acte étant celle du dernier tableau, celle du troisième tableau sera supprimée.
La coda six-huit allegro qui terminait le sextuor après le mot pendu disparaîtra, puis nous enlèverons les scènes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 du dernier acte où se mourait si péniblement l’intérêt, au milieu des entrées, sorties, provocations, etc., de Fieramosca, des inquiétudes de Teresa et de l’embauchage des ouvriers.
Je crois qu’ainsi dégagé l’ouvrage pourra marcher. Je vais m’occuper ce soir de faire le récitatif du Cardinal nécessité par la scène qui suivra maintenant le sextuor. Puis je t’enverrai le livret français corrigé, l’air d’Ascanio avec les petites modifications qu’il contient et les soudures bien indiquées. Tu pourras les faire reporter sur la grande partition : mais empêche le copiste de détruire rien dans mon manuscrit. Ne pourrait-on faire copier en entier le manuscrit de ce dernier acte ? Il faudra bien tôt ou tard qu’on le copie, car j’aurai besoin sans doute de mon manuscrit l’hiver prochain et je voudrais bien pouvoir l’emporter quand je reviendrai à Weimar.
Il y a une petite coupure qu’on pourrait faire sans rien déranger si elle est jugée utile ; elle consisterait à ne chanter qu’une strophe de la prière à deux voix de Teresa et d’Ascanio : « Sainte Vierge Marie ». Les Litanies de la Vierge qui l’accompagnent du dehors ne sont plus maintenant censées dites par des pénitents passant dans la rue, mais par une confrérie qui vient suivre le chemin de la croix auprès des petites chapelles établies, comme on le sait, dans le Colysée. Si les deux couplets ne paraissent pas trop longs, j’aimerais mieux toutefois conserver aussi le second. [CG no. 1499]
Ce remaniement, en supprimant onze scènes successives et en pratiquant de larges coupures (notamment dans le morceau le plus développé de la partition, le sextuor) allégeait au moins pour moitié le dernier acte de l’opéra. Deux jours après l’avoir ainsi expliqué à Liszt, Berlioz lui écrivait de nouveau pour lui annoncer qu’il avait consommé le sacrifice (3 ou 4 juillet) :
Voilà, mon cher ami, l’arrangement et la coupure que tu m’as indiqués. Tu seras obligé de prendre la peine de transporter sur la partition les changements que les nouvelles paroles nécessitent dans l’air d’Ascanio et le trémolo d’altos et basses qui accompagne le récitatif du Cardinal. Arrange aussi pour les deux voix de Francesco ténor et Bernardino baryton, le duettino intercalé dans le chœur : « Bien heureux les matelots », et qui était chanté auparavant par Cellini et Ascanio. L’opéra ainsi réduit, surtout si on ne conserve pas la stretta à six-huit du sextuor, ne doit pas dépasser la durée d’un spectacle ordinaire d’Allemagne. D’autant plus sûrement qu’il n’y a plus maintenant que deux changements de décors à faire.
Tu verras dans l’air d’Ascanio des accords qui étaient indiqués forte et col arco dans la première version et qui doivent être maintenant pizzicato et attaqués légèrement. Ils convenaient quand Ascanio contrefaisant Cellini disant avec arrogance : Alors, primo, je veux ma grâce. Maintenant qu’il reproduit au contraire la scène de l’enlèvement et qu’il imite sotto voce d’autres personnages et d’autres dialogues, c’est la nuance opposée qu’il faut. Ne perds pas ces petites feuilles de musique, je n’en ai pas d’autres. [CG no. 1501]
Des feuillets de notes indiquant les changements de texte étaient en effet insérés dans la lettre.
____________________________________
(1) Lettre à Auguste Morel, du 10 février 1852. On y lit encore : « Je suis au fond assez vexé de ne pas aller entendre Benvenuto… J’avais bien nettoyé, reficelé, restauré la partition avant de l’envoyer. Je ne l’avais pas regardée depuis treize ans ; c’est diablement vivace, je ne trouverai jamais une telle averse de jeunes idées. Quels ravages ces gens de
l’Opéra m’avaient fait faire là-dedans ! J’ai tout remis en ordre. » Correspondance inédite, p. 184. [CG no. 1449]![]()
(2) La Gazette musicale du 4 avril 1852 donne à ce sujet un extrait d’une lettre de Liszt, disant : « Honneur aux maîtres ciseleurs ! Gloire aux belles choses et place pour elles ! Benvenuto Cellini, représenté hier ici, restera debout et de toute sa hauteur… Je remercie bien sincèrement Berlioz du noble plaisir que m’a procuré l’étude attentive de son Cellini, qui est une des plus puissantes œuvres que je sache. C’est à la fois de la ciselure splendide et de la statuaire vivante et originale… »![]()
![]()
![]() Le Ménestrel, 12 Mars 1905, p. 83-84
Le Ménestrel, 12 Mars 1905, p. 83-84
(Suite)
C’est pendant le même temps qu’était échangée sur le même sujet une autre correspondance, dont un des écrivains était encore Liszt, ayant, cette fois, pour partenaire, l’autre, le frère ennemi, — pour tout dire, Richard Wagner. Il paraît que celui-ci, dont Liszt avait, quelques mois auparavant, monté Lohengrin, aurait trouvé mauvais qu’il donnât sur la même scène Benvenuto Cellini. Liszt dut s’en défendre une première fois, dans une lettre du 7 avril 1852. A quoi Wagner répondit, le 19 :
« Qu’as-tu donc appris comme venant de moi sur ta représentation de Cellini ? Il me semble que tu me supposes des vues hostiles ? Je voudrais te détromper. »
Et il continue en disant que, puisque Berlioz est l’ami de Liszt, celui-ci a très bien fait de donner son œuvre : cela fait honneur à son bon cœur ; mais quant à penser que cette représentation puisse avoir aucun intérêt d’art, lui, Wagner, n’en croit pas un mot.
Quatre mois plus tard, la discussion recommence. Liszt, ne se tenant pas pour battu, annonce (le 23 août) qu’il attend, pour la saison prochaine, Berlioz « dont le Cellini (avec une coupure assez considérable) ne peut pas être mis de côté, car en dépit de toutes les inepties qui circulent à propos de cette pièce, Cellini est et restera une œuvre tout à fait remarquable et qui mérite d’être très appréciée. Je suis sûr qu’il te plairait à bien des égards ».
A ce coup droit, Wagner veut répondre (8 septembre). Il le fait longuement, et une partie de son développement est très intéressante. Mais nous n’avons à retenir ici que ce qui touche directement à notre sujet ; voici donc comment à cet égard il s’exprime :
A parler franchement, je suis fâché de voir que Berlioz veut ou doit se mettre encore à remanier son Cellini. Si je ne me trompe, cet ouvrage remonte à plus de douze ans ; est-ce que Berlioz ne s’est pas assez développé depuis ce temps-là pour faire quelque chose de tout autre ? Quelle maigre confiance en lui-même a-t-il donc pour être obligé de revenir à un travail qui date de si longtemps ?… Jamais Berlioz ne remettra ce malheureux Cellini à flot ; mais qui vaut donc plus, Cellini ou Berlioz ? Abandonnez donc le premier et relevez le second ! C’est quelque chose d’horrible pour moi que d’assister à ces tentatives de galvanisation et de résurrection ! Que Berlioz écrive donc un nouvel opéra pour l’amour du ciel ! Ce sera son plus grand malheur s’il ne le fait pas.
Ce dernier trait, cet appel vibrant au travail, à la production « quand même », est fort beau ; il pouvait être à bon droit lancé par celui qui, alors au milieu de la mêlée, était dans tout le feu de la composition de l’Anneau du Nibelung. On pourrait objecter que Berlioz n’aurait pas demandé mieux que d’écrire un nouvel opéra, s’il avait su qu’en faire… Quant aux critiques qui précèdent, aucune ne se tient debout. Il est assez piquant de voir Wagner, qui tout à l’heure blâmait Berlioz de ne jamais consentir à recevoir un conseil qui lui permit de corriger ses œuvres, lui reprocher maintenant de faire des retouches à son opéra. Mais lui-même, considérait-il donc ses compositions anciennes comme si intangibles et définitives ? N’a-t il pas refait trois fois le dénouement de Tannhäuser ? N’y a-t-il pas mis des additions considérables quand on représenta cette œuvre à Paris, non pas douze ans, mais dix-huit ans après sa première apparition ? N’a-t-il pas fait d’autres modifications encore plus tard, à Munich, quand Schnorr, sur ses indications, modifia de fond en comble l’interprétation du personnage pricipal, à Vienne, où il changea la fin de l’ouverture, un morceau consacré s’il en fût ! Et le Vaisseau fantôme ! Et Rienzi ! Qu’on ouvre les partitions autographiées de ces deux œuvres, sur lesquelles Wagner a lui-même multiplié les corrections à l’encre rouge, effaçant des paquets de trombones et de trompettes, changeant la disposition de tel passage, de telle partie, donnant ainsi la preuve du droit qu’a un auteur de retoucher les œuvres de sa jeunesse en les faisant profiter des progrès acquis par son expérience postérieure.
Notons aussi que de ce Benvenuto Cellini, que Wagner déclarait n’être pas viable, il ne connaissait pas une note, pas plus qu’il ne connaissait la Damnation de Faust que, dans cette même lettre, il appelle une « symphonie », et qu’il qualifie de « platitude » (1).
____________________________________
(1) J’ai eu déjà l’occasion d’énoncer cette dernière affirmation. Elle a été contestée. Je la maintiens de la façon la plus formelle. Nous sommes assez bien fixés sur les circonstances de la vie des deux maîtres pour savoir qu’en 1852 Wagner n’avait pas pu avoir une seule occasion d’entendre la Damnation de Faust, ni d’en lire la partition, qui n’était pas encore publiée. Il en est de même pour Benvenuto Cellini, qui ne fut donné à Paris qu’en 1838 et au commencement de 1839, tandis que Wagner n’arriva en France qu’en septembre de cette dernière année ; quant à la partition, il n’en avait paru rien autre que quelques morceaux de
chant qui, sauf le premier trio et le chant du Cardinal, sont les moins bonnes
parties de l’œuvre.![]()
![]()
![]() Le Ménestrel, 19 Mars 1905, p. 91-92
Le Ménestrel, 19 Mars 1905, p. 91-92
(Suite)
Liszt lui répondit le plus simplement du monde (le 7 octobre) : « Tu étais mal informé, et tu avais tort de croire que Berlioz avait entrepris un remaniement de son Cellini. Tel n’est pas le cas : il s’agit seulement d’une coupure très considérable (à peu près un tableau tout entier) que j’ai proposée à Berlioz et qu’il a approuvée, de sorte qu’à la prochaine représentation Cellini sera donné en trois tableaux au lieu de quatre. Si cela t’intéresse, je t’enverrai le nouveau libretto avec l’ancien ; je pense que tu approuveras et la modification et la réunion des deux derniers tableaux en un seul. » L’histoire ne dit pas si Wagner approuva. Cela n’est pas probable.
Liszt exagérait un peu en disant que la seule modification apportée à Benvenuto Cellini consistait en une simple coupure. La suite de sa correspondance avec Berlioz montre clairement que bien des retouches de détail furent encore effectuées. Berlioz assista, et avec une grande joie, à la « semaine » qui lui fut consacrée à Weimar en novembre 1852, où il put voir deux fois son opéra, le 17 et le 21 (1) ; mais il ne se montra pas encore pleinement satisfait de son œuvre. Rentré à Paris, nous lui voyons écrire déjà, le 30 novembre :
J’ai trouvé en revenant une assez bonne modification à apporter au dénouement de Cellini, je la ferai dès que la partition me sera revenue. J’ai profité aussi de ton observation pour le petit mesquin Allegro fugué en mi majeur qui interrompt le sextuor ; cela est du plus petit style d’opéra-comique, et je le supprime. Ce sont les paroles qui m’avaient amené à l’écrire ; on peut parfaitement les faire disparaître, elles ne tiennent en rien à l’action. Je vais limer cette scène, dont plusieurs détails ne me satisfont pas. [CG no. 1538]
A la fin du mois suivant, le 29 décembre :
J’attends toujours avec impatience ma partition de Benvenuto, plus le second acte copié par ton copiste. J’en ai le plus grand besoin pour y appliquer la traduction italienne qu’on vient de finir… Le traducteur allemand a fait un grand nombre de changements dont plusieurs sont très malheureux. Je les signale dans la partition, que je te renverrai avec plusieurs corrections importantes que je viens de faire au 3e acte (dans l’instrumentation et le dénouement). Sois assez bon pour faire rectifier tout cela. La fin est bien mieux maintenant, l’on voit Persée fondu et encore rouge incandescent. Tu verras combien de petites vilenies j’ai ôtées. [CG no. 1549]
Le changement qui vient d’être expliqué est en effet l’une des plus appréciables améliorations qu’ait reçues la pièce. Nous avons vu par l’analyse que, dans le poème original, on assistait simplement au spectacle de la fonte, que l’on voyait le métal en fusion s’écouler de la chaudière et pénétrer, par une rigole, dans le moule, qui restait clos : cette opération industrielle, pour intéressante qu’elle puisse être, n’était pas d’une grande beauté décorative. Maintenant, c’est l’œuvre d’art, la statue, Persée lui-même, qui apparaît tout en feu : idée de vrai poète ; et, par cela seul, Berlioz, qui l’a eue, outre qu’il a apporté bien d’autres modifications heureuses à l’œuvre littéraire, doit en être considéré vraiment comme le principal auteur, autant et plus que de Vigny, de Wailly ou Barbier.
Cette correspondance si circonstanciée nous a permis de constater toute la part qui lui revient dans cette collaboration ; elle nous a fait surprendre aussi les hésitations de l’auteur, connaître le détail de ses trouvailles, permis, en un mot, d’assister nous-mêmes à l’élaboration entière de son œuvre, et cela, certes, est hautement intéressant.
Même encore à ce moment la forme n’est pas absolument définitive. Le 14 janvier 1853, Berlioz écrit à Liszt :
Je travaille beaucoup depuis quelques jours à notre Benvenuto, que je lime maintenant à loisir et que je te renverrai plus poli et plus complet. Le traducteur italien a une peine atroce à se tirer de sa tâche, qui, dans le fait, n’est pas aisée. [CG no. 1556]
Cette traduction italienne, dont il était déjà question dans la citation précédente, était faite en vue d’une représentation de Benvenuto Cellini qui eut lieu à Londres dans le courant de la même année.
Poursuivons et achevons ce récit épistolaire.
J’ai pris le parti d’écrire moi-même l’accompagnement de piano, que je ferai revoir ensuite à l’un ou l’autre des pianistes de ma connaissance pour en corriger les gaucheries. Mais ce travail est fort long, et je n’ai encore fait que la réduction du premier acte. Je te renverrai une partition bien en ordre, avec plusieurs corrections de détail, que tu feras reporter dans les parties séparées. Chaque passage modifié sera indiqué avec soin dans ton exemplaire. Tu trouveras un nouveau dénouement, ou au moins un moyen admissible pour faire paraître au dénouement la statue fondue et encore incandescente. J’ai dû ajouter pour cela quelques vers au rôle de Cellini, et ces vers se chantent sur le morceau instrumental qui précède le moment du coulage de Persée.
Le troisième acte aussi commence autrement et sans augmenter la durée de plus de deux minutes. [CG no. 1568, 23 février 1853, voyez aussi la note no. 2 par l’editeur de la CG]
C’est dans cette même lettre que Berlioz parle ainsi à Liszt au sujet de l’autographe de Benvenuto Cellini :
Ta demande du manuscrit me touche beaucoup, et je comprends le prix que tu y attaches. Cet ouvrage t’est cher comme le deviennent les convalescents au médecin qui les a sauvés d’une maladie mortelle. Je serai donc bien heureux de te le conserver. En tout cas, si Faust est publié le premier, ce manuscrit là aussi te revient de droit.
Nous devons sans doute au refroidissement qui survint plus tard entre Berlioz et Liszt, et dont Wagner est l’auteur responsable, que les partitions autographes de la Damnation de Faust et de Benvenuto Cellini aient été conservées à la France. C’est une compensation…
Benvenuto Cellini fut donné à Londres le 25 juin 1853. Une lettre de Berlioz à Liszt, du 4 mars, lui fait connaître le projet de cette représentation, et lui parle encore de copies de la partition et de parties qui doivent être exécutées sous ses yeux à Paris. Le 10 juillet il lui fait part des incidents de la soirée, qui fut tumultueuse, et resta unique, car l’auteur retira immédiatement son œuvre, tombée une seconde fois sous une cabale plus manifeste encore que celle de Paris. Berlioz se loue d’ailleurs grandement, dans cette dernière lettre, du dévouement des interprètes, notamment de Tamberlick, qui, par son caractère d’artiste aussi bien que par son talent, lui fit oublier ce que, quinze ans auparavant, Duprez lui avait fait souffrir. Il mentionne enfin d’ultimes modifications apportées encore à l’œuvre :
Plusieurs détails de la partition ont été améliorés, de petites coupures heureuses pratiquées, et des effets de mise en scène ajoutés. Je suis obligé de te renvoyer les deux derniers actes pour que ton lent copiste puisse mettre en ordre tous ces changements. Je t’écrirai alors une lettre explicative… Gye (le directeur de Covent Garden) a voulu garder néanmoins une copie de ce damné opéra. A-t-il pour plus tard quelque arrière-pensée ? Je l’ignore.
Des journaux anglais, parlant des dernières représentations de Weimar, disent qu’elles ont lieu sous la direction de l’intrépide Liszt. Eh bien, que cette dernière défaite de ton protégé n’ôte rien à ton intrépidité, je t’assure que le Cellini est plus digne que jamais de ta protection, et tôt ou tard, je l’espère, il fera honneur à son patron. [CG no. 1617]
Il ne tarit pas dans l’expression de sa reconnaissance envers celui qui a eu confiance en son œuvre. Six mois plus tard encore, le 15 janvier 1854, il lui écrit :
Je ne puis te dire combien ta sollicitude pour mon malheureux opéra me touche et me pénètre d’admiration. Tu es en tout un homme à part. Je le sais depuis longtemps, mais ces monstruosités-là sont si rares, qu’il est presque permis de s’en étonner. Oui, certes, je te donne carte blanche pour aviser au destin de Cellini, et j’abonde dans ton sens pour accorder la préférence à Dresde. Je suis aussi de ton avis, il faut commencer par le publier en Allemagne… si l’on peut. [CG no. 1690]
Des deux projets exposés dans ces dernières lignes, un seul fut réalisé : la partition pour piano et chant, que Berlioz, dans la même lettre, exprimait le désir de voir éditer par la maison Breitkopf et Haertel, fut publiée un peu plus tard, non par cette maison, mais par celle que Litolff venait d’établir sous son nom à Brunswick. Berlioz voulut en offrir la dédicace à la Grande-Duchesse de Saxe-Weimar, sous les gracieux auspices de qui avaient eu lieu les représentations. Quant à la représentation de Dresde, la perspective en souriait fort à Berlioz, dont les concerts avaient maintes fois reçu bon accueil dans cette ville ; mais, par suite d’une succession de difficultés dans le détail desquelles il n’est pas utile d’entrer ici, elle ne fut pas réalisée (2). Il fut aussi question de donner l’œuvre à Saint-Pétersbourg, mais sans plus de résultats.
____________________________________
(1) « Cette petite excursion en Allemagne, écrit-il, a été la plus charmante que j’aie jamais faite dans ce pays-là. Ils m’ont comblé, gâté, embrassé, grisé (dans le sens moral)… J’ai fini par pleurer comme deux douzaines de veaux, en songeant à ce que ce même Benvenuto m’a valu de chagrin à Paris. » Lettre à Auguste Morel du 19 décembre 1852, Correspondance inédite, 198. [CG no. 1542]![]()
(2) Sur ces diverses circonstances, voir les lettres de Berlioz à Liszt des : fin juillet 1853 [CG no. 1620], fin avril, 10 mai, 21 juillet, 10 septembre 1855 [CG nos. 1935, 1965, 1996, 2012], 12 avril et 29 juin 1856 [CG nos. 2115 et 2149], ainsi qu’une lettre à la Princesse Wittgenstein du 25 ou 26 décembre 1856 [CG no. 2195], et deux à Hans de Bulow des 28 juillet et 1er septembre 1854 [CG nos. 1777 et 1785].![]()
![]()
![]() Le Ménestrel, 26 Mars 1905, p. 99-100
Le Ménestrel, 26 Mars 1905, p. 99-100
(Suite)
Benvenuto Cellini resta longtemps au répertoire du théâtre de Weimar. L’auteur parle encore, dans une lettre du 12 avril 1856, d’une représentation qui venait d’en être donnée [CG no. 2115, à Liszt]. Vers le même temps — et déjà Berlioz était en pleine gestation des Troyens, — il y eut un projet de le représenter à Paris, au Théâtre-Lyrique, « avec une partie du livret mise en prose pour le dialogue et quelques changements avantageux qu’y ont introduits les auteurs (1) ». Benvenuto, conçu d’abord pour être un opéra-comique, serait donc ainsi revenu à sa destination première. Il ne semble pas que l’on doive regretter que cette idée n’ait pas été réalisée. Si l’œuvre originale contenait des imperfections, la triple expérience de Paris, de Weimar et de Londres suffit amplement pour que l’auteur ait pu les apercevoir, et les retouches qu’il y apporta patiemment pendant quinze années, en en modifiant considérablement l’économie générale, étaient arrivées à un point tel que de nouveaux changements n’auraient pu que la gâter.
Donc, négligeant les remaniements intermédiaires, nous allons considérer parallèlement ce que nous pourrions appeler les deux partitions de Benvenuto Cellini : celle qui fut représentée à Paris en 1838, et celle qu’après les représentations de Weimar et de Londres Berlioz publia à Brunswick sous forme de réduction au piano, version dont son manuscrit autographe nous a laissé la forme complète, et que nous devons tenir pour définitive.
Les documents dont nous disposons pour cette étude sont, par ordre chronologique, les suivants :
1° La partition autographe, reliée en trois volumes grand in-folio, appartenant à la Bibliothèque du Conservatoire, n° 14.981. Ce document devait être cité en premier lieu, puisque c’est d’après lui qu’ont été exécutés tous ceux qui vont suivre. Mais il a subi toutes les vicissitudes des remaniements, et, en définitive, il ne représente plus aujourd’hui la première forme, mais, au contraire, la forme dernière de Benvenuto Cellini.
2° Le matériel de l’Opéra, ayant servi pour les études et les représentations de Paris, en 1838-1839. Il est considérable, comprenant entre autres une copie de la partition d’orchestre en cinq gros volumes reliés, une partie dite de violon principal (4 cahiers), qui servait de conducteur et donnait une réduction complète de l’orchestre, les parties d’orchestre, de chœur (partitions et parties), les rôles, etc. Tout cela est conservé en très bon état et très bon ordre à la Bibliothèque de l’Opéra. La copie en cinq volumes non destinée à l’exécution, nous fait connaître en son intégralité (sauf une large coupure dont nous aurons à parler) la partition de Benvenuto Cellini telle qu’elle fut mise en répétitions à l’Opéra. Les parties d’orchestre, et en premier lieu le conducteur, portent les traces patentes des remaniements de toute sorte apportés à l’ouvrage, soit au cours des répétitions, soit après la première représentation. Cet ensemble de documents sera d’une utilité de premier ordre si jamais quelqu’un veut entreprendre de reconstituer l’opéra de Berlioz sous sa forme originale.
3° Le livret distribué et mis en vente pour les représentations de l’Opéra, conforme, en conséquence, à ces représentations (A Paris, D. Jonas, éditeur, à l’Opéra, — Barba, libraire, Palais-Royal, 1838).
4° Les morceaux séparés parus quelques mois après la première représentation, savoir :
L’ouverture, en partition d’orchestre, sous le titre de Grande ouverture de Benvenuto Cellini, Opéra semi-seria en 2 actes, dédiée à M. Ernest Legouvé et composée par HECTOR BERLIOZ (chez Schlésinger) ;
Neuf morceaux séparés de chant « avec accompagnement de piano, par A. Morel » (chez Schlésinger) ; la date de dépôt inscrite sur les exemplaires de la Bibliothèque du Conservatoire est « Juillet 1839 ». Ces morceaux, dont le catalogue thématique est gravé sur le titre, sont : Sérénade (Cellini) ; Cavatine (Teresa) ; Trio ; Romance : « La gloire était ma seule idole » (Cellini) ; Air (Fieramosca) ; Duo (Teresa, Cellini) ; Air (c’est la phrase d’entrée du cardinal dans le sextuor) : « A tous péchés pleine indulgence) ; Air (Ascanio) ; Air : « Sur les monts les plus sauvages » (Cellini).
5° L’édition pour piano et chant publiée, avec double texte allemand et français, dans la Bibliothek classicher Opern (21e Lieferung), Brunswick, Henry Litolff, 1858 (date donnée par les Mémoires).
6° Une autre édition pour piano et chant, purement française, Paris, Choudens, 1865 (date également donnée par les Mémoires).
La coexistence de ces deux éditions pour piano et chant a donné lieu, après une trentaine d’années durant lesquelles elles ont pu concuremment circuler dans le public, à des difficultés qui ont abouti au retrait de la partition française (2). Il paraît que l’autorisation de publier, donnée en premier lieu par l’auteur à la maison allemande, constituait pour cette dernière un droit de propriété pour tous pays, encore que cela fût manifestement contraire aux intentions de Berlioz (3), qui, conformément aux usages de son époque, a plus d’une fois fait éditer ses œuvres soit en Allemagne ou en Angleterre, voire en Italie ou en Suisse, en même temps que ses éditeurs français les publiaient sans difficulté. Il est résulté de cette interprétation des traités que, si Berlioz n’a jamais reçu la moindre part de droits d’auteur de la maison allemande (qui dut lui faire sentir qu’elle lui faisait une grande faveur en consentant à l’éditer), par contre, les héritiers de sa propriété artistique ont été contraints de désintéresser l’éditeur français du dommage qui lui était causé par l’interdiction de jouir d’un droit qu’il croyait avoir acquis. De sorte que l’édition de Benvenuto Cellini a constitué pour Berlioz et ses ayants droit une opération financière qui se résume en ces deux termes : 1° Aucun droit d’auteur perçu pour la cession de la propriété à une maison qui en a réalisé un important bénéfice (car Benvenuto Cellini, peu répandu en France, a eu au contraire grand succès en Allemagne, où on le joue partout) ; 2° Obligation de verser une indemnité à un tiers pour permettre au premier éditeur de jouir tranquillement de son droit, acquis gratuitement. Berlioz a toujours eu de la chance dans le côté pratique de ses entreprises ! Et voici encore une autre conséquence de cette situation bizarre : conformément aux lois allemande et française, les œuvres de Berlioz sont tombées dans le domaine public en Allemagne depuis cinq années, tandis qu’il en faut quinze encore pour qu’il en soit de même en France. Or, durant les vingt années qui font la différence de trente à cinquante ans durant lesquels la propriété artistique survit à l’auteur dans les deux pays respectifs, l’éditeur français a eu et aura tous les droits possibles de répandre son édition en Allemagne, tandis qu’en France c’est l’édition allemande seule qui a le droit d’exister ! Il y a des cas où il semble que l’on puisse dire à bon droit, non pas : Dura lex, mais Stulta lex… sed lex !
7° Le poème de Benvenuto Cellini, avec préface d’Auguste Barbier, dans les Études dramatiques de ce dernier mentionnées dès la première page de ce chapitre, 1874.
8° La partition d’orchestre, publiée en 1886, d’après le manuscrit de la Bibliothèque du Conservatoire (chez Choudens). Nous avons plaisir à constater (ayant eu à faire des réserves quant à la publication analogue des Troyens) que cette édition est excellente, d’une irréprochable fidélité, et de tout point conforme à la volonté de Berlioz. Nous observerons aussi que le droit de l’éditeur français sur la partition d’orchestre n’a pas été contesté, l’éditeur allemand n’ayant pas publié Benvenuto Cellini sous cette forme, et ne pouvant, en conséquence, exercer son droit que sur la partition au piano.
Les lettres de Berlioz attestent enfin qu’il a été fait, à diverses époques, plusieurs copies de son opéra, destinées aux théâtres de Weimar, Londres, Dresde, etc. Il est probable que l’on pourrait retrouver ces copies, exécutées pour la plupart dans la période intermédiaire entre la première représentation parisienne et la constitution de la partition définitive. Mais comme il n’y a, en somme, que deux formes, la première et la dernière, qui soient de nature à nous intéresser, nous pouvons tenir pour négligeables ces documents divers, lesquels sont d’ailleurs un peu trop hors de notre portée.
___________________________________
(1) Lettre à la Princesse Wittgenstein du 25 décembre 1856. [CG no. 2195; 25 ou 26 décembre] ![]()
(2) Jugements du Tribunal civil de la Seine, du 16 novembre 1888, et de la Cour d’appel de Paris, du 25 juin 1890. Voy. Gazette des Tribunaux du 30 juin 1890.![]()
(3) Nous avons déjà reproduit ces mots d’une lettre de Berlioz à Liszt, du 15 janvier 1854 : « Il faut commencer à publier Benvenuto en Allemagne… si l’on peut. » Si donc Berlioz voulait commencer ainsi, c’est qu’il avait l’intention de continuer en France, s’il pouvait. La même lettre contient sur ses intentions d’autres indications que voici : « Il ne saurait y avoir d’obstacles de la part de Brandus (successeur de Schlésinger, qui avait édité l’ouverture pour orchestre et neuf morceaux de chant avec piano). Les morceaux détachés de cette partition qui lui appartiennent n’ayant pas été publiés en Allemagne depuis qu’il les a mis en vente en France, sont en conséquence tombés dans le domaine public à l’étranger, et je n’ai jamais fait avec lui ni avec son prédécesseur Schlésinger de traité quelconque pour l’ensemble de la grande ni de la petite partition. On a publié aussi sans difficultés la Cavatine de Teresa à Vienne. Ces morceaux sont à tout le monde, le reste n’est qu’à moi. Il ne faudrait pas néanmoins abandonner l’avantage qu’il pourra y avoir à laisser Brandus publier la partition de piano avec texte français et italien à Paris. » Il y a là l’exposé de coutumes différentes de celles qui sont en vigueur aujourd’hui ; en tous cas, l’intention de Berlioz de se réserver le droit de publier son œuvre en France s’affirme à chaque phrase.![]()
![]()
![]() Le Ménestrel, 2 Avril 1905, p. 107-108
Le Ménestrel, 2 Avril 1905, p. 107-108
(Suite)
Nous allons donc étudier, en les confrontant, les formes diverses de l’œuvre, avec la préoccupation, les partitions gravées représentant le connu, de trouver l’inconnu et l’inédit dans les documents de la première période.
Nous pouvons annoncer dès maintenant que cette recherche sera féconde.
Nous considérerons l’opéra scène par scène, en passant rapidement sur celles qui n’ont pas été touchées. Les lecteurs peu familiers avec Benvenuto Cellini pourront nous suivre facilement s’ils veulent bien se reporter à l’analyse du livret que nous avons donnée plus haut, analyse qui, répétons-le, correspond à la première forme, celle de 1838, et non à celle des partitions postérieures.
En ce qui concerne le titre, nous signalerons les particularités suivantes :
Dans la partition autographe, ce titre est libellé ainsi :
BENVENUTO CELLINI
Opéra en 2 actes et en 4 tableaux.
Paroles de MM. LÉON DE WAILLY et AUGUSTE BARBIER.
Musique de M. HECTOR BERLIOZ.
Représenté (une rature) (1) pour la première fois à l’Académie Royale de Musique de Paris, le 3 septembre 1838.
Avant le lever de la toile, l’orchestre exécutera l’ouverture (gravée) de Benvenuto Cellini.
Avant de commencer la seconde partie du premier acte, il exécutera celle du Carnaval romain (gravée également).
Constatons sans plus tarder une erreur de ce titre autographe : la date y est inexactement rapportée. Nous l’avons dit déjà : la première représentation de Benvenuto Cellini avait été annoncée pour le 3 septembre 1838 ; mais, au dernier moment, elle fut ajournée d’une semaine, et eut lieu le 10 (2). Cependant, le livret, imprimé d’avance, portait la date du 3 : il a trompé tout le monde, à commencer par les deux auteurs, car, à l’exemple de Berlioz pour le titre de sa partition autographe, Auguste Barbier a indiqué la date du 3 septembre dans son édition du poème. Inutile de dire que tous les répertoires courants, Fétis, Félix Clément, Chouquet, etc. sont unanimes à rééditer cette erreur.
Deux autres documents nous font part d’une particularité intéressante : la partition de l’ouverture, publiée en 1839, et la partition au piano publiée en Allemagne près de vingt ans après (1858), sont d’accord pour appeler Benvenuto Cellini, Opéra semi-seria. Cette persistance à travers une si longue période semble indiquer que cette qualification a été donnée par l’auteur lui-même.
N’insistons pas sur les différences d’énumération des actes : rappelons seulement qu’à l’origine Benvenuto Cellini était divisé en deux actes, dont chacun comportait une première et une seconde partie, et que plus tard, bien qu’allégé par de nombreuses coupures, il fut dit opéra en trois actes, les deux premiers correspondant aux deux parties du premier acte original, le troisième formé par la réunion de l’ancien second acte en un seul tableau, avec coupure de près de la moitié des scènes.
Nous savons déjà que l’ancienne partition de l’ouverture est dédiée à Ernest Legouvé. Mais l’édition allemande de la partition porte, sur un feuillet à la suite du titre, cette autre dédicace :
A son Altesse Impériale et Royale Maria Pawlowna, Grande-Duchesse de Saxe-Weimar, hommage de la respectueuse reconnaissance de l’auteur. HECTOR BERLIOZ.
Le titre de cette même édition dit encore : Traduction allemande de M. P. Cornelius. Dans sa lettre à Liszt, du 15 janvier 1854, Berlioz disait simplement : « Remercie mille et mille fois M. Cornelius de vouloir bien se charger avec toi de la révision du texte allemand. Il me comble, ajoute-t-il : tu communiques tes mauvaises qualités à tout ce qui t’entoure. » [CG no. 1690] On peut croire qu’entre l’époque de cette lettre et celle de l’édition, la collaboration de Peter Cornelius devint plus effective que ne semblaient l’indiquer ces mots.
Enfin l’édition allemande donne l’ouverture sous forme de réduction à quatre mains par Hans de Bülow. Nous connaissions l’existence de cette transcription par une lettre adressée à Bülow même par Berlioz, qui lui en fait de grands compliments (lettre du 28 juillet 1854 [CG no. 1777]).
L’ouverture manque à l’autographe : nous ne pourrons donc faire aucune observation sur la rédaction première de ce morceau célèbre. Disons simplement que la présence d’assez nombreuses collettes sur les parties d’orchestre de l’Opéra indique que l’œuvre n’alla pas à l’exécution sans avoir subi déjà quelques retouches de détail.
Et maintenant, que le rideau se lève : le spectacle va se dérouler devant nos yeux.
Le commencement de la première scène va déjà, par l’autographe, nous faire connaître quelques menues particularités. L’on sait qu’un des grands griefs du public de 1838 fut qu’il y avait, dans le poème de Benvenuto Cellini, des expressions peu convenables. Les Mémoires avouent que certains récitatifs contenaient des mots « appartenant au vocabulaire des injures et dont la crudité est inconciliable avec notre pruderie actuelle » ; mais Berlioz raille les gens au goût si délicatement épuré que choquaient ces mots : « Les coqs chantaient. » « Ah ! ah ! disaient-ils, les coqs ! pourquoi pas les poules ? » Mais d’abord, oui : pourquoi pas les poules ? C’était bien la peine que, depuis dix ans et plus, les romantiques eussent proclamé le droit à la vérité de l’expression littéraire ! Mais on sait que le mouvement musical retarde toujours sur celui des autres arts, et les gens de l’Opéra, en 1838, en étaient encore au temps où un coq devait être appelé « le messager de l’aurore » ou « le clairon du matin ».
Nous trouvons donc, dans le manuscrit de la première scène, la trace d’une première retouche motivée par cet état d’esprit. Balducci, en sortant, demandait à sa fille : « Ma canne et mon chapeau. » Fi donc ! de telles vulgarités se pouvaient-elles souffrir ? Il fallut mettre : « Ma dague et ce carton » : et, pour la rime correspondante, « Mon manteau » fut remplacé par « Mon bâton ». Graves préoccupations de plusieurs grands artistes !
Mais, dans cette scène même, nous avons mieux à trouver. Balducci, après une fausse sortie, revenait, et, s’adressant à sa fille, lui parlait ainsi : « Pour écarter tous les galants, un bon sermon… » Ces mots, et leur musique, ont été effacés de l’autographe, et la suite coupée. Le matériel de l’Opéra nous a appris qu’il y avait là tout un morceau chanté par Balducci, supprimé dès avant la représentation (car il n’y en a aucune trace dans le livret), et qui renfermait des vers charmants. Le père adressait à sa fille de sages conseils, imités de ceux de Polonius à Ophélie, mais d’un ton plus dégagé, disant :
Pour écarter tous les galants
Un bon sermon vaut une porte.
Ma fille, avant que je ne sorte,
Ecoutez-moi, venez céans.
Ne regardez jamais la lune.
Pour l’avoir fait, j’en sais plus d’une
Qui ne peut plus dormir les nuits.
Lorsque la lune à leurs yeux brille,
Vieil astrologue et jeune fille
Se laissent choir au fond des puits.
C’est entre vous, filles coquettes,
A qui fera plus de conquêtes ;
Mais prenez garde à votre cœur :
On est au fait de ce manège,
Et bien souvent dans votre piège
Il ne se prend que le chasseur.
Des freluquets ont, soyez sûre,
Toujours un masque à la figure :
Le masque est beau, l’homme est hideux.
Défiez-vous de l’apparence :
Dans les jours gras, la différence,
C’est qu’au lieu d’un…
La fin manque. De la musique écrite par Berlioz, il ne reste que peu de chose : le conducteur en donne seulement le chant, avec une partie d’instrument peu importante notée en clé de sol, et pas de basse ; c’est un Andante con moto à trois temps, où la mélodie, privée de son harmonie, n’apparaît pas assez nettement pour que nous en puissions juger la valeur. Mais il nous semble que les vers valaient la peine d’être sauvés : ce conseil d’un père à sa fille : « Ne regardez jamais la lune », méritait notamment d’être apprécié à sa juste valeur par la postérité !
A la suite de la première scène et de la sortie de Balducci vient, dans la partition définitive, la sérénade chantée en solo et chœur par Cellini et les masques, — puis on passe aussitôt à l’air de Teresa. L’analyse du livret nous avait montré qu’ici Balducci revenait encore, et, la sérénade se prolongeant, il y avait là un ensemble des voix dans la coulisse et de Balducci et Teresa sur la scène. La matériel de l’Opéra nous en donne la musique complète, mais les parties nous apprennent que cet épisode, définitivement supprimé, fut coupé déjà aux représentations de l’Opéra. Rien ne nous permet d’affirmer si cette coupure a été pratiquée avant ou après la première représentation.
Encore une coupure considérable dans l’air de Teresa. Cet air, dans la forme traditionnelle du récitatif suivi d’un andante puis d’un allegro, était, à ce que nous apprend le matériel de l’Opéra, prolongé de plus du double, par un Allegro assai à six-huit, puis un trois-huit animé et encore un Larghetto sostenuto, enfin reprise du mouvement animé. Et ces premiers exemples suffisent à nous montrer quelle étendue vraiment exagérée les auteurs avaient voulu donner à leur œuvre, et combien, du fait des retranchements nécessaires, il y eut de travail perdu pour eux.
Nous trouvons peu d’observations à faire sur le joli trio, très développé, commençant par le mélodieux thème qu’expose le cor anglais dans l’ouverture du Carnaval romain : « O Teresa, vous que j’aime plus que ma vie. » Il semble n’avoir pas subi l’outrage des coupures. Notons simplement que Berlioz a, dans son manuscrit, effacé les premiers mots : « O Teresa », pour les remplacer par « O mon bonheur ». Cette correction ne se trouve dans aucun autre document. N’aurait-elle pas été faite sur le tard de sa vie, à l’époque où la réputation d’une chanteuse qui n’a jamais, que nous sachions, été l’interprète de Berlioz aurait rendu dangereux ce nom dans un chant sérieux, — de même que dans les Troyens, le casque d’Énée faisait rire le public de cette époque artiste qui, voyant en armes le héros virgilien, s’écriait : « Ohé ! Mangin ! ».
Le manuscrit, écrit à grands traits, fiévreusement, avec des barres de mesure irrégulièrement tracées à la main, est mêlé d’un certain nombre de pages de la main du copiste. On y trouve fréquemment aussi des fragments des traductions allemande ou italienne écrites au-dessous des paroles françaises.
Au commencement de l’Allegro fugato qui termine le premier tableau, nous lisons dans l’autographe de curieuses observations ; par exemple : « Il faut pour les violoncelles des sourdines à petits grelots ». La même indication, écrite d’abord sur toutes les parties du quatuor, a été effacée aux violons et altos. Puis encore : « Un timbalier frappant et roulant avec ses baguettes sur un tambour de basque. Il faut placer le tambour de basque la peau en haut sur une des timbales. » Quelle amusante recherche de sonorités comiques ! Ce final, noté tout au long dans la grande partition copiée de l’Opéra, a disparu complètement des parties d’orchestre qui nous ont passé sous les yeux : il a certainement été coupé, peut-être dès avant la première représentation. Berlioz n’a pas admis comme définitive cette coupure, que rien, si ce n’est un goût par trop timoré, ne justifie.
La deuxième partie du premier acte, devenue définitivement deuxième acte, est elle-même, suivant les documents, tantôt divisée en deux tableaux, tantôt exécutée dans le même décor. Le premier cas est affirmé par l’autographe et par la partition allemande, chacun pour moitié ; car, chose singulière, tandis que l’autographe, après une indication formelle donnée à la première page, oublie de mentionner le changement de tableau, la partition, gravée sous les yeux de Berlioz, fait mention de ce changement en son lieu, mais avait omis de dire où se passaient les scènes précédentes. Voici le libellé complet des deux indications scéniques :
Commencement de l’acte : « Le théâtre représente la cour d’une taverne près la place Colonne, avec tables, etc. »
Final, le Carnaval : « La décoration change, et représente la place Colonne, avec la colonne Antonine au milieu et un théâtre de Burattini sur la gauche. Foule de masques se poursuivant, se jetant des confetti. La rue du Corso dans le fond. On y voit passer des chevaux, des voitures. Bourgeois de Rome, femmes et enfants aux fenêtres et balcons. »
D’après le livret, l’acte entier devait se passer dans ce dernier décor, et il est évident qu’il en a été fait ainsi à l’Opéra. Il n’en est pas moins évident que les premières scènes sont beaucoup mieux à leur place dans la cour d’une taverne qu’en pleine place publique au milieu de la cohue du Carnaval, et il n’est pas douteux que telle ait été l’intention de tous les auteurs.
___________________________________
(1) Cette rature ne recouvrirait-elle pas les mots « Et tombée » ? On peut le supposer si l’on rapproche la lettre par laquelle Berlioz donne des
nouvelles à Liszt de la représentation de Londres : « Ainsi il faut
ajouter maintenant sur le titre de la partition : « Tombée pour
la seconde fois le 25 juin, etc. » Lettre du 10 juillet 1853 [CG
no. 1617].![]()
(2) Une affiche de la première représentation, portant la date du 10 septembre 1838, a été reproduite en fac-similé dans AD. JULLIEN, Hector Berlioz, p. 111.![]()
![]()
![]() Le Ménestrel, 9 Avril 1905, p. 115-116
Le Ménestrel, 9 Avril 1905, p. 115-116
(Suite)
D’après le livret, cet acte s’ouvre directement par la scène d’ensemble des ciseleurs. Mais tous les documents musicaux, l’autographe comme le matériel de l’Opéra et les partitions gravées, y compris les morceaux détachés de 1839, placent ici un « air chanté par M. Duprez ». C’est l’air d’opéra dans toute son horreur. Le ténor, s’avançant sur la scène vide, venait, la main sur le cœur, débiter son récitatif, puis l’andante obligé (bien heureux si, comme c’est le cas ici, cet andante n’était pas suivi d’un allegro), et se retirait en souriant et faisait des révérences pour répondre aux bravos du public idolâtre. Après quoi la pièce pouvait commencer. Il est à croire que le public ne se montra pas suffisamment idolâtre, — et l’on sait comment Duprez s’en vengea sur l’œuvre et sur Berlioz, — car le morceau fut retranché. Du moins peut-on lire sur la copie de l’Opéra les mots : « A couper », tracés au crayon sur la première page.
Si respectueux que nous soyons par principe des chefs-d’œuvre des maîtres, il nous semble, si par hasard l’éventualité de la remise à la scène de Benvenuto Cellini se réalisait quelque jour, que l’on pourrait s’autoriser sans scrupule de ce précédent pour supprimer l’air : « La gloire était ma seule idole. » Je crois fermement que l’ombre de Berlioz n’en serait pas indignée.
Le matériel de l’Opéra (conducteur) nous montre aussi, à cette même place, les vestiges d’un morceau dont il est resté moins encore : c’est un récitatif, amorcé sur le commencement d’un air qui a disparu, destiné au personnage d’Ascanio. Celui-ci disait :
Le Cardinal est furieux ;
Il vient de nous parler en maître.
Mais Cellini ne peut au travail se remettre,
Car il est sans argent, et surtout amoureux.
Ces quelques vers d’exposition eussent été plus utiles à la clarté de l’action subséquente que les réflexions du ténor sur la gloire et l’amour. Ils n’étaient pas non plus indispensables. Au reste, il n’apparait pas que le morceau, probablement demandé par Mme Stoltz, ait été même achevé.
C’est donc le chœur des ciseleurs qui doit former l’introduction naturelle de l’acte. Cellini et ses amis sont attablés dans la trattoria, disant leur hymne à la gloire de l’art. Ils célèbrent la beauté des métaux,
Ces fleurs souterraines
Aux impérissables couleurs ;
Puis, à voix sonores, ils proclament la noblesse de leur art :
Quand naquit la lumière,
Le génie aux beaux-arts
Divisa la matière :
Il en fit quatre parts.
L’architecte eut la pierre ;
Au peintre la couleur,
Le marbre au statuaire,
Mais l’or au ciseleur !
Malgré la mauvaise réputation faite dès le premier jour au poème de Benvenuto Cellini, j’oserai dire que j’aime au moins autant — et même mieux— des vers de cette frappe que ceux dont Scribe inondait les portiques de nos théâtres de musique. Il est vrai que Benvenuto Cellini, présenté d’abord à l’Opéra-Comique, y fut, nous le savons déjà, refusé à cause des paroles… Et précisément la musique du chœur des ciseleurs était déjà composée à l’époque de cette présentation (août 1834) : ce morceau formait alors la première scène de l’ouvrage. Nous ne saurions dire s’il était déjà exactement semblable à celui qui fut exécuté à l’Opéra. Celui-ci, il faut le dire, est d’une sonorité orchestrale et vocale que ne rappelle que d’un peu loin celle des Diamants de la Couronne et du Chalet… Prenons du moins note, en passant, de l’antériorité de ce morceau par rapport au reste de la partition. L’autographe, avec des traces d’usage très apparentes, et quelques ratures, est dans un bel état ; la fermeté de l’écriture montre que cette page fut composée dans le calme et dans la joie.
Après le chœur des ciseleurs vient, dans tous les documents, la scène comique des artistes et du cabaretier. Dans la partition gravée, le type de ce personnage est caractérisé par ces mots : « Espèce de vieux juif à la voix nasillarde. » Dans l’autographe, Berlioz allait plus loin dans le réalisme : il en faisait une « espèce de crétin louche et la tête penchée sur une épaule ». Il est évident qu’il y avait là, comme dans tout l’ensemble de la scène, quelque ressouvenir de son séjour en Italie. Le matériel de l’Opéra nous apprend que cette scène fut sacrifiée au dieu des coupures. Ce dieu est parfois une idole bien malfaisante.
Les divers documents ne nous apprennent rien de particulier sur les morceaux qui terminent cette première partie de l’acte. Disons simplement qu’ici la partition autographe renferme plusieurs pages notées, par une main étrangère, par exemple l’air de Fieramosca : « Ah ! qui pourrait me résister ? » Six pages détachées de ce morceau, écrites de la main de Berlioz, mais criblées de ratures, sont d’autre part conservées dans un carton de la Bibliothèque du Conservatoire.
Le grand finale, cette conception étonnante, d’une admirable architecture, d’une couleur éclatante et splendide, d’une vie exubérante, une des productions les plus merveilleuses de Berlioz — d’ailleurs entièrement inconnue du public français — n’a presque subi aucune modification et ne nous procurera l’occasion que d’un petit nombre d’observations de détail. L’une des plus importantes nous est fournie par le début même, vingt mesures d’introduction orchestrale qui, mêlant comme dans un bruit de foule plusieurs thèmes aux rythmes entraînants et aux sonorités brillantes, mettent dès l’abord l’auditeur dans l’atmosphère qui convient. Cette introduction n’existait pas dans la première forme de l’œuvre ; Berlioz l’a écrite sur des feuillets d’un format différent de ceux de sa partition d’orchestre, au milieu desquels il les a intercalés.
Le saltarello, que Berlioz a transcrit purement et simplement pour en former la partie principale de l’ouverture du Carnaval romain, va donner lieu à une remarque curieuse. Les Mémoires racontent qu’Habeneck ne put jamais arriver à donner à ce morceau l’animation que voulait Berlioz, et que celui-ci ne put l’obtenir que lorsqu’il dirigea lui-même l’ouverture. La comparaison des versions successives de ce fragment, va nous apprendre qu’Habeneck était excusable en quelque mesure. Comment, en effet, les partitions gravées de l’opéra et celle du morceau symphonique écrivent-elles ce saltarello ? En mesure à six-huit. Or, le matériel de l’Opéra vient nous apprendre qu’à l’origine tout l’épisode était noté à trois-huit, avec l’indication de mouvement : Presto scherzando. Il n’est pas très surprenant que le chef d’orchestre, trompé par cette indication, ait donné au saltarello le mouvement d’un scherzo beethovénien. Il est en effet très difficile d’animer un morceau battu à un temps, tandis que la difficulté disparait si les temps sont réunis par deux. L’expérience ne fut pas perdue pour Berlioz, et l’inconvénient signalé au début n’existe plus aujourd’hui. La partition autographe donne le passage à six-huit, mais, — et c’est l’effet du remaniement, — cette partie, presque seule dans le finale, est de la main du copiste.
Dans la pantomime, un nom a donné lieu à des hésitations multiples : celui du personnage appelé en dernier lieu Pasquarello. Le livret le nomme Polichinelle ; dans l’autographe, nous lisons, sous des ratures successives, Pierrot et Pulcinella.
Les vandales qui présidaient aux destinées de l’Opéra en 1838 ont coupé cette scène ravissante d’ironie, d’esprit musical et de pure musique. Il est vrai que Berlioz y avait fait la satire de la musique italienne, ne craignant pas de faire chanter en chœur des Felicità, felicità, pour parodier les cadences finales des airs de Rossini. Cela pouvait-il être toléré sur le théâtre dont le banquier de Rossini était un des plus puissants soutiens ?
Toute cette partie de l’autographe est dans un magnifique état d’exécution. Dans la strette finale, les trente-deux portées de chaque page sont remplies, plusieurs donnant la notation de deux parties à la fois, et tout est écrit avec une sûreté de main admirable.
C’est au dernier acte (appelé second à l’origine, troisième à la fin) que nous allons voir multiplier les remaniements.
Le prélude cependant n’a pas changé. Nous le trouvons dans l’autographe, sur un papier usé et rapiécé, noté, de la main de Berlioz, tel qu’il est dans les parties de l’Opéra aussi bien que dans les partitions gravées ; on y voit seulement modifié le ton primitivement choisi pour les cornets à pistons, et cela seul a donné lieu à des ratures et corrections très apparentes.
Mais à l’origine, ce morceau d’orchestre (qui n’est autre que le chant des Ciseleurs assombri, par le passage du ton majeur au mineur) s’enchaînait avec la scène qui est aujourd’hui la 5me de l’acte : par suite du remaniement dont nous avons, dans la correspondance de Berlioz avec Liszt, suivi pas à pas les vicissitudes, et qui eut pour résultat de supprimer la seconde partie de l’acte (sauf le finale contenant le dénouement), l’auteur a intercalé ici deux morceaux qu’il voulait sauver du naufrage, et ajouté quelques parties nouvelles.
Précisément le chœur des ouvriers qui s’enchaîne aujourd’hui au prélude orchestral est le morceau le plus récent que Berlioz ait composé pour son opéra ; c’est celui que désignent ces mots de sa lettre à Liszt de la fin de janvier 1853 : « Le troisième acte commence autrement et sans augmenter la durée de plus de deux minutes. » Il était utile, en effet, que le public vît paraître les ouvriers qui vont jouer un si grand rôle au cours de cet acte. La musique que leur fait chanter Berlioz, si bref qu’en soit le développement, est d’un beau caractère expressif. Ce morceau, dans la partition autographe, est de la main du copiste, ainsi que la scène d’entrée de Teresa et Ascanio, également nouvelle. L’écriture de Berlioz reparaît au chœur des ouvriers chantant de l’intérieur de la fonderie : mélodie populaire des montagnes italiennes dont le compositeur a cherché à reproduire l’impression sur la scène de l’Opéra, soutenant le chant monotone par un simple accompagnement de guitares auxquelles se mêle le bruit des enclumes.
Puis vient, toujours de la main du maître, l’air d’Ascanio, encore pris à la seconde partie de l’acte primitif. Il a subi des remaniements notables, mais dans les paroles seulement. Primitivement, il avait pour sujet le récit des scènes qui se déroulent dans le sextuor : replacé avant ce morceau, il retrace nécessairement d’autres souvenirs ; il raconte maintenant les incidents de la nuit du carnaval. Berlioz a fait lui-même le changement des paroles ; pour la musique, il s’est borné à modifier une nuance et à transformer un arco en pizzicato, ainsi qu’on le lui a vu expliquer dans sa lettre à Liszt du 3 ou 4 juillet 1852 [CG no. 1501]. Sous sa première forme, l’air se trouve dans les partitions et parties de l’Opéra, ainsi que dans le morceau séparé pour piano et chant ; les deux livrets sont également conformes à cette première version. Les partitions gravées (piano et orchestre) donnent la seconde forme. Quant à l’autographe, il montre très clairement les anciennes paroles raturées et remplacées par les nouvelles. Quelques mesures, de la main du copiste, sont rapportées.
![]()
![]() Le Ménestrel, 4 Juin 1905, p. 180-181
Le Ménestrel, 4 Juin 1905, p. 180-181
(Suite)
Les scènes qui viennent maintenant sont celles qui, dans la première section, commençaient l’acte : les litanies psalmodiées dans la rue et la prière de Teresa et Ascanio, le récit de Cellini et le duo d’amour. Le début n’a pas été notablement remanié. Pour le récit, l’autographe nous y montre de nombreuses et importantes ratures.
Le mouvement général, certains détails même de ce récit romanesque d’une nuit de fête à Rome évoquent d’une façon singulière le souvenir d’un autre récit musical, celui du voyage à Rome de Tannhäuser. Certes, les situations comme les personnages sont très différents : dans l’œuvre de Wagner, la fête dont il s’agit est celle où le Pape absout les péchés des pèlerins venus pieusement de tous les points de la chrétienté, tandis qu’ici il n’est question que des réunions toutes profanes du Carnaval, mais à Rome aussi ; quant aux personnages, ils sont agités de sentiments tout autres. Voyez pourtant les analogies : Tannhäuser, après avoir fait la narration passionnée de son aventure, s’exprime ainsi :
A ces mots, je tombai sur le sol, privé de pensée et de sentiment…
Lorsque je me réveillai, la nuit couvrait la place déserte, de loin arrivaient jusqu’à moi des chants joyeux de grâce…
Cellini, habillé en moine, comme Tannhäuser l’est en pèlerin, dit de son côté :
Tout haletant de fatigue et d’émoi,
Le cœur me manque, et le sol fuit sous moi…
Quand je repris l’usage de mes sens
Les toits luisaient aux blancheurs de l’aurore,
Les coqs chantaient, etc.
Mais le plus étonnant est que la conformité du mouvement narratif se soit étendue jusqu’aux détails de la musique. C’est, de part et d’autre, le même arrêt de la période musicale, qui, précédemment sonore et véhémente, va s’éteignant sur la déclamation haletante, coupée d’accords brefs, saccadés, modulant très loin du ton principal ; puis, après un long arrêt, comme les personnages racontent de quelle façon toute pareille ils sont revenus de l’évanouissement, l’orchestre rentre dans le ton en faisant entendre un dessin aigu dont, chose surprenante, le contour et la sonorité sont presque semblables. Dans Tannhäuser, la flûte rompt ainsi le silence :
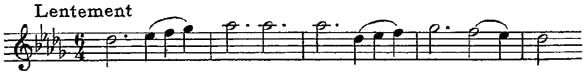
Et dans Benvenuto Cellini, c’est la flûte encore qui, se détachant sur le tremolo mystérieux des violons, commence de la manière suivante :
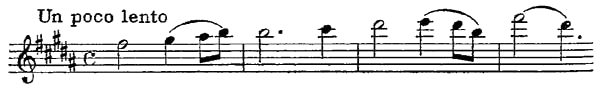
Loin d’avoir la vaine pensée d’insinuer que l’œuvre seconde aurait profité de l’exemple de la précédente (ce serait Tannhäuser), je ne puis que répéter ici l’affirmation, précédemment exprimée, que Wagner, en 1852, ne connaissait pas Benvenuto Cellini : il n’a donc pu prendre l’opéra de Berlioz pour modèle d’une œuvre qui date de 1843. Mais, cette certitude étant acquise, il n’en est que plus intéressant de signaler ce point de contact de l’esprit des deux musiciens de l’avenir, trouvant spontanément, pour une situation semblable, une expression poétique et musicale presque identique. Ce l’est d’autant plus, nous semble-t-il, que cette conformité ne se retrouva pas trop souvent entre eux.
Avec le duo qui suit, entre Cellini et Teresa, nous arrivons à ce que nous pourrions appeler la région des grandes coupures, celle qui va nous faire connaître le plus de Berlioz inédit.
Pourtant, quoique les partitions gravées n’aient conservé qu’un fragment du duo original, nous ne pouvons dire que ce morceau soit resté inédit dans son ensemble, car il a paru d’abord intégralement en morceau séparé pour piano et chant. Mais l’orchestration complète n’en est conservée que par le matériel des copies de l’Opéra. Quant à l’autographe, les pages supprimées en ont disparu ; mais il est resté une preuve de leur existence antérieure, par la présence de quatre dernières mesures qui se lisent encore, sous les ratures, à la page où commence la partie conservée.
Ce duo avait été conçu à l’origine dans la forme développée des duos italiens, comme celui d’Arnold et Mathilde : « Oui, vous l’arrachez à mon âme », au second acte de Guillaume Tell. Tel que les paroles en avaient tracé le plan, il devait comporter une première phrase de chant exposée par un personnage, et répétée symétriquement, ou mieux encore semblablement, par l’autre ; puis un milieu ; enfin une strette à deux voix. Le génie rebelle de Berlioz devait lui faire accepter malaisément la contrainte de cette forme convenue. Il s’y soumit pourtant, mais, ainsi que l’on pouvait s’y attendre, il ne réussit guère. Cette obligation de passer par le chemin des autres semble avoir arrêté son initiative, glacé son génie. La situation, les paroles mêmes appelaient un chant animé, plein d’éclat, d’ardeur passionnée : il mit à la place un mineur sans mouvement, à l’expression concentrée, formant un véritable contresens. L’épisode intermédiaire dans lequel Teresa arme Benvenuto est, plus heureux, car Berlioz a donné l’intérêt principal à l’orchestre, où il est maître ; quant à l’ensemble final, il a enfin le caractère qui convenait à la scène. Berlioz fit sagement en détachant seulement cette dernière partie pour la conserver, et en supprimant tout le reste.
Considérée au point de vue purement musical et indépendamment de ses incompatibilités scéniques, la première partie de ce duo n’est pourtant pas sans valeur. On y entend certains accents qui, plus tard, se retrouveront en leur plein épanouissement dans l’Enfance du Christ et les Troyens, et cela, certes, est on ne peut plus louable. Mais autre chose est l’adieu de Chorèbe à Cassandre ou le récit du voyage de la Sainte Famille, autre chose le duo de deux héros d’opéra obligés par la situation à feindre qu’ils sont pressés de fuir, et perdant leur temps sur la scène à chanter un duo à l’italienne, dont la musique n’a même pas l’expression qui convient ! Ce n’est pas faire une critique à Berlioz que de constater ce vice de sa conception première, puisqu’il a été le premier à l’apercevoir et le corriger.
Le sextuor qui suit ce duo devait être encore une de ces grandes constructions à l’italienne dont le grand finale du Barbier de Séville (un sextuor aussi, avec chœur dans la dernière partie) nous offre le type le plus connu. L’histoire des batailles musicales nous apprend que cette sorte de formation (si l’on peut employer ici ce terme stratégique) n’était pas sans danger ; c’est ainsi qu’à la première représentation de ce même Barbiere à Rome, ce finale fut le passage qui détermina la déroute : à l’audition d’un épisode grave et solennel survenant au milieu de l’ensemble presque uniformément animé, une voix gouailleuse s’écria du parterre : « Voici les funérailles de don Pollion », trait d’esprit dont personne n’a jamais compris le sens, mais qui suffit à déchaîner le tumulte de lazzi et de sifflets sous lequel le chef-d’œuvre de Rossini sombra le premier soir.
Il en fut de même pour Benvenuto Cellini, dont, pendant de longues années, le sextuor fut pour Berlioz une cause de préoccupation. Déjà il écrivait au lendemain des représentations de Paris : « On a chuté le sextuor, qui est réellement trop long, et que je vais raccourcir autant que me le permettront les paroles. » Nous l’avons vu plus tard, à Weimar, s’efforcer de retrancher, ici quelques vers, là tel ou tel épisode superflu. Enfin il prit un grand parti : renonçant à conserver au morceau sa forme régulière, il élimina tous les développements purement musicaux, jugés, avec grande raison, parasites, et de cet ensemble d’opéra fit une scène d’action, assurément beaucoup plus vivante ainsi et plus digne de figurer dans une œuvre d’art sérieuse.
Il réduisit par là les dimensions de plus de moitié. Une simple constatation permettra de se rendre compte des proportions comparées du morceau original et de celui de la partition définitive : le livret, conforme à la première version, compte, pour cette scène, deux cent trente-six vers ; il n’en a, en dernier lieu, subsisté guère plus d’une centaine.
Le souci de la déclamation expressive avait été, dès le début du morceau, une première cause de lenteur, sinon de longueur. Ce début était manifestement destiné à être traité dans la forme italienne, l’orchestre développant, en le répétant en différents tons, un petit motif léger, tandis que, par là-dessus, les voix eussent débité (j’allais dire : déblayé) les paroles sur un ton syllabique comportant le plus grand nombre possible de notes par mesure. C’est ainsi qu’aurait procédé tout compositeur italianisant, et ils l’étaient tous en ce temps-là. Seul, Berlioz refusait de se renfermer dans ces formules arbitraires : il voulait donner à sa musique tout le développement expressif que commandaient les paroles. Aussi, après les premières répliques échangées avec volubilité, fait-il chanter sur des blanches et des noires l’imploration des deux amants, et le développement subséquent auquel cet épisode donnait lieu :
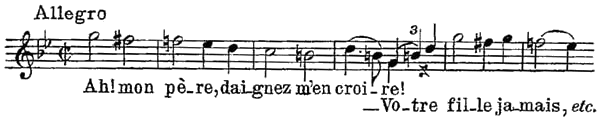
Ce n’est plus là du style italien, mais de la musique française de la bonne époque : sans monter jusqu’à Gluck, on peut évoquer ici le souvenir de Grétry et de tel passage pathétique de son œuvre si intelligemment expressive. Mais, bien que le mouvement fût animé, des passages de ce genre allongeaient une scène qui, au fond, ne comportait rien qui dût être pris au tragique : Berlioz commença donc là son travail d’émondage ; l’épisode qui débute par la précédente citation musicale, — douze vers du poème, cinquante-trois mesures de la musique — a disparu des partitions gravées. On en retrouve le texte complet dans les livrets, la musique dans les copies de l’Opéra. Quant à l’autographe, Berlioz s’est contenté d’y biffer à grands traits ce qu’il voulait supprimer, mais on y peut lire facilement sous les ratures le développement original. — Notons un menu détail. L’autographe a conservé ici un feuillet appartenant à un développement postérieur, également coupé : il est intercalé entre les pages 95 et 96.
Ce premier épisode du morceau d’ensemble ne comporte que cinq voix. Le sextuor va être complété par l’entrée d’un nouveau personnage qui, à lui seul, et dès avant la première représentation, fut cause de remaniements à n’en plus finir.
Mais d’abord, quel est ce personnage ? Les partitions, même les documents imprimés contemporains des représentations de l’Opéra, l’appellent : le Cardinal. Cependant les documents manuscrits qui avaient été préparés pour l’exécution première, c’est-à-dire les partitions et parties de l’Opéra, sont unanimes à le désigner par cet autre mot, souvent raturé, mais toujours, lisible : le Pape.
![]()
![]() Le Ménestrel, 25 Juin 1905, p. 205-206
Le Ménestrel, 25 Juin 1905, p. 205-206
(Suite)
Les auteurs avaient en effet résolu de donner au pape un rôle dans leur pièce. Pourquoi non ? Victor Hugo n’avait-il pas fait prononcer à la Comédie-Française ce vers :
Ces deux moitiés de Dieu, le pape et l’empereur !
Et n’avait-on pas vu naguère sur les planches de l’Opéra l’une de ces deux moitiés, l’empereur Sigismond, représenté par un figurant juché sur un cheval, dans le défilé de la Juive ?
L’autre moitié de Dieu ne fut pas admise à jouir des mêmes prérogatives. Nous avons eu déjà l’occasion de signaler que la censure avait, plusieurs semaines avant la représentation, exigé que le pape fût changé en un simple cardinal. Auguste Barbier le dit dans une note placée à la fin de son édition du poème :
Afin de se rapprocher de la vérité historique, les auteurs avaient mis en scène le pontife sous le règne duquel l’action de cette pièce se passe. Ils n’avaient considéré en lui que le prince temporel ; mais la censure leur demanda de vouloir bien substituer un cardinal à la figure du chef de l’église. Les auteurs se soumirent à cette demande. Il est bon, cependant, d’ajouter que l’indulgence de Clément VII à l’égard du fameux ciseleur n’est pas un fait de leur invention, mais un acte très réel. Ce pape, grand amateur des arts, eut plusieurs fois l’occasion de punir les frasques coupables de Cellini ; néanmoins, il les lui pardonna dans le désir de ne point priver l’Italie des travaux d’un si habile homme.
Pourtant, un simple changement de titre n’eût pas suffi à motiver tant de remaniements. Le nom du pape n’était que rarement prononcé dans la scène : au début, l’exclamation générale : « Le Pape ici ! » a été facilement remplacée par : « Le Cardinal ! », sans qu’il y eût à modifier une seule note à la musique ; il en fut de même plus loin, où le vocatif : « Très Saint Père » a fait place non moins naturellement à « Monseigneur » ou « Excellence ».
Tout cela n’est rien.
Mais il y eut de bien plus graves modifications, qui portèrent sur le caractère du personnage.
Parmi l’important matériel de l’Opéra se trouve la copie du rôle. On y lit sur la première page, d’abord ce nom effacé : « Le Pape », puis, pour le remplacer : « Le Cardinal, M. Alizard (1) » ; enfin cette annotation : « Rôle à revoir pour les paroles et la musique ».
La principale cause de cette révision des paroles, laquelle entraîna à son tour nombre de modifications à la musique, c’est que, dans tout le poème de Benvenuto Cellini, il n’était pas une scène qui, à l’égal de celle où figure le souverain pontife, méritât ce reproche avoué par Berlioz lui-même : « On avait laissé échapper des mots qui appartiennent évidemment au vocabulaire des injures. » Mettons qu’ « injure » soit excessif : du moins ce pape s’exprimait avec un franc parler et un ton de familiarité qui durent grandement surprendre le public de l’Opéra, habitué à plus de solennité chez les princes de l’Église appelés à figurer devant lui. C’est ainsi qu’au début, après l’entrée très solennelle et très noble, admirable au point de vue musical, alors que le chant de miséricorde sert encore de thème à la symphonie, le Pape, interpellant Cellini, lui disait :
Tu feras donc toujours le diable,
Incorrigible garnement !
Berlioz, qui a fait lui-même les remaniements des paroles, a remplacé ces deux vers par ces autres, dont il m’est impossible de reconnaître la supériorité au point de vue littéraire, mais qui ont l’avantage d’être plus neutres :
Ce double crime, homme intraitable,
Mérite un double châtiment.
La trace de la correction est très visible sur le manuscrit autographe. Plus loin, le Pape disait encore :
A quoi donc t’a servi mon or ?
A flétrir le cœur d’un vieux père,
Percer les gens de ta rapière,
Et puis passer la nuit entière
Au cabaret, à boire frais ?
Cette admonestation familière du chef de la chrétienté a été coupée. S’adressant toujours à Cellini, il l’appelait : « Noire cervelle ! ». Cette qualification a été supprimée purement et simplement. Enfin, quand, après le magnifique mouvement scénique où l’artiste menace de briser son chef-d’œuvre, le Pape lui accorde son pardon, il disait en aparté :
Le démon me tient en laisse ;
Il sait pour l’art tout mon amour.
L’insolent rit tout bas de ma faiblesse ;
Mais avant peu j’aurai mon tour.
Mieux encore que ces paroles, la musique qu’on chantait à cette place lors des premières représentations de Benvenuto Cellini accuse le caractère paradoxal que les auteurs avaient prétendu donner à leur personnage. C’était un morceau d’ensemble, où, pour commencer, les voix déclamaient sur le motif suivant exposé par un basson :

Le hautbois, puis la clarinette, enfin la flûte répondaient :

Enfin la voix du Pape se faisait entendre, et une note de la partition spécifiait : « Ici toutes les parties de chant doivent être exécutées à demi-voix, celle du Pape seulement doit l’être plus fortement afin de se dessiner dans la masse. » Et, ce que le Pape chantait, c’était le thème même exposé plus haut par le basson :

Nous comprenons très bien l’intention ironique et fine de tout ceci : les auteurs avaient voulu montrer un de ces papes artistes, comme la Renaissance en a vu plusieurs, détaché des vaines grandeurs du sacerdoce et venant s’en délasser volontiers en la compagnie des peintres et des ciseleurs. Mais l’idée était trop subtile pour convenir à la scène, surtout à celle de l’Opéra, avec ses pompes et ses machines : le pape artiste avait chance d’y paraître un pape d’opérette. Berlioz ne s’y est pas mépris (encore qu’il s’en soit aperçu un peu tard) ; nous l’avons vu, dans sa lettre à Liszt du 30 novembre 1852, déclarer qu’il supprime « le petit mesquin Allegro fugué en mi majeur qui interrompt le sextuor : Cela, ajoutait-il, est du plus petit style d’opéra-comique ».
Les copies de l’Opéra nous donnent tout au long ce développement qui, l’auteur le reconnut spontanément, avait bien d’autres défauts que l’excès de son étendue. Les parties séparées portent les traces de coupures hâtives, qui ne suffirent pas pour alléger l’œuvre de façon qu’elle pût se soutenir ; quant à la copie en cinq volumes, restée intacte, elle nous a conservé le sextuor tel que Berlioz l’écrivit dans son premier jet. L’autographe est, dans cette partie, surchargé de ratures, d’ailleurs remarquable de sûreté de main là où la forme originale n’a pas été modifiée, comme dans la déclamation énergique et superbe de Cellini :
Mais nul artiste autre que moi,
Fût-il Michel-Ange, ma foi !
Ne mettra ma statue en fonte.
Le sextuor s’achevait par une longue strette animée, à six-huit, au cours de laquelle, conformément à la pratique du temps, un chœur était fort arbitrairement introduit : c’est toujours la forme du finale du Barbier, où la garde envahit la maison de Bartholo, sous prétexte de tapage nocturne, mais, en réalité, pour la seule raison de mêler des voix de ténors et de basses au soprano de Rosine et de Marceline ; et de même, dans Benvenuto, le « chœur de la suite du Pape » entonnait quand le tour du chœur était venu. On lit sur sa partie, dans la copie de l’Opéra, des indications scéniques comme celles-ci : « Le chœur qui’ était resté au fond de la scène se rapproche du Pape comme pour le protéger. » Plus loin : « Ici le Pape fait un geste pour empêcher ses gens d’avancer davantage, en indiquant qu’il n’y a rien à craindre pour sa sûreté. » Le thème musicàl sur lequel se développe cette strette est celui-ci :
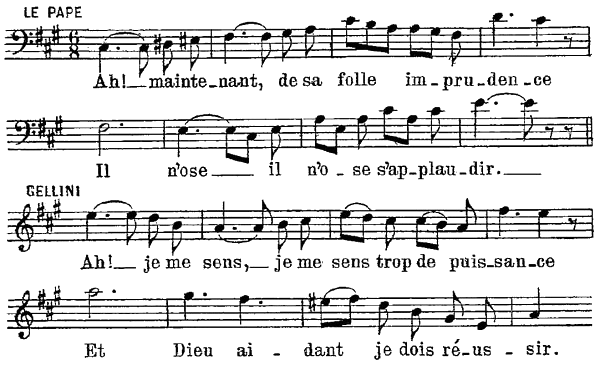
Ce dessin n’a pas été complètement retranché de la partition définitive : on l’y peut lire dans la partie instrumentale du court ensemble qui suit le geste de Cellini menaçant de briser la statue : « Ah ! qu’a-t-il fait et qu’a-t-il dit ? Oser braver le prince en face ! » Présenté dans un mouvement moins animé et soutenu d’une façon tout autre que par la banale batterie qui l’accompagnait à la fin, il a ici une tout autre physionomie et un caractère plus expressif.
Il est bien entendu que nous n’avons reproduit ces notes et notations qu’à simple titre documentaire, cette incursion de Berlioz dans le domaine de… l’opéra italien n’ayant pas eu de résultats assez heureux pour que nous ayons espéré trouver des chefs-d’œuvre en des pages qu’il a été empressé de retirer lui-même de son œuvre.
Le sextuor s’achève donc aujourd’hui, sans ensemble final, sur un récitatif obligé du Cardinal, dont Berlioz dit avoir lui-même « bâclé les drôles de vers », et dont la composition fut faite exactement dans les premiers jours de juillet 1852 (voir ses deux lettres à Liszt à cette date) [CG nos. 1499 et 1501]. Il est suivi du monologue de Cellini : « Seul pour lutter ! » auquel succède immédiatement la scène finale de la fonte.
En 1838, le sextuor, développé comme nous l’avons vu, terminait au contraire la première partie du second acte, laquelle formait à proprement parler un acte entier. Le rideau se baissait et se relevait sur un nouveau décor : c’était comme un dernier acte qui commençait. Nous avons suivi dans les lettres de Berlioz à Liszt le détail des remaniements auxquels donna lieu la suppression de ce second tableau, et les copies de l’Opéra nous ont permis de retrouver à leur place primitive les trois morceaux, que Berlioz y a repris pour les transporter au tableau précédent : l’air d’Ascanio, avec ses anciennes paroles, le chœur des fondeurs : « Bienheureux les matelots », et l’air avec récitatif de Cellini.
___________________________________
(1) C’est Serda, et non Alizard, qui a créé le rôle du Cardinal.![]()
![]()
![]() Le Ménestrel, 2 Juillet 1905, p. 211-212
Le Ménestrel, 2 Juillet 1905, p. 211-212
(Suite)
Mais on découvrira d’autres choses encore dans ces copies. C’est d’abord un prélude, vingt-trois mesures à six-huit, en mouvement Andante, qui a disparu de la partition définitive ; puis un chœur d’ouvriers, différent de celui qui ouvre actuellement le dernier acte : Berlioz en a pris simplement quelques vers, auxquels il en a ajouté d’autres de sa façon, et a fait une musique toute nouvelle.
Mais déjà la place qu’occupe ce chœur dans le cinquième volume de la copie de l’opéra nous révèle un premier désaccord entre cette copie et le livret de 1838, lequel pourtant devait être conforme à la représentation. Le chœur, dans ce livret, est à la scène XV : il vient en n° 2 dans la copie. Or, nous constatons plus loin qu’aucune des scènes au milieu desquelles il était placé à l’origine n’a laissé de traces dans la copie en grande partition, qui, jusqu’ici, nous avait fait connaître très fidèlement la forme première de l’œuvre de Berlioz.
Est-ce à dire que cette partie de l’opéra n’a pas été mise à la scène, ou peut-être, même, que la musique n’en a pas été composée ? Non, certes : nous avons vu qu’au moment où il en résolut définitivement la suppression, Berlioz déclarait que « cette partie lui avait toujours paru glaciale et insupportable » et que « l’intérêt du dernier acte s’y mourait péniblement ». Pour avoir cette impression, il fallait qu’il eût vu représenter ces scènes.
En outre, — et ceci est plus probant encore, — si, pour une raison que nous n’avons pas su découvrir, la grande partition copiée ne les contient pas, il n’en est pas de même du matériel de l’exécution, conducteur, parties d’orchestre, rôles, etc., où, parmi les macules d’innombrables coupures, elles se déroulent tout au long.
Il sera donc possible, si jamais quelqu’un s’avise de vouloir connaître en son intégralité la forme première de l’opéra, de reconstituer la musique de cette partie, que, si nous nous en tenions au jugement de l’auteur, nous devrions tenir pour négligeable, mais qui du moins est importante par son étendue. Nous laisserons à d’autres le soin de réaliser cette reconstitution, ayant déjà passé (et fait passer à nos lecteurs) beaucoup de temps à ce premier examen comparé des textes divers de Benvenuto Cellini.
Nous voici donc arrivés à la scène finale. Nous y trouvons de nouvelles et dernières preuves du souci de plus en plus pressant qu’eut Berlioz de resserrer l’action.
Les documents de l’Opéra nous montrent d’abord les vestiges d’une scène en récitatifs où le Pape admonestait paternellement Teresa, enfuie de chez son père et qu’on retrouvait pour la seconde fois chez Cellini :
LE PAPE
Relevez-vous, et dites-moi
Qui vous amène ici, ma chère ?
BALDUCCI
En vérité…
LE PAPE
Tenez-vous coi,
Mons Balducci ; veuillez vous taire…
Mon père, usant de stratagème,
A voulu m’éloigner de Rome malgré vous ;
Mais j’ai fui vers celui que j’aime,
Vers celui que le ciel me garde pour époux.
LE PAPE
Ma chère enfant, c’est mal à vous.
Il faut obéir à son père…
(Regardant sévèrement Balducci)
Quand même il manque à son devoir.
Ah ! ça, ne pourrons-nous le voir,
Ce Cellini? etc.
Toujours le Pape bon enfant ! Mais c’était mieux encore à la fin, quand Cellini, au désespoir, se jetait à genoux et demandait l’inspiration à la prière. Rudement, le Pape l’interpellait en ces termes :
Prier ! le moment est mauvais !
Assurez d’abord le succès,
Vous rendrez grâce au ciel après.
Ce pape, assurément, avait lu Voltaire ! Les derniers vers sont dans l’autographe. Rien de l’ensemble de ces citations n’a été imprimé, même dans le livret.
Quant à la scène de la fonte, elle a été raccourcie, au début, d’un premier épisode, peu nécessaire ; en outre, la musique a été modifiée dans la conclusion pour devenir conforme aux nouvelles dispositions du poème, expliquées en leur lieu. Je rappelle que, dans la première version, l’on assistait simplement au jaillissement de la fonte coulant de la chaudière : la représentation musicale de cette opération était figurée par un tremolo aigu aboutissant par un crescendo à une violente explosion. Cet effet descriptif, heureux sans doute, a disparu forcément du dénouement actuel, dont nous avons dit la beauté scénique. La partition autographe nous permet d’en observer les perfectionnements successifs, jusques et y compris le dernier : l’addition de la fière devise du Persée clamée par Benvenuto, dont, par-dessus le dessin d’orchestre antérieurement écrit, nous lisons les mots latins ajoutés au crayon, d’une main fiévreuse, avec une fermeté graphique presque troublante par son allure de défi.
L’importance de cette dernière scène a préoccupé Berlioz au point qu’il en a voulu établir lui-même la mise en scène. Nous en avons trouvé le projet, rédigé de sa main, dans la collection des autographes de la bibliothèque du Conservatoire. La présence de mots italiens nous apprend que cette pièce fut écrite en vue de la représentation de Londres, en 1853, où Tamberlick interpréta le rôle principal. Notre longue étude ne saurait être mieux terminée que par la reproduction de cet intéressant document inédit :
POUR LA MISE EN SCÈNE DU DERNIER FINAL
Au commencement Cellini va et vient, autour d’un fourneau, donnant ses ordres à ses ouvriers. Puis il revient sur l’avant-scène écrire un billet qu’il donne à un messager.
Alors Fieramosca accourt à lui en criant : Del metal !
Cellini après, son mot : O Destin fatal ! retourne au fond du théâtre et fait jeter dans la fournaise une certaine quantité de métal. Il revient aussitôt, et, retrouvant Fieramosca auprès de Balducci, il le renvoie au fourneau d’un geste impérieux avec ces mots : Presto all’ opra ! Puis se retournant vers le cardinal il lui dit : Escusate, etc.
Pendant ce temps on voit revenir le messager à qui Cellini avait donné un billet, portant sur son dos un paquet de bois qu’il va jeter dans le feu (1).
Cellini s’agite auprès de ses ouvriers, puis revient sur l’avant-scène, au moment où Francesco accourant à lui s’écrie : « Mastro ! Mastro ! il bronzo si gela ! »
Ici, après les mots : Non ne ho più! Cellini doit être dans le dernier degré d’angoisse et d’exaspération. Puis il se jette à genoux pour la première partie de sa prière : Signor ! et se relève pour l’allegro : Se tu non voi.
Après qu’il a donné l’ordre de jeter ses ouvrages en or et en argent dans le fourneau, lui-même en prend un, le plus beau, et va le jeter !
Puis il saisit un long pic en fer et se place devant la porte du fourneau.
Moment d’attente générale.
A la phrase d’orchestre
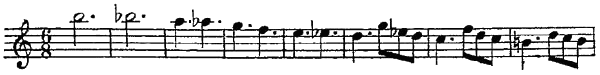
Cellini enfonce d’un coup de pic la porte du fourneau et le métal coule dans la rigole.
Alors tout le monde se lève et regarde vers le moule caché par un petit rideau. Cellini, à moitié fou et presque furieux, passe derrière le petit rideau son pic à la main, et on l’entend briser le moule à grands coups de pic en disant : Ah ! stolto io son, venite, ignoranti, etc.
Enfin à l’avant-dernier Mirate ! il est revenu de l’autre côte du petit rideau qu’il arrache ou qu’il jette à bas d’un dernier coup de pic en montrant la statue et disant : Si quis te læserit, etc. Aussitôt, les femmes des ouvriers et les ouvriers s’avancent sur l’avant-scène en criant : Vittoria ! Ascanio court à son maître et l’embrasse avec des démonstrations de joie enfantine.
Le Cardinal se lève, et, après son dernier mot : « E a te perdono » sort avec sa suite.
Le reste est facile à régler.
En résumé, il en est de Benvenuto Cellini comme de certains opéras de l’ancien répertoire français — Castor et Pollux, par exemple, ou bien les deux Alceste de Gluck — dont les remaniements ont été si considérables que l’on peut dire qu’en vérité ils constituent deux partitions différentes. Nous n’avons pas à rechercher ici s’il faut tracer une règle absolue aux éditeurs pour savoir lesquelles des deux versions doivent être préférées : le premier jet ou la forme dernière. A mon humble avis, aucune loi ne saurait être érigée en principe ; c’est une question de fait, rien de plus : dans tel cas, un auteur a pu, en retouchant son ouvrage, en affaiblir l’impression de spontanéité ; dans tel autre, au contraire, il en a corrigé les erreurs et y a ajouté des beautés nouvelles.
Pour ce qui concerne Benvenuto Cellini, aucune hésitation ne paraît possible : les retouches patiemment exécutées par Berlioz pendant quinze années furent toutes éminemment favorables au perfectionnement de son œuvre; c’est donc la forme dernière qui, conformément à sa volonté, doit être considérée comme seule authentique et définitive.
Mais il n’en serait pas moins fort intéressant de posséder, à côté de cette partition, celle qui représente la première forme de l’ouvrage. Peut-être quelqu’un voudra-t-il entreprendre un jour cette confrontation intégrale. En l’attendant, les notes ci-dessus auront donné, nous l’espérons, une idée suffisamment complète des divers états par lesquels ont passé successivement la musique et le poème de Benvenuto Cellini.
Cette étude nous a entraîné fort loin. C’est qu’elle était, en effet, longue et complexe. Nous objectera-t-on qu’une œuvre qui est la moins connue de son auteur ne méritait pas d’être examinée plus minutieusement que ses chefs-d’œuvre les plus avérés ? Mais d’abord cet examen aurait été plus rapide si l’ouvrage avait été plus familier au public, car nous eussions été dispensé de maintes explications qui, dans l’état actuel des connaissances, étaient nécessaires à la clarté de notre exposé.
Mais s’il est vrai que Benvenuto Cellini reste la production la moins connue de Berlioz, la raison est-elle suffisante pour qu’elle soit négligée ? Je suis loin de le penser. D’ailleurs, elle n’est peut-être pas aussi négligée que nous le disions. Et puisque nous donnons ici des documents, en voici un qui nous parait être assez intéressant pour que nous en terminions ce chapitre sans y ajouter aucun commentaire. C’est, par ordre chronologique de première représentation, la liste des villes d’Allemagne où Benvenuto Cellini est entré au répertoire d’opéra : Weimar, Hanovre, Mannheim, Karlsruhe, Dresde, Hambourg, Munich, Brême, Leipzig, Stettin, Berlin, Francfort-sur-le-Mein, Stuttgard, Schwerin, Fribourg-en-Brisgau, Brunswick, Prague et Vienne. Au total, dix-huit villes, dont moitié sont des capitales, les autres de simples villes de provinces.
En France, Benvenuto Cellini a eu en tout quatre représentations complètes, plus trois fragmentaires, dans une seule ville, Paris, il y a soixante-sept ans. L’œuvre était imparfaite encore. Depuis ce temps, personne n’a jamais témoigné l’envie de la revoir à la scène sous sa forme définitive, telle qu’elle apparaît après avoir reçu de l’auteur sa dernière parure et ses perfectionnements les plus attentifs.
___________________________________
(1) Cette première partie de la scène a été supprimée dans la partition définitive, ou du moins considérablement réduite.![]()
![]()
![]()
Site Hector Berlioz créé par Monir Tayeb et Michel Austin le 18 juillet 1997; page Julien Tiersot: Berlioziana créée le 1er mai 2012; cette page créée le 1er octobre 2012.
© Monir Tayeb et Michel Austin. Tous droits de reproduction réservés.
![]() Retour à la page Julien Tiersot: Berlioziana
Retour à la page Julien Tiersot: Berlioziana
![]() Retour à la page Exécutions et articles contemporains
Retour à la page Exécutions et articles contemporains
![]() Retour à la Page d’accueil
Retour à la Page d’accueil
![]() Back to Julien Tiersot: Berlioziana
page
Back to Julien Tiersot: Berlioziana
page
![]() Back to Contemporary Performances and Articles page
Back to Contemporary Performances and Articles page
![]() Back to Home Page
Back to Home Page