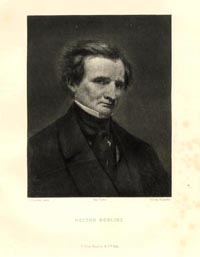
LA CRITIQUE MUSICALE
Par
Ernest Reyer
paru dans
Le Livre du Centenaire du Journal des Débats, 1889

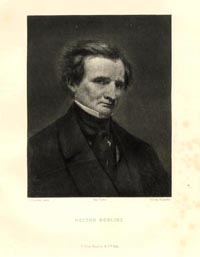
|
LA CRITIQUE MUSICALE
|

|
Le feuilleton du Journal des Débats, que Berlioz rédigea pendant près de vingt ans, fut pour lui une douleur sans cesse renouvelée, une douleur qui, un certain jour, faillit le pousser au suicide. Berlioz raconte dans ses Mémoires en quelle circonstance il devint le collaborateur de ce journal. Il venait de publier dans la Gazette musicale une nouvelle intitulée Rubini à Calais, et bien qu’il fût profondément triste, dit-il, en l’écrivant, cette nouvelle n’en était pas moins d’une gaieté folle. Le Journal des Débats la reproduisit en la faisant précéder de quelques lignes où l’on vantait «la verve et l’esprit» de l’auteur. Berlioz vint immédiatement remercier le directeur du journal, Bertin l’aîné, qui, sans plus de préambules, lui proposa de rédiger le feuilleton musical, «ce trône de critique tant envié» étant devenu vacant par la retraite de Castil-Blaze. Berlioz accepta, bien qu’il dût laisser à d’autres collaborateurs la partie la plus importante de son nouvel emploi. Il n’eut d’abord dans ses attributions que les concerts et les Variétés musicales, tandis que Janin gardait l’opéra et Delécluze le théâtre italien. En 1837, l’opéra-comique et l’opéra lui furent dévolus, mais Jules Janin, qui probablement y trouvait quelque agrément, conserva «ses droits du seigneur» sur les ballets. Quant au théâtre italien, Delécluze en demeura chargé jusqu’à sa mort, privilège que Berlioz, d’ailleurs, ne lui envia jamais.
Ah! le maudit feuilleton qui a peut-être fait une lacune regrettable dans l’œuvre du compositeur! Berlioz nous l’a dit bien souvent, et cela est consigné dans ses Mémoires: telle était son aversion pour tout travail de cette nature qu’il ne pouvait entendre annoncer une première représentation à l’un de nos théâtres lyriques sans éprouver un malaise qui augmentait jusqu’à ce que le feuilleton fût terminé. Et c’était bien pis quand il ne pouvait pas parvenir à le commencer.
Il demeura, une fois, un jour entier enfermé dans sa chambre sans pouvoir trouver la première ligne, le premier mot d’un article qu’il avait à faire sur un opéra-comique nouveau dont, par parenthèse, au bout de huit jours, il avait oublié le nom!
«Les lobes de mon cerveau1 semblaient prêts à se disjoindre. J’avais comme des cendres brûlantes dans les veines. Tantôt je restais accoudé sur ma table, tenant ma tête à deux mains; tantôt je marchais à grands pas comme un soldat en sentinelle par un froid de vingt-cinq degrés. – (Il avait dû voir cela en Russie.) – Je me mettais à la fenêtre, regardant le jardin environnant, les hauteurs de Montmartre, le soleil couchant ….. aussitôt la rêverie m’emportait à mille lieues de mon maudit opéra-comique. Et quand, en me retournant, mes yeux retombaient sur son maudit titre, écrit en tête de la maudite feuille de papier, blanche encore et attendant obstinément les autres mots dont je devais la couvrir, je me sentais envahir par le désespoir. J’avais une guitare – (le seul instrument dont il ait jamais su jouer) – appuyée contre ma table, d’un coup de pied je lui crevai le ventre... Sur ma cheminée, deux pistolets me regardaient avec leurs yeux ronds… je les considérai très longtemps... puis j’en vins à me bosseler le crâne à grands coups de poing.
«Enfin, comme un écolier qui ne peut pas faire son thème, je pleurai avec une indignation furieuse en m’arrachant les cheveux. Cette eau salée sortie de mes yeux sembla me soulager un peu. Je tournai contre le mur le canon de mes pistolets qui me regardaient toujours. J’eus pitié de mon innocente guitare, et, la reprenant, je lui demandai quelques accords qu’elle me donna sans rancune. Mon fils, âgé de six ans, vint en ce moment frapper à ma porte: par suite de ma mauvaise humeur, je l’avais injustement grondé le matin. Comme je n’ouvrais pas:
«Père, me cria-t-il, veux-tu être-z-amis?
«Je le pris sur mes genoux...»
Enfin, le lendemain, le feuilleton était fait.
Mais la suite du chapitre mérite aussi d’être citée:
«Il y a quinze ans de cela!… et mon supplice dure encore… Extermination! En être toujours là! Qu’on me donne donc des partitions à écrire, des orchestres à conduire, des répétitions à diriger; qu’on me fasse rester huit heures, dix heures même, debout, le bâton conducteur à la main, exercer des choristes sans instrument pour les accompagner, leur chantant moi-même leurs répliques tout en marquant la mesure, jusqu’à ce que je crache le sang ou que la crampe m’arrête le bras; qu’on me fasse porter des pupitres, des contrebasses, des harpes, déplacer des estrades, clouer des planches, comme un commissionnaire ou un charpentier; qu’on m’oblige ensuite, pour me reposer, à corriger pendant la nuit les fautes des graveurs ou des copistes; je l’ai fait, je le fais, je le ferai; cela tient à ma vie musicale, et, je le supporte sans me plaindre, sans y songer même, comme le chasseur endure le froid, le chaud, la faim, la soif, le soleil, les averses, la poussière, la boue et les mille fatigues de la chasse! Mais sempiternellement feuilletonner pour vivre! écrire des riens sur des riens! donner de tièdes éloges à d’insupportables fadeurs! parler ce soir d’un grand maître et demain d’un crétin avec le même sérieux, dans la même langue! employer son temps, son intelligence, son courage, sa patience à ce labeur, avec la certitude de ne pouvoir au moins être utile à l’art en détruisant quelques abus, en arrachant des préjugés, en éclairant l’opinion, en éprouvant le goût du public, en mettant hommes et choses à leur rang et à leur place! Oh! c’est le comble de l’humiliation! mieux vaudrait être... ministre des finances d’une république.
«Que n’ai-je le choix!»
Fort heureusement il n’a pu choisir.
Mais pourquoi Berlioz s’obstinait-il à un métier qui lui causait un tel dégoût, une telle aversion, et le plongeait dans de telles angoisses? Parce que, comme il le dit lui-même, ce métier l’aidait à vivre et lui permettait, quand il en avait le loisir, d’écrire de la musique dont il ne vivait pas.
Je vois d’ici sourire de pitié, à la lecture des lignes qui précèdent, ceux qui élaborent avec la même indifférence, la même facilité, un feuilleton musical sur n’importe quoi et n’importe qui, sur tel ouvrage ou tel autre, qu’il soit médiocre ou sublime, ancien ou nouveau. Leurs connaissances techniques ne les gênent guère, et ils se consolent aisément de n’en point posséder, en songeant qu’elles n’ajouteraient absolument rien à l’autorité de leurs jugements.
Mais n’allez pas croire que Berlioz fût toujours triste, découragé, devant une feuille de papier blanc, ou en proie à de tragiques rêveries quand il avait à faire un feuilleton. Il nous a laissé sur Beethoven et sur Gluck, sur Weber et Spontini des pages qui débordent d’enthousiasme et dans lesquelles «on sent bien la joie d’écrire2.»
N’était-il pas joyeux de tenir la plume quand il écrivait ces spirituelles et humoristiques fantaisies qu’il recueillit plus tard dans les Soirées de l’orchestre, À travers chants et dans les Grotesques de la musique? Là il se montre bien tel que nous l’avons vu si souvent en ses jours de gaieté folle et de verve endiablée, maniant comme pas un le sarcasme et l’ironie et allant même jusqu’au calembour. Une annonce du compositeur de romances Panseron appelant à lui les amateurs qui voudraient donner à leurs productions hâtives ou fantasques un vernis de science et de correction, avec promesse de garder le secret professionnel, lui inspire cette boutade dont on rit encore aujourd’hui: le docteur Panseron vient d’ouvrir un cabinet de consultations pour le traitement des mélodies secrètes. Les donneurs de concerts l’exaspèrent:
«Vous tous, grands et petits pianistes, violoncellistes, hauboïstes, flûtistes, saxophonistes, cornistes, triples violonistes, simples racleurs, chanteurs, roucouleurs et compositeurs, laissez-moi tranquille; gardez-vous de me pousser au désespoir; car, je le déclare, je ne suis point un apologiste du suicide; mais il y a là sur ma table une paire de pistolets chargés! – (Ces pistolets avec lesquels il nous a fait faire connaissance déjà.) – Et si l’un de vous avait la barbarie de me relancer encore, je serais capable de lui brûler la cervelle.»
Sous prétexte de nous parler des mœurs musicales de la Chine, il fait une critique désopilante des nôtres, de ce qui se passe dans nos théâtres, des libertés grandes que prennent nos chanteurs envers les maîtres qu’ils sont chargés d’interpréter et qu’ils travestissent, qu’ils outragent:
«Les législateurs chinois ont donc, avec grande raison, selon moi, prononcé des peines sévères non seulement contre les directeurs de théâtre qui représenteraient mal les belles œuvres lyriques de Koang-Fu-tsée, mais encore contre les chanteurs et les chanteuses qui se permettraient, dans les concerts, d’en chanter des fragments indignement. Chaque semaine, un rapport est fait par la police musicale au mandarin directeur des arts; si une chanteuse s’est rendue coupable du délit de profanation que je viens d’indiquer, on lui adresse un avertissement en lui coupant l’oreille gauche. Si elle retombe dans la même faute, on lui coupe l’oreille droite pour second avertissement... La législation chinoise, d’ailleurs, se montre là un peu sévère, car on ne peut pas exiger une exécution irréprochable d’une cantatrice qui n’a pas d’oreilles...»
Il plaisante même l’Académie, ce qu’il fit du reste plus d’une fois avant de devenir lui-même académicien:
«Il ne se publie pas dans toute la Chine un livre sur la musique, la peinture, l’architecture, etc., que l’auteur ne soumette son travail à l’examen des mandarins artistes, afin, s’ils l’approuvent, de pouvoir inscrire sur la seconde édition de l’ouvrage : Approuvé par le collège.
«Malheureusement, les membres respectés de cette institution, qui avaient souvent le droit de faire infliger aux auteurs le supplice de la cangue, ont toujours été, à l’inverse des directeurs spéciaux de l’art musical, animés d’une telle bienveillance qu’ils approuvent généralement tout ce qu’on leur présente. Aujourd’hui, ils loueront un auteur d’avoir exposé telle ou telle doctrine, préconisé telle ou telle méthode de tam-tam; demain un autre exposera la doctrine contraire, prônera la méthode opposée, et le collège ne manquera pas de l’approuver encore … Ah! pauvres Chinois! il ne faut plus s’étonner de voir chez eux l’art rester obstinément stationnaire!»
Et la conclusion de cet amusant parallèle:
«Les mœurs chinoises, si différentes des nôtres en tout ce qui touche aux beaux-arts en général et à la musique en particulier, s’en rapprochent sur un seul point: pour diriger les flottes, ils prennent des marins. Si nous continuons, à la vérité, nous finirons par leur ressembler.»
Berlioz a brodé plus d’une variation sur ce thème vieux comme la musique, et toujours rajeuni: le droit bizarre, extravagant, inouï, que s’arrogent certains artistes de corriger les auteurs. Il y revient, avec les comparaisons les plus ingénieuses, les métaphores les plus hardies, dans une lettre qu’il adresse de Bade, où il était allé donner son premier grand festival, à ses confrères de l’Académie des beaux-arts. Cette lettre, datée de 1861, «parut d’un style trop en dehors des habitudes académiques et n’a pas été lue en séance publique». La vérité est qu’elle était tout bonnement destinée au Journal des Débats. Il cite ce joli mot de Rossini: «Ma musique n’est pas encore faite: on y travaille. Mais ce n’est que le jour où il n’y restera plus rien de moi qu’elle aura acquis toute sa valeur.» Et encore celui-ci, qui pourrait bien être de lui: «A la dernière répétition d’un opéra nouveau: Ce passage ne me va pas, dit naïvement un chanteur, il faut que je le change. – Oui, répliqua l’auteur, mettez quelque autre chose à la place. Chantez la Marseillaise.»
Dans cette même lettre, Berlioz ne s’en prend pas seulement aux chanteurs, qui se croient tout permis, et aux cantatrices, qui ne le cèdent en rien aux chanteurs. «Nous autres compositeurs, écrit-il, nous avons la chance d’être assassinés par tout le monde, par des chanteurs sans talent, par les méchants virtuoses, par les mauvais orchestres, par les choristes sans voix, par les chefs d’orchestre incapables, lymphatiques ou bilieux,... par les architectes qui construisent les salles, enfin par les claqueurs qui nous applaudissent.» Ce dernier trait à propos de la belle phrase instrumentale qui termine le trio des masques dans Don Juan, et qui est toujours couverte par les applaudissements. Et comme il se rebiffe contre ce «sauveur du Capitole» qui vient le relancer pendant qu’il était perdu dans sa contemplation, dans sa rêverie, sur la plus haute plate-forme du vieux château de Bade!
«– Je parie que vous travaillez à l’opéra que M. Bénazet vous a commandé pour l’ouverture du théâtre de Bade….. – N’employez donc pas, s’il vous plaît, des expressions aussi inconvenantes. M. Bénazet ne m’a rien commandé; on ne commande rien aux artistes, vous devriez le savoir. On commande à un régiment français d’aller se faire tuer, et il y va; à l’équipage d’un vaisseau français d’aller se faire sauter, et il y va; à un critique français d’entendre un opéra-comique dont il doit rendre compte, et il l’entend, mais c’est tout; et si l’on commandait à certains acteurs de déranger seulement leurs habitudes, d’être simples, naturels, nobles, également éloignés de la platitude et de l’enflure; si l’on commandait à certains chanteurs d’avoir de l’âme et de bien rythmer leur chant, à certains critiques de connaître ce dont ils parlent, à certains écrivains de respecter la grammaire, à certains compositeurs de savoir le contrepoint, les artistes sont fiers, ils n’obéiraient pas…»
Berlioz avait beau maugréer contre la dure nécessité de faire des feuilletons, de les faire à heure fixe, on sentait qu’il y avait en lui un impérieux besoin d’écrire. Le compte rendu d’un opéra-comique pouvait bien faire grincer sa plume sur le papier; mais avec quelle aisance et quelle abondance de traits il pétrissait les abus au théâtre, le charlatanisme de certains virtuoses, la mauvaise foi de certains directeurs, la platitude de certains compositeurs! On sentait qu’il était pénétré de son sujet; cela coulait de source, et ce n’était pourtant pas tout à fait de l’eau claire. Rarement il s’est laissé aller à des personnalités blessantes, et quelques-uns qui se sont attiré de sa part de vertes ripostes les avaient, ma foi, bien méritées. Scudo avait écrit ceci: «Le Chinois qui charme ses loisirs par le bruit du tam-tam, le sauvage que le frottement de deux pierres met en fureur, font de la musique dans le genre de celle que compose M. Hector Berlioz.» Berlioz a-t-il été trop loin en traitant un peu prématurément de fou l’auteur de cette boutade, qui ne devait mourir de folie furieuse que quelques années plus tard?
Le feuilletoniste d’un grand journal, mêlé au mouvement musical et ayant des relations assez étendues, ne pouvait guère être à l’abri de certaines suggestions, de certaines influences. Berlioz, malgré l’indépendance de son caractère, les a subies comme tant d’autres. Mais il avait une façon à lui de se résigner à l’éloge: il l’exagérait ou lui donnait un tour ironique, et son but était atteint. Ses louanges lui ont peut-être fait autant d’ennemis que ses critiques. En voici un exemple que cite M. Jullien dans son beau livre3. Il s’agit du compte rendu d’un opéra d’Halévy, le Val d’Andorre:
«...Les quatre-vingt-dix-neuf centièmes des auditeurs applaudissaient, approuvaient, étaient émus, dit-il, après avoir épuisé toutes les formules d’éloge possibles et imaginables. Une fraction cependant, fraction imperceptible, mais qui contient encore des esprits d’élite, ne partageait qu’avec des restrictions l’opinion dominante sur la valeur de l’ouvrage; d’autres, dès la fin du second acte, se montraient déjà fatigués d’entendre dire que c’est charmant!... Pour moi, j’ai franchement admiré. J’ai été impressionné vivement sans songer, en écoutant les acclamations enthousiastes de la salle, à appliquer à M. Halévy ce mot antique: « Le peuple applaudit, aurait-il dit quelque sottise ?... »
Il est difficile, ajoute M. Jullien, de ne pas remercier le feuilletoniste qui vous couvre ainsi de fleurs; mais il est bien plus difficile, à ce qu’il me semble, de ne pas douter quelque peu «de la franchise de son admiration, de la vivacité de ses impressions». Halévy ne dut pas s’y tromper.
Bien des musiciens ne lui ont jamais pardonné son feuilleton sur Zampa. Lorsque Berlioz mourut, Janin, dans un article nécrologique où il cherchait à disculper son ami de bien des erreurs, de bien des méchancetés, dont on l’avait accusé, et fort injustement, j’imagine, déclara que ce feuilleton était de lui. Seulement il se trompa, confondit Zampa avec le Pré aux Clercs, ou le Pré aux Clercs avec Zampa, de telle sorte que le plaidoyer du célèbre lundiste manqua complètement son but.
Berlioz était loin, comme on le lui a reproché, d’être exclusif dans ses enthousiasmes, et son admiration pour Gluck et Beethoven, Spontini et Weber ne l’empêchait nullement d’apprécier ce qu’il y avait de beau et même de sublime dans les œuvres d’autres compositeurs. Et pour quelques réticences qu’il a pu se permettre, il ne faut pas dire, par exemple, qu’il méconnaissait le génie de Mozart, pas plus que celui de l’auteur des Huguenots. «Ici nous entrons dans le sublime», disait-il au moment où commençait le duo du quatrième acte. Et à propos d’Idoménée: «Quel miracle de beauté qu’une telle musique! Comme c’est pur! Quel parfum d’antiquité! C’est grec, c’est incontestablement grec, comme l’Iphigénie de Gluck, et la ressemblance du style de ces deux maîtres est telle dans ces deux ouvrages, qu’il est vraiment impossible de retrouver le trait individuel qui pourrait les faire distinguer.» Pouvait-il formuler son éloge avec plus d’enthousiasme et de sincérité? Ne rendait-il pas hommage au génie mélodique de Bellini, au charme de l’inspiration qui se révèle, sous une si exquise simplicité de forme, dans les œuvres de Grétry, de Dalayrac et de Monsigny?
Lettres de voyages du plus haut intérêt, analyses critiques de chefs-d’œuvre qui le ravissaient et d’opéras dont la médiocrité le révoltait; fantaisies où il donnait un libre cours à l’originalité de son imagination, broderies sur les thèmes les plus divers, absolument étrangers à l’art ou touchant à l’art de très près, colères et enthousiasmes portés à leur paroxysme, fines ironies ou boutades auxquelles il ne craignait pas de mêler un peu de trivialité, de l’esprit répandu à pleines mains; une érudition qui n’est jamais allée jusqu’au pédantisme: tout cela a donné pendant trente ans une saveur particulièrement alléchante et une autorité incontestable aux feuilletons qu’Hector Berlioz a publiés dans le Journal des Débats.
Souvent, en ses articles, Berlioz glissait des mots à double sens et des allusions fines, si fines qu’il était seul à les comprendre avec celui qu’il attaquait. Dans ces moments-là, il faut le dire, il n’écrivait plus pour le public, mais pour lui-même, en se moquant bien un peu de ses lecteurs; par exemple, quand, à propos de la Servante maîtresse, il recopie un de ses anciens articles en taisant le nom de l’auteur et en feignant de prendre au sérieux une fantaisie ironique, et qu’il se réfute alors, qu’il se nargue et se confond, toujours à l’insu du public, vivement intéressé par cette polémique avec un adversaire des plus redoutables. Mais, dans le nombre aussi, que de piquantes saillies! «Esthétique! Je voudrais bien voir fusiller le cuistre qui a inventé ce mot-là!...» – «Mais, mon Dieu, nous ne chantons pas, nous antres compositeurs. Pourquoi, diable, vous chanteurs, voulez-vous absolument composer?» Et que de boutades vraiment drôles! «Un marin, capitaine au long cours, disait un jour: – Toutes les fois que je quitte Paris pour faire le tour du monde, je vois affichée la Favorite, et toutes les fois que je reviens, je trouve affichée Lucie. Ce à quoi un de ses confrères répondit: – Allons, vous exagérez; on ne joue pas Lucie aussi souvent. Quand je pars pour les Indes, je vois, il est vrai, affichée la Favorite; mais quand j’en reviens, on ne joue pas toujours Lucie... On donne quelquefois encore la Favorite4.»
De son honorabilité, de sa dignité d’artiste qui n’a jamais su fléchir, il serait superflu de parler. La plume du critique a été une arme puissante entre ses mains; mais tout au contraire de la lance d’Achille, elle n’a pas guéri les blessures qu’elle a faites. Et parmi les musiciens qui, entraînés par le courant, se sont associés à sa glorification, il en est peut-être qui, même légèrement égratignés par lui, ne lui ont pas encore pardonné.
Ceux qui persistent à voir en Berlioz un critique systématiquement hostile, passionné, haineux, n’ont pas lu ses feuilletons. Et ils ne se disent pas que quelques vivacités, quelques écarts de plume sont bien excusables chez un compositeur qui fut en butte, dans son pays même et sa vie durant, aux plus cruels sarcasmes, aux plus violentes injures. Ses admirateurs, dont le nombre s’est singulièrement accru depuis qu’il est mort, ont enfin réussi à le venger, se souvenant peut-être de ce conseil donné par lui même: «Il faut collectionner les pierres qu’on vous jette: c’est le commencement d’un piédestal.» Aujourd’hui, le piédestal existe et la statue est debout. Le jour où elle fut inaugurée, nous fûmes heureux de pouvoir associer dans la même apothéose le brillant écrivain et l’immortel compositeur.
C’est sur les Pêcheurs de perles, du regretté Georges Bizet, que Berlioz a écrit son dernier feuilleton; il est daté du 8 octobre 1863. Le maigre bénéfice que lui rapportèrent ses droits d’auteur et la vente de sa partition des Troyens lui permirent enfin de prendre une retraite qu’il avait si longtemps désirée. Après tout, il se peut qu’a ce moment-là il n’eût plus grand’chose à dire, ayant eu le loisir, pendant trente ans, de dire tout ce qu’il voulait5.
_______________________
2. Les feuilletons d’Hector Berlioz. (Journal des Débats du 19
octobre 1886.)![]()
3. Hector Berlioz, sa vie et ses œuvres.![]()
4. Hector Berlioz, sa vie et ses œuvres, par Adolphe Jullien, page
338.![]()
5. Cette notice serait incomplète si le nom de d’Ortigue ne s’y trouvait au moins rappelé. D’Ortigue, du vivant même de Berlioz, a écrit de nombreux articles sur les œuvres musicales dans le Journal des Débats. C’était un critique grave, consciencieux érudit et un peu solennel. Ami de Lamennais, auteur de petits livres religieux: la Sainte-Baume, les Nouvelles chrétiennes, il s’occupait particulièrement de musique sacrée. Mais il suppléait aussi Berlioz, son intime ami, quand celui-ci ou ne pouvait ou ne voulait, pour quelque raison parler d’une œuvre nouvelle. C’est ainsi qu’il fit le feuilleton sur la première représentation du Tannhauser à Paris. Dans un article demeuré célèbre sur les concerts de Wagner, Berlioz, le 9 Février 1860, avait condamné avec éclat les théories et les innovations du musicien allemand. Wagner avait adressé au Journal des Débats une longue lettre (22 Février); il y exposait et défendait son système dramatique et musical. A cause de cette querelle, qui avait fait grand bruit dans le public, Berlioz passa la plume à d’Ortigue quand fut exécuté le Tannhauser. On a souvent répété que ce feuilleton avait été inspiré par Berlioz. Mais quand on voit dans la correspondance de ce dernier à quel paroxysme de fureur l’avait porté la représentation de l’opéra de Wagner, et qu’on lit le feuilleton de d’Ortigue, bien moins injuste et bien moins violent que la plupart des articles écrits à la même date sur le même sujet, on doit avouer que c’est là un bien faible écho des colères de Berlioz. D’Ortigue discute et critique sans passion, sans mauvaise foi, et conclut gravement « L’Empereur, la France et l’Opéra se sont montrés grands pour M. Wagner, et nous les remercions. » (23 mars 1861.)
C’est enfin d’Ortigue qui, dans le Journal des Débats, rend compte des ouvrages de Berlioz; il s’en acquitte avec tout le zèle de l’amitié; mais sous les éloges qu’il prodigue au compositeur, on devine, à certaines réserves, que le style de Berlioz n’est pas toujours pour lui plaire. Il use pour la louange de formules générales: «M. Berlioz, écrit-il à propos des Troyens, le 9 novembre 1863, ne vise à rien moins qu’à atteindre au premier rang dans son art.» Mais pour indiquer les défauts de l’œuvre, il descend dans les plus minutieux détails de la technique musicale.
Après la représentation des Troyens, d’Ortigue fut chargé pendant trois ans de la critique musicale aux Débats. Néanmoins, durant ces
années, d’autres rédacteurs empiétèrent plus d’une fois sur son domaine.
C’est ainsi qu’on peut retrouver dans la collection du journal des articles de
Prévost-Paradol sur l’Alceste de Gluck.![]()
![]()
* Nous remercions vivement notre ami Gene Halaburt
de nous avoir envoyé cet article, ainsi que les deux images qui l’accompagnent. M. Halaburt est en possession d’un exemplaire original du Livre du Centenaire du Journal des Débats, publié
en 1889.![]()
** Deuxième partie d’un article sur La critique musicale dont la première est consacrée à Castile-Blaze, article publié à l’occasion
du centenaire du Journal des Débats. Ernest Reyer (1823-1909) fut un ami fidèle de Berlioz pendant les
dernières années du compositeur et défendit sa mémoire après sa mort. Voir l’article sur ce site qui lui est consacré, et les extraits de ses nombreux feuilletons qui concernent Berlioz et sa musique.![]()
Les articles de Berlioz dans le Journal des Débats et autres journaux sont en cours de publication dans une série en 10 volumes intitulée Critique musicale. Tous les près de 400 feuilletons de Berlioz dans les Débats son reproduits intégralement sur se site, et sont munis d’une fonction recherche autonome.
![]()
Voir aussi sur ce site:
L’inauguration de la statue de Berlioz à La Côte Saint André
![]()
Site Hector Berlioz créé le 18 juillet 1997 par Michel Austin et Monir Tayeb; cette page créée le 12 mars 2004.
© Monir Tayeb et Michel Austin. Tous droits de reproduction réservés.
![]() Retour à la page Exécutions et articles contemporains
Retour à la page Exécutions et articles contemporains
![]() Retour à la Page d’accueil
Retour à la Page d’accueil
![]() Back to Contemporary Performances and Articles page
Back to Contemporary Performances and Articles page
![]() Back to Home Page
Back to Home Page